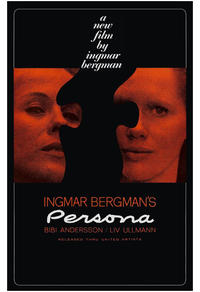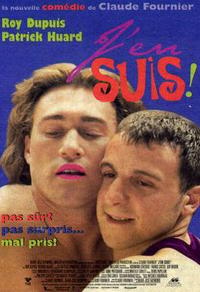Présenté au FFM l'an dernier, le nouveau film de Tony Gatlif offre un dépaysement rassurant jouant sur les mêmes cordes de l'émotion que les films hollywoodiens. Un exotisme mou, en quelque sorte. Liberté est un film hollywoodien comme les autres, avouons-le, à l'exception qu'il se déroule en français. Cette histoire de gitans victimes de l'oppression allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale est celle de nombreux peuples et de nombreux groupes religieux qui, malgré leurs différences idéologiques, ont tous été rassemblés dans la mort par les Nazis. Il n'y avait pas que les Juifs dans les camps de concentration, peut-être l'a-t-on oublié, et Liberté se fait un devoir de mémoire que de nous le rappeler (une excellente initiative). Mais il ne prend pas les bons moyens pour y parvenir : la fiction semble en premier lieu bien mal adaptée pour un sujet si peu connu collectivement que celui-ci.
En 1943, suite à la promulgation d'une loi interdisant le nomadisme, une famille Tsigane s'installe près d'un petit village du Nord de la France afin d'échapper aux soldats allemands lancés à leur poursuite. Sans propriété, ils sont vulnérables. Capturés puis emprisonnés, ils reçoivent l'aide du vétérinaire et du maire du village, Théodore, qui les libère et leur offre une terre. Mais pendant que l'institutrice du village, Mademoiselle Lundi, recueille l'orphelin P'tit Claude, leurs ennemis tentent de les capturer.
Cette notion de proximité avec la Terre du peuple Tisgane, illustrée par un personnage aimant se rouler dans les feuilles, voulant « libérer » l'eau en ouvrant tous les robinets et par un peuple croyant et terrifié par les fantômes, est un mélange de stéréotypes et de mépris. Si le message était de comprendre et d'accepter les Tsiganes, on se demande vraiment comment ces moyens - en plus d'une musique envahissante - permettront d'y parvenir. Ce n'est pas ici la compréhension et l'acceptation d'une culture, c'est la vision occidentalisée de ce qui fait son « exotisme ».
Une scène affreuse, placée au milieu du film, manipule sans vergogne le spectateur en lui imposant le regard piteux d'enfants prisonniers des camps de concentration. Une digression de la fiction indécente et obscène, qui n'a d'autre but que d'émouvoir démagogiquement le spectateur de bonne foi et qui met en lumière les limites de la fiction face à de tels objectifs. Quelques instants plus tard, on pousse même l'obscénité à célébrer la libération d'une quarantaine de prisonniers, tout en oubliant volontiers les cinq cents autres condamnés à une mort certaine. Pour un film voulant rendre hommage à un peuple entier, c'est extrêmement risqué de prendre un tel parti éditorial.
La finale s'avère elle aussi ambigüe, alors que c'est plutôt l'incompréhension d'un mode de vie qui condamne les gitans que la mauvaise foi crasse des gendarmes français (ils n'avaient qu'à rester dans leur propriété si gentiment offerte par le bon Français!). On aurait très bien pu admettre et comprendre que c'est dans leur nature que d'être près de la nature, que d'être nomades et libres, mais le film ne permet pas de faire cette association et n'en fait pas une de ses thématiques principales, préférant tenter de culpabiliser les méchants Collabos. Ce qui est très facile.
Cela donne un film confus dans son message. L'histoire d'amour incongrue ne sert par le propos, pas davantage que le petit orphelin qu'on doit impérativement prendre en pitié et qui vient assoir la suprématie occidentale dans le film (parce qu'évidemment, seulement des Tsiganes dans un film, ce n'est pas très vendeur). Enchaînant les scènes maniérées, le réalisateur ne parvient pas à attiser l'empathie souhaitée envers un peuple victime de l'intolérance occidentale.