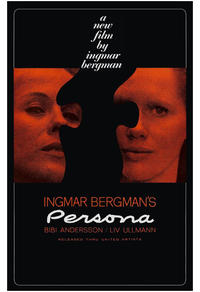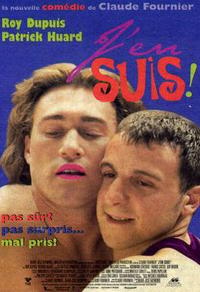Adapté d'un roman de José Samarago, récipiendaire d'un Prix Nobel de littérature, L'aveuglement a été présenté en ouverture du plus récent Festival de Cannes. Unanimement conspué par la critique, le film est retourné sur la table de montage et est ressuscité trois mois plus tard au Festival de Toronto sous une nouvelle forme, beaucoup mieux accueillie. Lourd de symboles, le film s'avère être une réflexion puissante sur l'inhumanité. Imparfait d'accord, mais raté certainement pas.
Alors qu'une épidémie de cécité soudaine se propage de manière fulgurante dans la ville, le gouvernement place les malades dans un hôpital abandonné. Laissés à eux-mêmes, ils doivent coexister avec des ressources limitées. Au milieu d'eux, une femme mystérieusement épargnée par la maladie tente d'aider du mieux qu'elle peut, mais la nourriture, contrôlée par les des résidents du dortoir numéro 3, autoproclamés régents, vient à manquer.
Enfermés comme des bêtes dans un hôpital entouré d'une clôture et surveillé par l'armée, les malades ont les mêmes besoins et les mêmes envies que les animaux. Les plus forts en viennent rapidement à dominer les autres, forçant au passage certains gestes taxés d'invraisemblables par les premiers échos cannois. Pourtant, sans aller jusqu'à prétendre que le film fait dans la subtilité, ces moments ajoutent à un commentaire qui est loin d'être subtil lui-même. La métaphore est lourde et sans doute trop simple, mais pas fausse pour autant. Les soldats se comportent comme de parfaits abrutis et les malades font preuve d'une inhumanité sans nom entre eux. On a fait des films par centaines sur cette barbarie irrationnelle, même pré-11 septembre, et L'aveuglement, bien des années plus tard, parvient à ajouter quelque chose aux questionnements profonds que cette infantile démonstration de force suggère. Quoi? Cela dépend.
Une réflexion sur le pouvoir et son application; sur l'empathie; sur un certain pragmatisme mais surtout sur l'affection, voire l'amour, qui pousse certaines personnes à tenter de sauver d'autres personnes en les choisissant parmi leur famille ou leurs amis et en sacrifiant les autres. Parce que dans cette « réflexion », même les vertueux deviennent des criminels, pour peu que ce terme existe toujours dans un tel chaos. Meireilles installe son histoire dans une ville à la fois américaine et européenne et utilise la caméra de manière particulièrement créative, lui non plus sans éviter tous les clichés mais se permettant certaines audaces très réussies. Sans narration envahissante, le film a une véritable force dramatique.
Les acteurs, surtaxés et déstabilisés par la perte d'un sens, se démènent merveilleusement à travers les cadavres et les déchets qui s'amoncellent. Le sentiment d'urgence est palpable; en fait, le film prouve par cent qu'il manque une chose au cinéma pour qu'il soit un art total : l'odeur. Et puis - nécessairement - arrive la fin. Pas celle de l'humanité (pas tout de suite). Cette humanité qui doit retrouver la vue pour voir de quoi elle s'est rendue coupable, pour voir, comme révélée, sa bestialité sans limite. Comme c'est souvent le cas, c'est là que tout se joue; le spectateur décidera presque immédiatement ce qu'il aura pensé du film, s'il l'aura vécu de la « bonne » manière ou s'il en aura souffert jusqu'à l'exaspération. Avec L'aveuglement, le souffrir jusqu'à l'exaspération est la « bonne » chose à faire.
Adapté d'un roman de José Samarago, récipiendaire d'un Prix Nobel de littérature, L'aveuglement a été présenté en ouverture du plus récent Festival de Cannes. Unanimement conspué par la critique, le film est retourné sur la table de montage et est ressuscité trois mois plus tard au Festival de Toronto sous une nouvelle forme, beaucoup mieux accueillie. Lourd de symboles, le film s'avère être une réflexion puissante sur l'inhumanité. Imparfait d'accord, mais raté certainement pas.