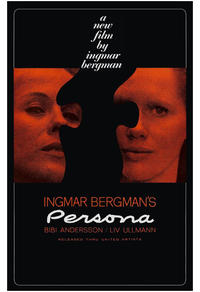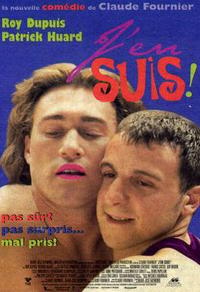Le premier long métrage de fiction de Benoît Pilon, Ce qu'il faut pour vivre, s'aborde un peu de la même manière que ses documentaires : un homme un peu différent, un peu unique, un peu spécial est au centre d'une histoire bâtie autour d'un thème marquant, souvent ancré dans l'histoire du Québec (Nestor et les oubliés, par exemple). Cette fois-ci, un Eskimo est soigné par les Blancs à Québec; le coup du choc des cultures, qui n'est pas ici un prétexte à quelques blagues impolies mais à une fine observation - peut-être comme seul un documentariste, habitué au contact humain et prêt à attendre, peut le faire. Un film solennel, lent et respectueux, bien davantage que le seront jamais les enflammés réquisitoires politiques pour le respect d'une culture déjà perdue. Pourtant, Benoît Pilon n'est pas passéiste, il vit dans le présent et son film aussi, même s'il se passe en 1952.
Atteint de tuberculose, Tivii doit quitter sa famille pour être traité dans un sanatorium de Québec. Loin des siens, dans un monde qu'il ne connaît pas et entouré de gens qui ne comprennent pas sa langue, Tivii tente de fuir pour retrouver sa famille. Mais une infirmière chargée de le soigner décide de le mettre en contact avec le petit Kaki, un jeune garçon malade déraciné qui va lui redonner goût à la vie.
Le scénario merveilleusement bien construit de Bernard Émond fournit une charpente parfaite pour bâtir un film efficace émotivement. Très efficace, même, tellement qu'on ne s'étonne pas vraiment des rebondissements de l'histoire, qui sont souvent, en fait, la seule option possible pour le film. La finale, entre autres, termine comme il le fallait - sans impressionner mais sans s'étirer inutilement - un film dédié à l'émotion et au ressenti.
Natar Ungalaaq, s'il est bon dans le rôle principal de Tivii, est assez figé pendant la première moitié du film, avant de s'épanouir finalement après l'arrivée du jeune Kaki, sorte de mélange des cultures occidentales et inuit. Son interprétation subit le même phénomène : lourdaud et endormi, Ungalaaq attend la seconde moitié du film pour devenir plus chaleureux, plus vibrant. Le jeune Kaki (incarné par Paul-André Brasseur, très inégal) semble s'ennuyer à mort dans le film, semble être tiré par les efforts d'Ungalaaq.
Il n'y a pas de méchant, dans Ce qu'il faut pour vivre, même les plus blancs des Blancs ne sont pas ces clichés racistes qui font des autres films sur le même sujet des pamphlets. Plus subtile que ça, Pilon ne se prononce pas clairement, n'appuie heureusement pas trop. Quelques clichés culturels et légendes piquent la curiosité et appuient bien le propos. La performance, quoique effacée, d'Antoine Bertrand est d'une grande efficacité, tout comme celle de Vincent-Guillaume Otis, en compagnon de chambre curieux et qui représente cette soi-disant « incompréhension » de l'homme blanc. Pilon fait un film au présent, post-accomodements-raisonnables, qui parle de curiosité et d'ignorance plutôt que de « choc ».
Un travail très bien fait à toutes les étapes, on le voit bien. Le scénario, d'abord, est parfaitement construit, les images sont magnifiques, les acteurs bien dirigés en général, la musique appuie bien les émotions... vraiment, tout s'accorde pour faire un film bien fait, comme on parle d'un travail bien fait. L'émotion est là, prête à être saisie, mais on ne parle pas ici d'un film « venteux », comme j'aime les appeler (un film comme La neuvaine), ces films trop rares qui donnent l'impression d'être transporté, sans arme, par un froid vent de fin d'automne revigorant.
Le coup du choc des cultures, qui n'est pas ici un prétexte à quelques blagues impolies mais à une fine observation – peut-être comme seul un documentariste, habitué au contact humain et prêt à attendre, peut le faire. Un film solennel, lent et respectueux, bien d'avantage que le seront jamais les enflammés réquisitoires politiques pour le respect d'une culture déjà perdue.