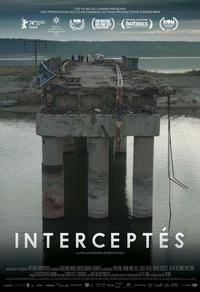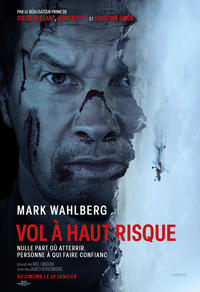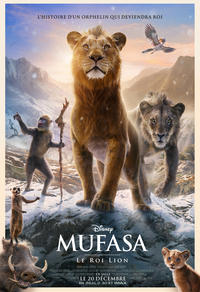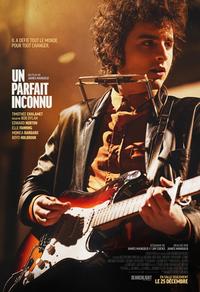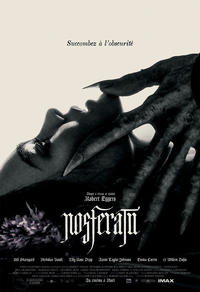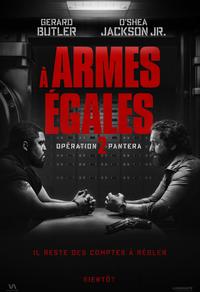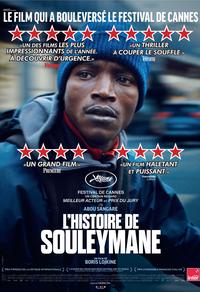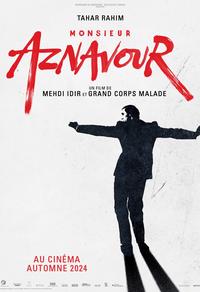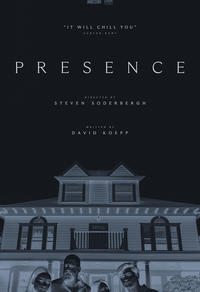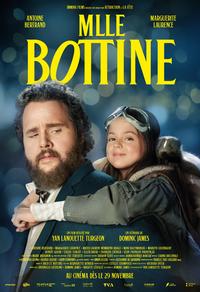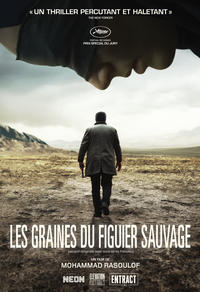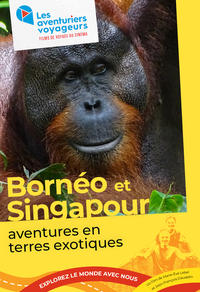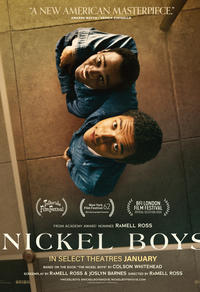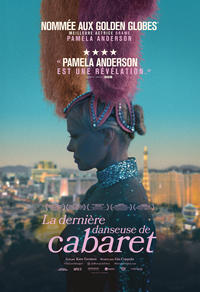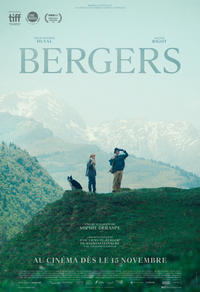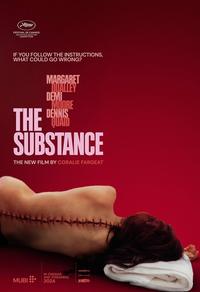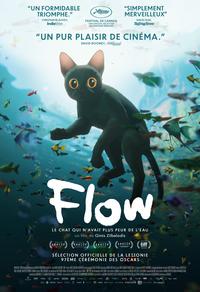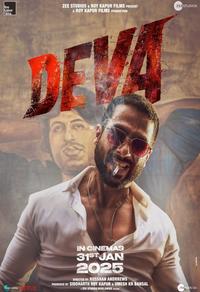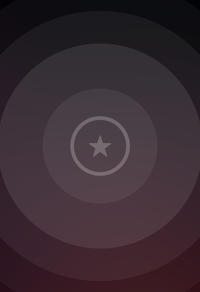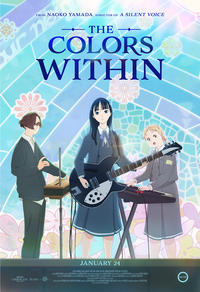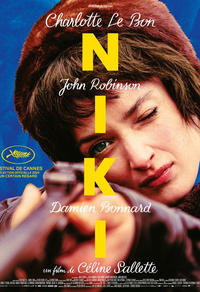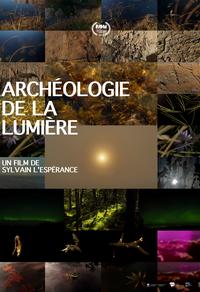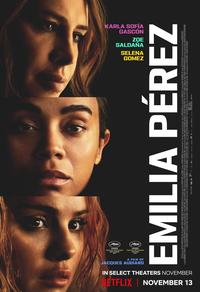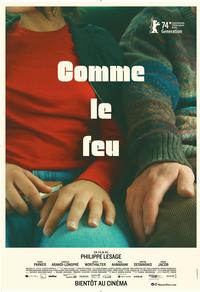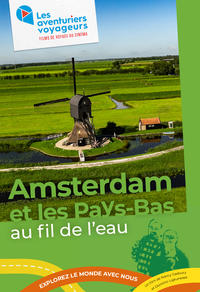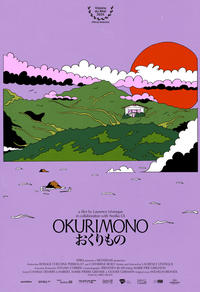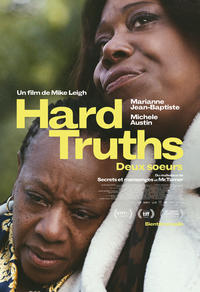Il n'y a que très peu, au sein d'un cinéma que l'on pourrait qualifier de « commercial », de films qui mettent en scène un seul personnage. Évidemment, ces oeuvres judicieusement échafaudées pour divertir - et rejoindre le plus de spectateurs possible - sont mieux servies par une gamme de protagonistes hétéroclites que par un héros solitaire, souffrant, volontairement ou pas, d'une quarantaine, d'un retranchement sociétaire. Mais certains cinéastes, assistés par un récit poignant et des acteurs vibrants, parviennent à produire des longs métrages captivants avec comme seul assise un homme, souvent déchu, en quête de communauté.
Life of Pi, qui a pris l'affiche mercredi dernier et qui raconte l'histoire d'un homme qui, après le naufrage du navire qui le conduisait, lui et sa famille, vers l'Amérique, se retrouve sur un bateau de sauvetage avec un tigre de Sibérie, n'a que très peu de longueurs - même si c'est ce quon pourrait attendre d'une oeuvre de deux heures sept minutes mettant en scène un tigre et un Indien. Appuyé à quelques reprises par des flashbacks et des flashfowards, le film de Ang Lee parvient à retenir l'attention des spectateurs en préservant l'intensité dramatique de la production jusqu'à son apogée et en affinant continuellement la relation entre les deux êtres; l'un humain, l'autre animal, l'un rationnel, l'autre instinctif. Life of Pi réussit à nous amener aussi loin dans l'émotion et le divertissement qu'une brochette incommensurable de comédiens payés beaucoup trop cher.
L'exemple le plus évident de cette dépendance d'un héros solitaire avec un tiers s'avère fort probablement celui du personnage de Tom Hanks dans Cast Away avec le ballon de volleyball Wilson, maintenant devenu, dans l'esprit de bien des cinéphiles, un protagoniste à part entière de l'oeuvre de Robert Zemeckis. Cette interdépendance que les personnages entretiennent avec des objets, des animaux ou un alter-ego imaginaire que leur esprit embrouillé échafaude, contribue fortement à la viabilité de ces oeuvres dramatiques et à leur force actancielle. Une forme d'anthropomorphisme qui dynamise chacune des interactions et qui aide à la fluidité des scènes et des péripéties contribue inévitablement à l'efficacité du résultat final. Cast Away dure plus de deux heures trente minutes et s'avère n'être, en fait, qu'un homme seul sur une île déserte qui parle avec un ballon inanimé, et pourtant, en plus d'avoir été nommé au Oscars à deux reprises, le long métrage est toujours dans le top 100 des meilleurs box-offices de tout les temps avec des recettes de 233 millions $ en Amérique du Nord.
Dans le drame psychologique de science-fiction Moon, le protagoniste, joué par Sam Rockwell, seul sur une station lunaire, s'adresse à un ordinateur central pour oublier sa quarantaine. Très profond et personnel, le film utilise principalement l'angle psychologique; une solitude qui peut mener jusqu'à la démence, pour convaincre et retenir le spectateur. Bien que Sam Rockwell soit, la plupart du temps, le seul acteur à supporter la production sur ses épaules, le long métrage n'en est pas moins intrigant, angoissant et excessivement stimulant notamment grâce à la tension qu'il parvient à créer avec cette machine, à qui il accorde une importance aussi substantielle que celle qu'il accorderait à un partenaire de jeu humain. Buried, avec Ryan Reynolds, fait aussi partie de ces oeuvres puissantes menées par un seul acteur. Comme le film espagnol se déroule dans un lieu clos (très clos, puisqu'on parle ici d'un homme enterré vivant), les interactions sont encore moins probables et les possibilités de la présence d'un allié, restreintes. On octroie tout de même un téléphone cellulaire à la victime pour qu'elle puisse rejoindre des auxiliaires et mousser l'intrigue. L'oeuvre fait vivre des émotions fortes au public, si ce n'est que pour le sentiment de claustrophobie qui s'en dégage dès les premiers instants. Encore dans ces deux derniers cas, la relation du héros avec son interlocuteur, vivant ou non, influence grandement le cours du récit.
I Am Legend, dans lequel le scientifique Robert Neville (Will Smith), seul survivant d'une violente pandémie mondiale, arpente les rues de New York en espérant trouver une solution pour ramener la vie sur Terre, utilise plutôt une webcam, grâce à laquelle il documente ses recherches, et possède un berger allemand, qui le suit dans ses expéditions. Même si une bonne partie de ce film ne met en scène que Smith avec un chien et quelques créatures mi-homme, mi-vampire, mi-zombie, nous en sommes à peine conscient grâce à ce stratagème qui permet au personnage de s'exprimer, de révéler ses émotions et l'avancement de ses découvertes sans briser le quatrième mur ou lui infliger une quelconque maladie mentale qui lui ferait halluciner des interlocuteurs
Into the Wild fait de la solitude, de l'isolement, l'un de ses sujets principaux. Le film raconte l'histoire d'un jeune diplômé (incarné par Emile Hirsch) qui décide du jour au lendemain de tout abandonner et de partir sur la route. Il parcourt plusieurs villes des États-Unis jusqu'au Mexique où il décide de s'éclipser en Alaska. Après deux ans de voyage, de différentes retraites, juste avant de mourir d'un empoisonnement, le protagoniste écrit « Happiness only real when shared » (« Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé »). Voilà peut-être pourquoi les humains dans la réalité et dans les films s'inventent des complices ou s'appuient sur des béquilles pour surmonter la solitude. L'homme est un mammifère de communauté qui peut survivre lorsqu'il est abandonné;, mais pour vivre, c'est une tout autre histoire...