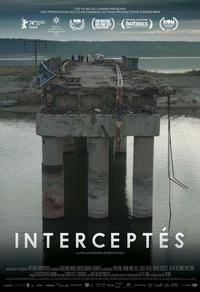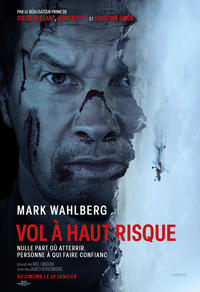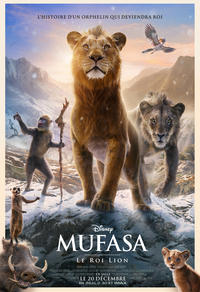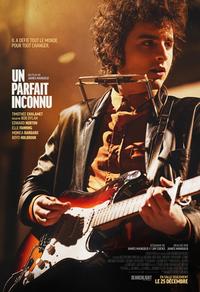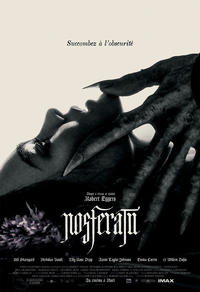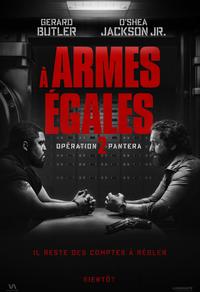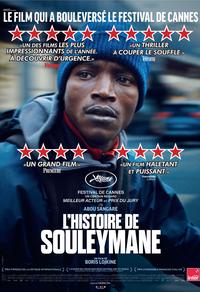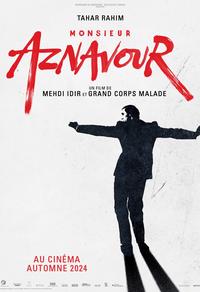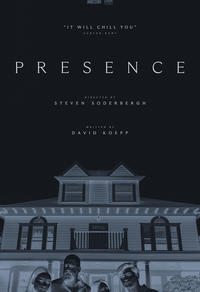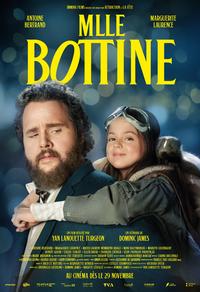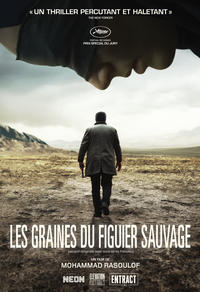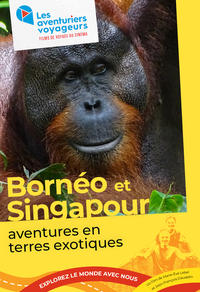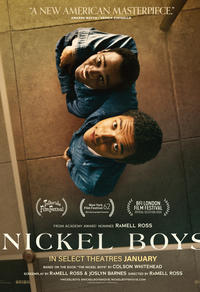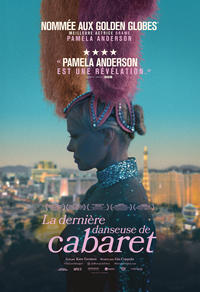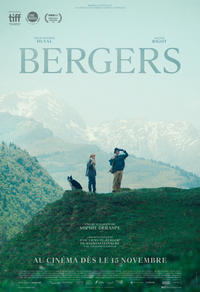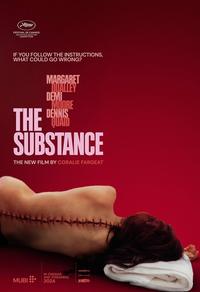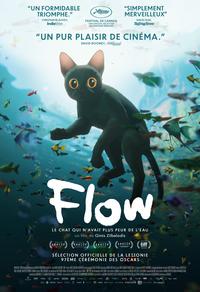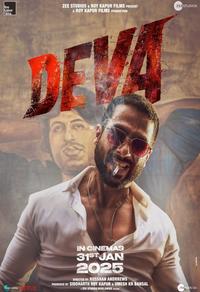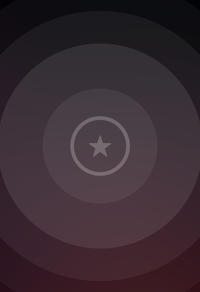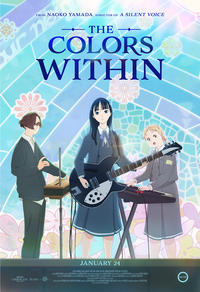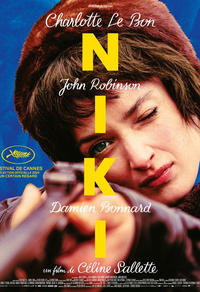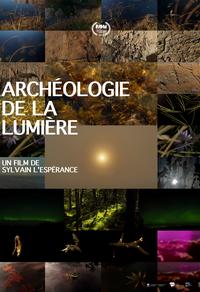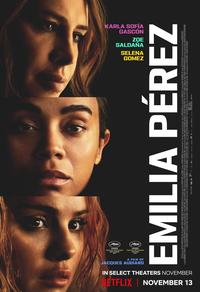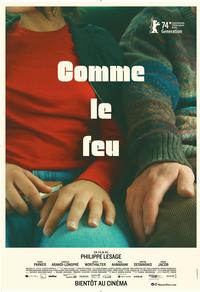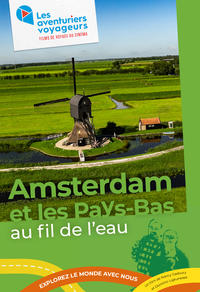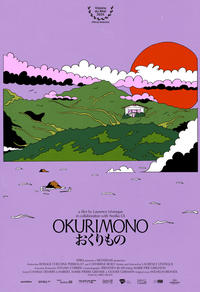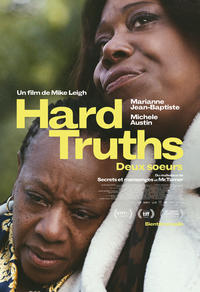Les Films Concordia
Les Films Concordia
Presque tous les critiques de cinéma du Québec étaient réunis au Cinéma Impérial hier midi – tant et si bien que j’ai cru à un certain moment que c’était un piège et qu’on allait barrer les portes et mettre le feu à l’édifice – pour voir nos collègues Martin Bilodeau (Le Devoir), Liam Lacey (The Globe and Mail), Brendan Kelly (The Gazette, Variety), Catherine Perrin (Radio-Canada), Alain Spira (Paris Match) et Marc-André Lussier (La Presse). Du beau monde – en fait, il ne manquait que ces « critiques » spécialisés qui font des analyses dans les revues... les seuls vrais, mais c’est un autre débat – pour parler de la critique, de son avenir et de sa possible évolution.
Si Brendan Kelly a littéralement volé le show avec sa lucidité déconcertante, tous les panélistes ont abordé certains des aspects les plus intéressants du métier de critique et ont noté que l’émergence d’internet avait changé la manière dont le public perçoit notre travail. Une perception qui sera à nouveau faussée par une nouvelle campagne publicitaire qui prétend que « tout le monde peut être critique de cinéma ». Ah bon.
Une période de question pratiquement sans intérêt a prouvé à nouveau que le public souffre d’une méconnaissance profonde des médias et du métier de critique. Même si je suis d’avis, comme un des intervenants, qu’il faut bien connaître « son » critique pour en apprécier le travail, on ne demande pas à un critique de cinéma quel est son film ou son réalisateur préféré. Il y avait sans doute beaucoup d’étudiants à ce panel où planait l’ombre des enseignements de Marcel Jean : internet, c’est bien, mais il faut faire attention (le panel s’est d’ailleurs empêtré dans cette notion, se méprenant entre l’internet blogueur et l’internet comme média diffuseur) et la différence entre « review » et « critic », en anglais, qui a été habilement réfutée par le panel. Dommage, d’ailleurs, car la question, en particulier si on aborde la multiplication médiatique, mérite une attention particulière.
Mais qu’à cela ne tienne, voilà qu’on s’insurge contre les « petites étoiles », qu’un autre intervenant du public va jusqu’à prétendre que si on n’a qu’une ou deux critiques à faire par semaine, il faut éviter les blockbusters qui n’ont pas besoin de la publicité et parler de films plus obscurs qui échappent à l’attention du public. C’est une manière de voir, mais je suis de l’avis contraire : le « nouveau » métier de critique, maintenant où tous les films profitent du don d’ubiquité d’internet et peuvent trouver leur public, n’est pas d’orienter le choix du public, mais bien sa lecture du film. Et le meilleur moyen, c’est de parler des blockbusters, de ces films qui seront vus par le plus grand nombre et qu’on méprendra pour « orignal » et « du jamais vu ».
Des exemples? D’accord. J’ai lu cette semaine, dans deux commentaires du public au sujet de L’œil du mal, que cet ordinateur en forme d’œil qui contrôle tout était directement inspiré du film I, Robot, avec Will Smith, et d’un épisode d’Halloween des Simpson. Quelqu’un a vu 2001?
Non, tout le monde ne peut pas être critique de cinéma, car ce n’est pas l’opinion qui compte mais la lecture. Les critiques ne forment par les goûts du public, et l’exemple de La graine et le mulet – dont j’ai déjà parlé dans un autre éditorial – le prouve : quand les critiques convainquent le public d’aller voir un film, ce dernier en revient frustré, avec le sentiment d’avoir été berné par ces « ratés sympathiques » qui ne comprennent rien.
Mais pour ceux que ça intéresse, ces temps-ci, mon film préféré, c’est Le mépris.