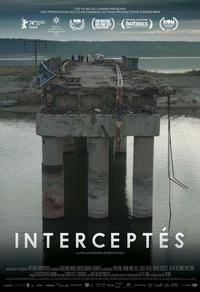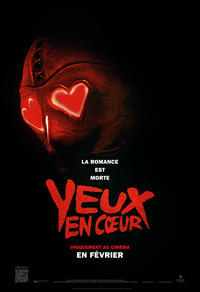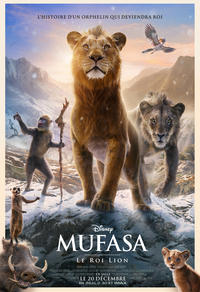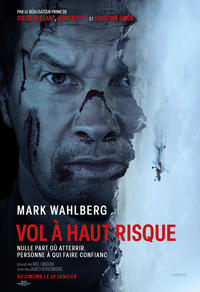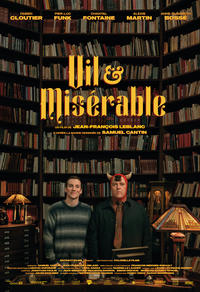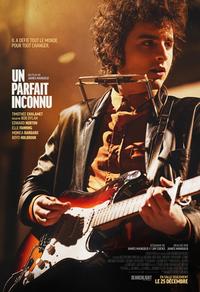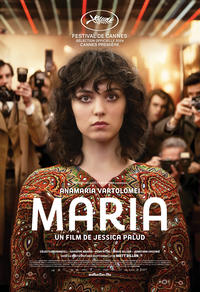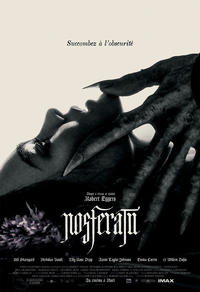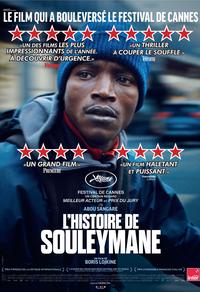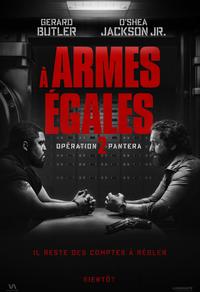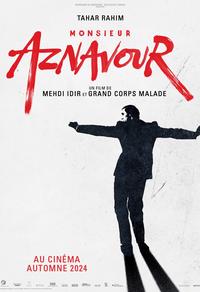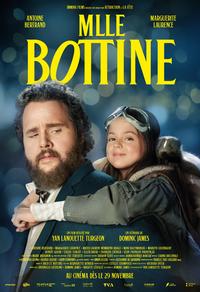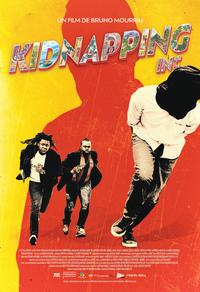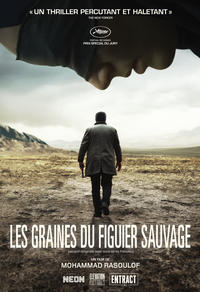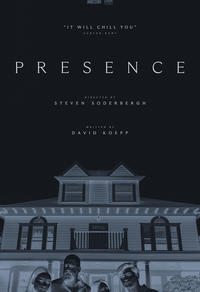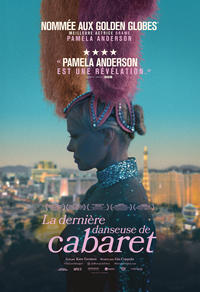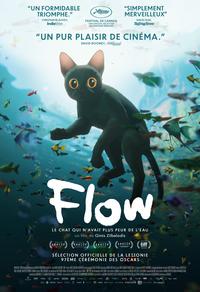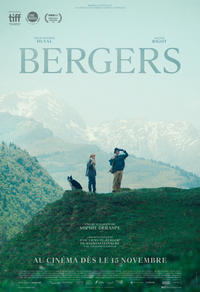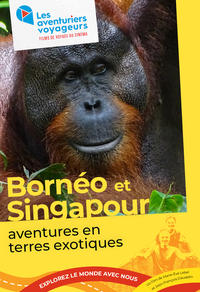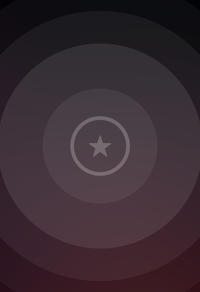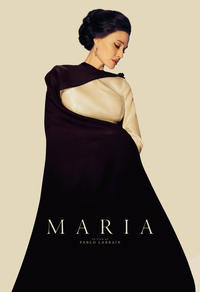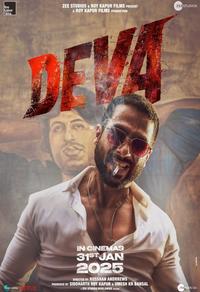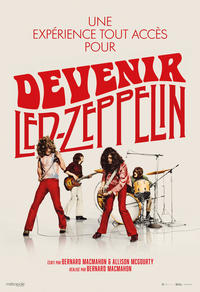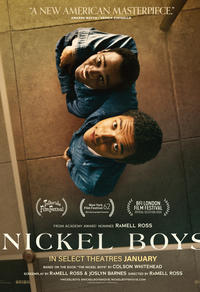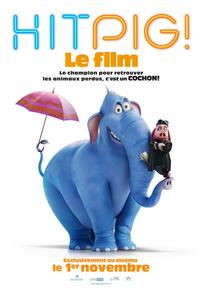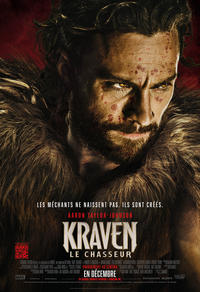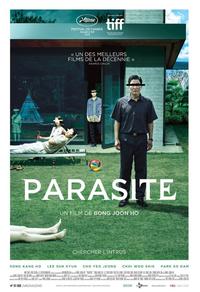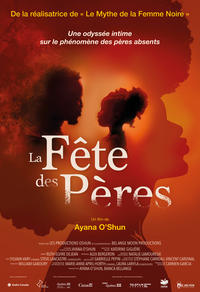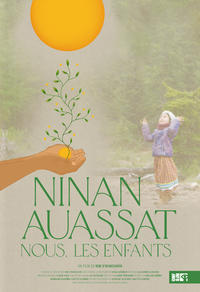J’écrirai une critique plus tard (quand je l’aurai revu), c’est promis, mais en attendant, il faut absolument que je glisse quelques mots à qui voudra bien les entendre sur le troisième film de Sébastien Rose, Le banquet, qui est attendu le 29 août. J’avoue ne pas avoir été son plus fier défenseur lors de la sortie de La vie avec mon père, mais cela est sur le point de changer, les circonstances l’imposent. La pertinence, l’audace et la rigueur de son nouveau film forcent tout simplement l’admiration autant qu’ils forcent les questionnements. Parce que ce sera bientôt la rentrée universitaire et parce que j’ai passé l’été à demander à tout le monde s’il faut absolument être drôle pour attirer l’attention du public et passer un message, Le banquet ne pourrait arriver à un meilleur moment. Un changement de ton bienvenu pour le cinéma québécois, monotone et flagorneur depuis Tout est parfait en février, et plus globalement pour cette société qui n’en a jamais eu autant besoin. En saura-t-elle seulement que faire?
Quand je dis « à qui voudra bien les entendre », je veux surtout dire « à qui pourra bien les entendre ». Parce qu’entre les deux, comme l’illustre si bien le film de Rose, il y a tout un monde que l’institution scolaire semble avoir oublié et qui est la cause directe de ces choquants résultats aux tests de français, de cette perdition généralisée de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. De peur d’avoir l’air prétentieux, on n’ose pas le dire : l’université n’est pas faite pour tout le monde et il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit (la désillusion postmoderne nous l'aura au moins appris). Pas besoin d’être un fin philosophe – comme l’est pourtant Rose – pour se rendre compte qu’on modifie l’orthographe des mots pour s’adapter aux fautes des gens et que les universités deviennent des imprimeries, des photocopieuses à diplômes et pas ce lieu de haut-savoir et d’ébullition intellectuelle que certains de ses professeurs et bien peu de ses étudiants voudraient en faire. C’est le cas de Gilbert Dubois, le personnage central du Banquet, qui n’a tout simplement rien à faire à l’université.
Et il n’est pas le seul, dans cette société québécoise qui admet n’importe qui capable de payer, qui valorise l’effort plutôt que le résultat dans des institutions déficitaires, en terme économique mais aussi en terme de savoir et d’avant-garde. Les universités doivent traîner le peuple sur leurs épaules, pas ralentir pour le laisser gagner et qu’il veuille rejouer, dira Rose, dans un film qui va au-delà de qualités cinématographiques et qui parle plutôt de responsabilité sociale; qui prend, en fait, les responsabilités sociales que le cinéma devrait toujours prendre.
Si ça intéresse quelqu’un (et même si ça ne convainc personne), je suis du même avis : cette université grandiloquente qui se prend pour une autre, tout particulièrement en études cinématographiques, offre de la culture générale à rabais. Une culture encadrée, formalisée, présomptueuse parfois, qui oublie parfois le caractère intrinsèquement populaire du cinéma. Le cinéma, c’est de la sociologie, un laboratoire social qui n'est pas utile lorsqu'il n'est pas diffusé, qui permet aussi d’inscrire dans la culture populaire des manières de faire et de penser si convaincantes qu’elles se sont retournées contre lui; et voilà que le spectateur n’aime pas un acteur jusqu’à trouver qu’il joue mal parce que son personnage est méchant, qu’il n’aime pas un film parce qu’il n’en sort pas rassuré dans ses convictions profondes.
Formellement, l’université se borne encore à juger de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas – suivre ou ne pas suivre le plan de cours, telle est la question! – mais cela n’aura jamais été aussi grave que si le public qui ira voir Le banquet, espérons en très grand nombre, se méprenne sur l’efficacité du film. Un film qui remue, un film qui frappe sans surenchérir inutilement sur l’émotion, un film sérieux, c’est rare et très précieux de nos jours. Beaucoup plus qu’un bacc.