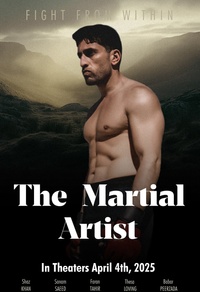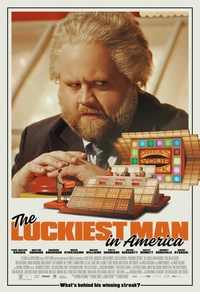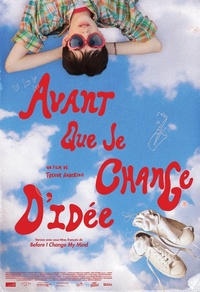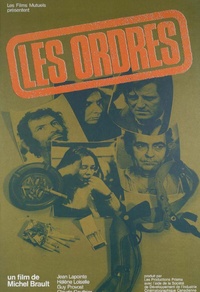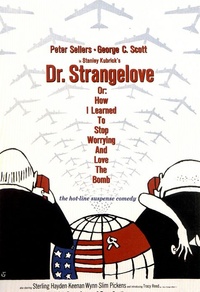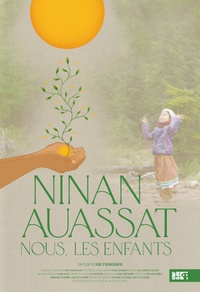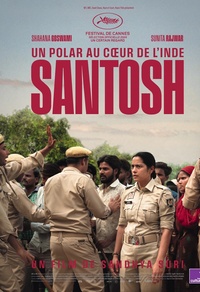Le long métrage Émilie, qui a pris l'affiche hier, fait partie d'un concept beaucoup plus large dont la colonne vertébrale est une websérie diffusée sur le site de Radio-Canada (et réalisée par Jean-Christophe Yacono). Profitant du média pour exploiter de nouvelles avenues d'interactivité, la série propose au spectateur non seulement le classique « choix » - à la manière d'un livre dont vous êtes le héros - mais aussi d'appeler les personnages au téléphone pour les sortir d'une situation fâcheuse ou les aider dans leur quête, de recevoir des infos par courriel ou par texto (en plus d'un placement de produit presque indécent). Si ces idées ne sont pas toutes au point - le regard-caméra et l'interpellation du spectateur finissent par devenir agaçants -, on y trouve une belle créativité qui permet de raconter différemment une histoire conventionnelle en plus d'une belle démonstration technique.
Le long métrage dérivé de cette websérie a donc pris l'affiche dans huit salles à travers le Québec hier. Réalisé par Guillaume Lonergan, le film unit les quatre histoires sous une seule trame. Or, les qualités présentes dans la websérie ne se retrouvent pas nécessairement dans le film, comme en fait foi notre critique.
Il découle donc de ce concept une question fondamentale au cinéma qui, par définition, s'inspire des autres arts et des autres médias (nous en parlions dans cet Hebdo, sur le passage du petit au grand écran, et dans cet autre Hebdo qui abordait le cas des adaptations littéraires, ou dans celui-ci, qui s'intéressait aussi au transmédia) : de la même manière qu'une installation muséale et urbaine, un geste signifiant ou un contexte peuvent former l'oeuvre d'art davantage que l'artisanat qui a fabriqué l'objet exposé, doit-on considérer Émilie comme un long métrage autonome ou comme une partie d'un tout?
Car, par définition, les deux médias sont différents en durée, en ampleur, et dans ce cas-ci, spécifiquement en interactivité. Ce qui est raconté sur internet de manière créative et imprévisible, à l'aide d'un téléphone cellulaire par exemple, devient au cinéma bien plus figé et « limité » par la lourdeur d'un média qui, s'il s'est allégé depuis le passage au numérique, demeure « projeté » dans un contexte particulièrement balisé (et institutionnalisé). Mardi soir, lors de la première d'Émilie justement, l'animateur de la soirée Philippe Fehmiu (qui s'est présenté comme un animateur... de radio) a demandé aux spectateurs de mettre leur téléphone en mode vibration...
La nuance importante est que le cinéma est un média qui se consomme collectivement, alors qu'une websérie se regarde individuellement. Il est donc immanquable que des différences surviennent, sans que ce ne soit un problème véritable; le problème serait de concevoir pour un média et de le diffuser sur un autre, sans adapter, de la façon dont on adapte un livre en scénario pour le tourner.
Mais les qualités d'une partie d'une oeuvre influencent-ils les défauts d'une autre? Quelle est la responsabilité du spectateur, qui représente l'étape finale du processus de communication? Doit-il avoir vu tous les épisodes de la websérie avant de voir le film? Ou alors, le film doit-il plutôt faciliter la compréhension en expliquant à nouveau le contexte?
Les exemples littéraires sont aussi nombreux; des adaptations de Twilight, Harry Potter et Hunger Games (pour ne citer que ceux-là), soulèvent une question similaire : le film est-il « meilleur » ou « moins bon » que le livre, ou est-il simplement différent? Lorsqu'un spectateur qui n'a pas lu le livre soulève une incongruité, doit-on évoquer que le livre (souvent plus détaillé) abordait le sujet? Est-ce la responsabilité du non-lecteur, ou du film? Et on n'a pas encore parlé des séries télé, bandes-dessinées et faits divers dans les journaux...
Dans un monde idéal, bien sûr, il faudrait tout lire, tout regarder, mais même si on en venait à dire, par souci de professionnalisme ou simplement pour sa culture générale, qu'il faudrait avoir lu tous les livres dont on fait des adaptations au cinéma, dira-t-on la même chose des jeux vidéos, par exemple?
Il est bien sûr impossible de tout lire, de tout voir et de tout savoir des références ou des sources utilisées par le cinéma comme matériau de base, le corpus étant trop inhumainement imposant. Alors? Alors le concept de culture, tel que défini par le sociologue Guy Rocher (qui parle « d'un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte », donc de l'ensemble des connaissances socialement partagées par une société donnée) permet à un observateur inscrit dans sa société d'obtenir la légitimité de commenter les oeuvres qu'il consomme.
Cette semaine, le cas d'Émilie souligne simplement les distinctions nécessaires entre les médias, tout particulièrement en ce qui concerne ce qu'on appelle encore « les nouveaux médias » et les médias dits « établis ». Il ne remet pas en doute la nécessité pour les films d'être des oeuvres autonomes, mûes par une cohérence interne.