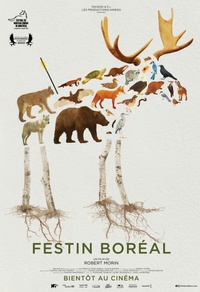Il y a une dizaine de jours, le collègue de la presse anglophone Brendan Kelly (un fier francophile et partisan aveugle du Canadien, pour ceux qui seraient tenté de douter de son allégeance et de son amour pour le cinéma d'ici), abordait dans un article la « crise » du cinéma québécois, expliquant, de manière un peu alarmiste, que l'année 2013 était même « pire » que 2012, qui était déjà la pire depuis 2000 concernant les parts de marché des films québécois (4,8 % du box-office).
La semaine dernière, c'était au tour d'Helen Faradji, par la voie du 24imag, de répondre à l'attaque formulée par Kelly envers Chloé Robichaud et Sarah préfère la course, qu'il cite en exemple, et de souligner la faute partagée par le manque de curiosité des spectateurs et les films eux-mêmes dans cette « crise ». Alors que Louis Cyr : L'homme le plus fort du monde continue de bien performer au box-office (2 368 614 $ en date de jeudi), il convient de proposer une nouvelle piste de réflexion.
Car c'est autour de ce film que les deux textes illustrent leur propos et c'est pourtant autour de ce film qu'ils ont en partie tort tous les deux : les 150 000 $ amassés par Sarah préfère la course depuis sa sortie le 7 juin sont impressionnants, quoi qu'on en dise. Les producteurs et le distibuteur auraient-ils souhaité davantage? Bien sûr, on espère toujours davantage. Mais la réalité c'est que bien peu de films québécois peuvent espérer amasser 100 000 $ au box-office, et qu'à chaque fois il faudrait s'en réjouir. Car le long métrage, cannois ou pas, n'est pas pour tout le monde, et c'est normal.
De la même manière, le 400 000 $ amassés par Laurence Anyways l'an dernier ne sont pas « décevants »; un film de 2h45, qui met en vedette un homme qui décide de s'habiller en femme, ne peut pas espérer davantage (l'erreur, c'est que le film ait coûté près de 8 millions $ !!!). C'est une simple réalité qui n'a rien à voir avec la qualité du film, idem pour Sarah préfère la course. C'est là où Faradji, dans son texte, voit juste : l'éducation cinématographique déficiente des spectateurs empêche un contact plus large entre les films québécois d'auteur et le public; mais c'était déjà un problème en 2005, et ce n'est pas quelque chose qui puisse être corrigé rapidement et facilement. Pas avant, du moins, que la panique liée à cette « crise » ne cause une vague de crises cardiaques dans le milieu...
Le problème du cinéma québécois depuis quelques temps en est un d'image de marque. De « branding », si vous préférez. Pendant les quelques années (entre 2002 et 2006) où le cinéma québécois a connu ses plus hauts sommets (18,2% de parts de marché en 2005), le public était séduit par l'idée de voir un film « québécois ». Parce que la qualité globale était au rendez-vous, et ce depuis un certain temps. Pas qu'il n'y avait pas d'échecs, monétaires ou artistiques, mais qu'ils étaient rapidement identifiés et oubliés. La marque n'en souffrait pas trop. Comme lorque Apple (probablement l'entreprise qui gère le mieux son image de marque) a sorti son application Plans; on a reconnu l'échec rapidement et la marque n'a pas souffert.
Bien sûr, comme pour toutes les marques, l'accumulation d'erreurs et surtout le refus de les identifier peut mener à une perte de confiance du public. Même si le nouveau Blackberry Z10 (qui ne commandite pas cet Hebdo, en passant) était un excellent appareil, la valeur associée à la marque « Blackberry » rebuterait de nombreux consommateurs qui préféreront aller voir ailleurs. Depuis quelques temps, on n'associe plus le cinéma québécois, qui est perçu dans la population comme un bloc assez homogène (un problème que rencontrent plusieurs marques), à ses réussites mais à ses échecs, à ses films d'auteur qui s'opposeraient à son cinéma commercial; en réalité, même les « auteurs » souhaitent rejoindre le public. Le défi de l'industrie cinématographique sera donc d'améliorer la valeur de la marque « québécoise » afin que le spectateur, celui qui doit payer son billet, ait confiance de voir un film de qualité d'en avoir pour son argent, quels que soient ses goûts.
Il y a autant de préférences que de spectateurs et bien peu sont enclins à en discuter (même si l'expression consacrée « Les goûts ne se discutent pas » est une aberration). Le spectateur cherche donc conseil, il cherche un endossement d'une personne de confiance : ses amis, sa famille, des leaders d'opinion et, à une certaine époque, les critiques de cinéma et les médias, qui partagent une partie de la faute.
Les médias, c'est aussi la publicité (la critique fait d'ailleurs partie, qu'elle le veuille ou non, de cette mécanique), et le public, qu'on tente de manipuler en lui faisant croire que tous les films québécois sont dignes d'être vus (en retweetant les compliments, en excluant les voix négatives - qui se taisent souvent d'elles même - en misant sur des vedettes et des vox pop, etc.), n'est pas dupe : il sait quand il aime et il sait quand il n'aime pas, et il sait quand on se moque de lui. D'autant qu'en 2005, les sorties québécoises étaient plus fréquentes tout au long de l'année, ce qui permettait de rejoindre une plus grande diversité de cinéphiles et d'établir la marque. Aller voir des films québécois, comme aller chez Métro, Loblaws, Maxi ou Provigo, c'est une habitude...
En clair : parce qu'on n'a pas le regard sur soi-même assez humble pour admettre les échecs des films québécois, parce qu'on tente d'embellir la réalité (et la faute va en partie à une critique souvent complaisante et à une mise en marché qui nie ses mauvais coups), les opinions ne sont plus crédibles, le public n'y croit plus et s'intéresse à autre chose. Même lorsque le produit est excellent, le lien de confiance est brisé. À noter qu'on aborde les films comme des produits de consommation dans ce texte puisque la « crise » existe sur des bases économiques mais que bien d'autres facteurs peuvent en déterminer la qualité et/ou la réussite.
Des échecs peuvent survenir, ils sont même inévitables, là n'est pas la question. Il sera cependant de la responsabilité des médias et des responsables (distributeurs, institutions) de les reconnaître, de les identifier honnêtement et de ne pas traiter différemment les films québécois de tous les autres films qui prennent l'affiche et qui lui font une compétition féroce. Quand le spectateur choisit, lui, il ne fait pas la distinction.
Il y aura des « bons » films québécois et des mauvais. Dans la critique du Poil de la bête, en septembre 2010, on disait, prophétiquement : « S'il a fallu se battre pendant des années pour convaincre tout le monde que « ce n'est pas parce que c'est québécois que c'est mauvais », il ne faut pas oublier qu'on a du même coup expliqué que « ce n'est pas parce que c'est québécois que c'est bon. » De toute façon, dans ce qui est aujourd'hui le « cinéma québécois », ce qu'on aime ce n'est pas le « québécois », mais le « cinéma ». Et comme l'effort, les bonnes intentions et le peu de moyens ne sont pas des excuses valables, il faut consacrer l'échec de ce Poil de la bête. Voilà aussi un signe de maturité pour une cinématographie en santé. »
Il faudra du temps pour rétablir le lien de confiance avec le public québécois. Entre temps, il y a un problème plus pressant : tous ces films qui attendent l'automne pour prendre l'affiche, espérant l'appel d'un festival prestigieux, et qui finissent par se nuire. Vous verrez, comme en 2011, on y est presque...