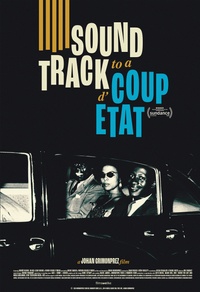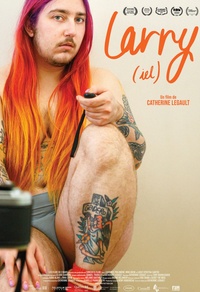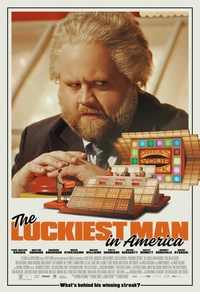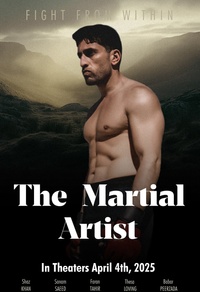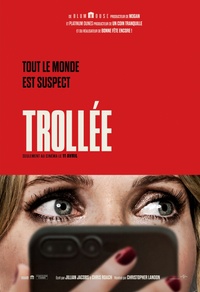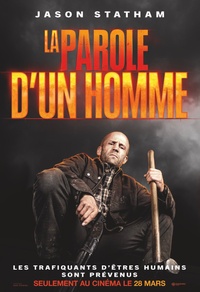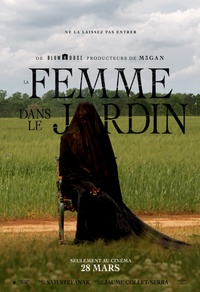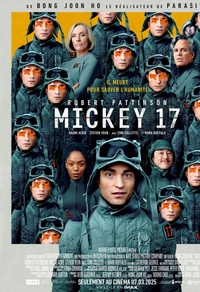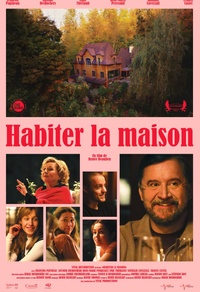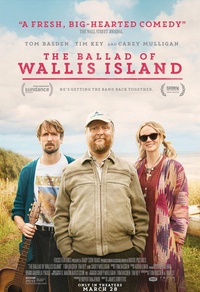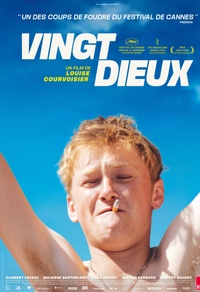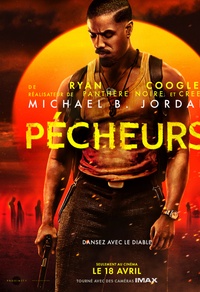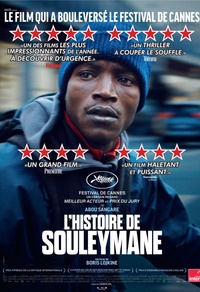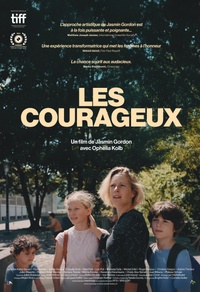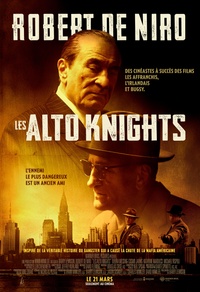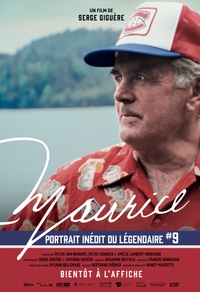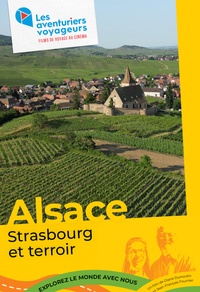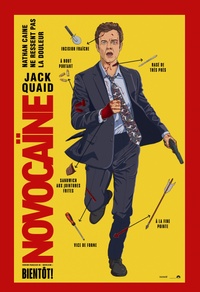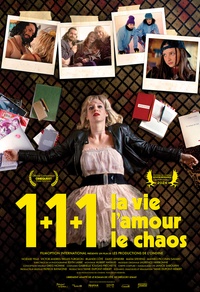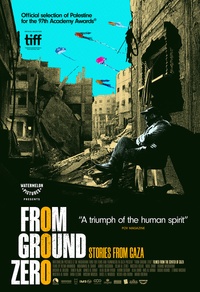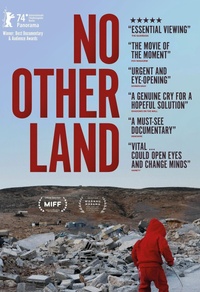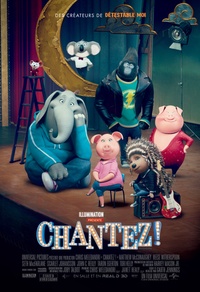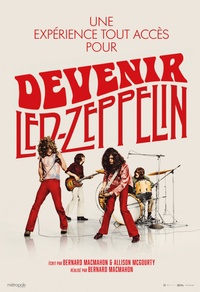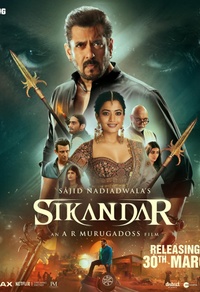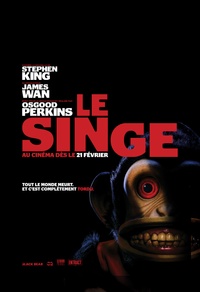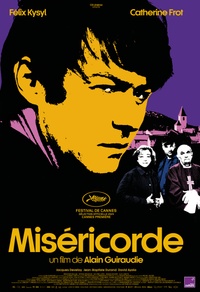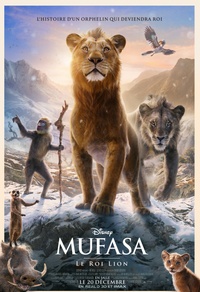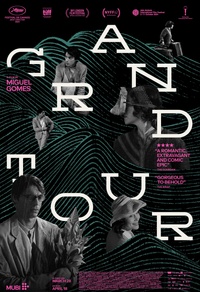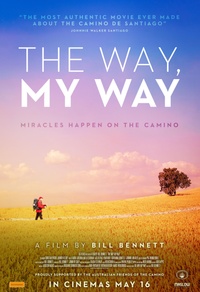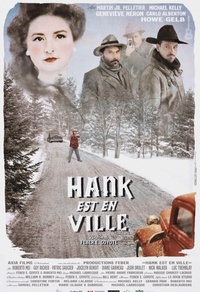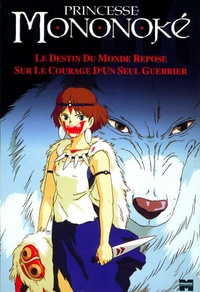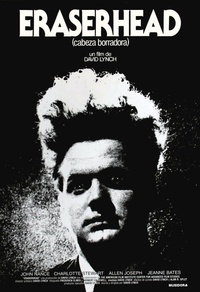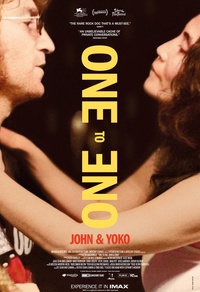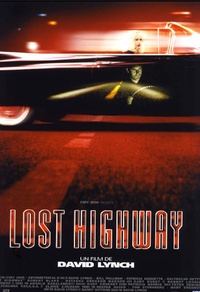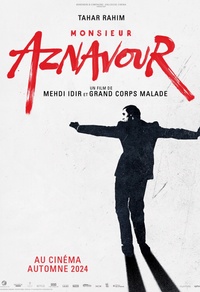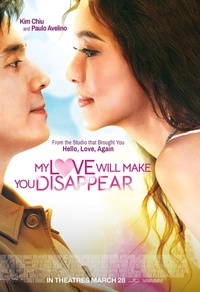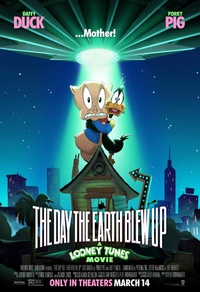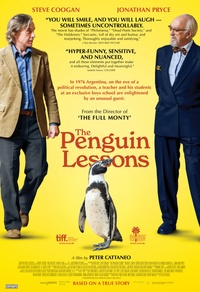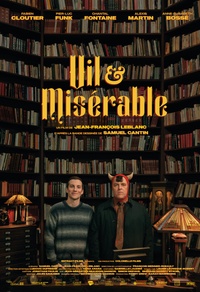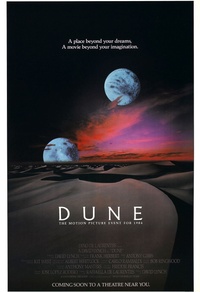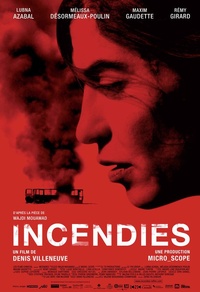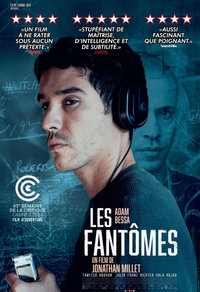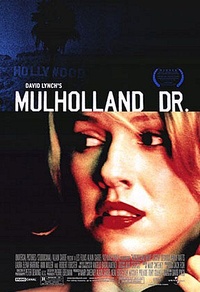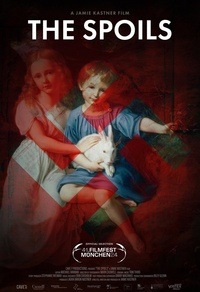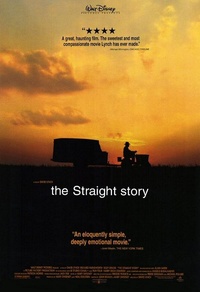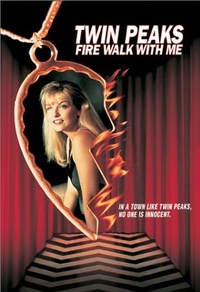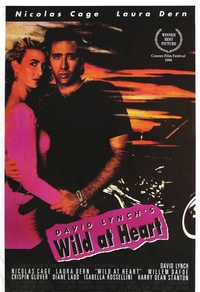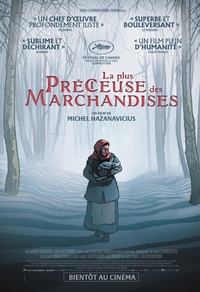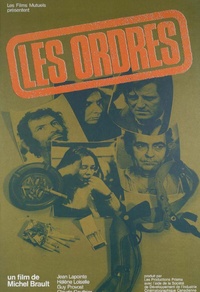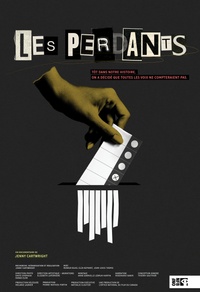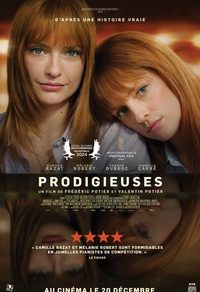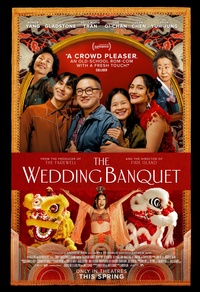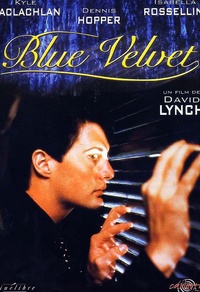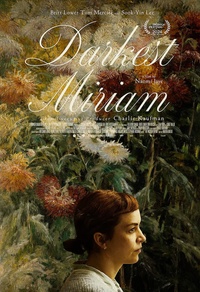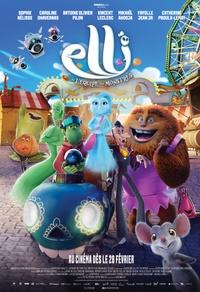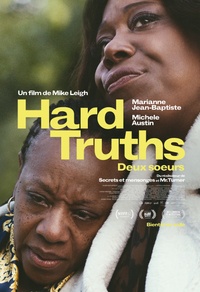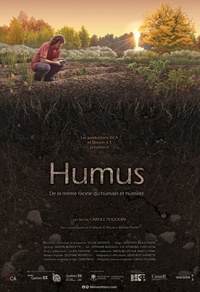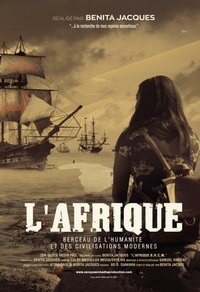Si vous êtes un habitué, vous avez sans doute remarqué qu'on vous parle souvent dans nos critiques de la qualité ou de l'efficacité du 3D. Ah! La troisième dimension... Nouvelle mode, lubie des studios ou avancée technologique significative? La réponse change souvent selon le film que l'on regarde. La réponse risque aussi de changer selon que le film a été tourné et monté en 3D, ou s'il a été converti après le tournage pour profiter de la manne et récolter quelques dollars de plus (aux dernières nouvelles, un supplément de 3 $ était exigé en moyenne pour un film en 3D, par rapport à sa version 2D).
Si vous êtes fin observateur, vous remarquerez que je n'en glisse pas un mot dans ma critique de The Wolverine (à lire ici), qui prend l'affiche cette semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que le 3D a rarement été aussi inutile. Même si j'ai porté les fameuses lunettes 3D pendant tout le film, par-dessus mes propres lunettes pour la vue (c'est très inconfortable, croyez-moi), j'avais oublié que je regardais un long métrage en 3D une fois la projection terminée. Ce qui mène à une question de plus en plus d'actualité : le 3D, qu'ossa donne?
L'objectif des salles de cinéma (donc du 3D, mais aussi du son, des sièges, etc.), est d'être le plus immersif possible; au début, la mode était - surtout dans les films d'horreur - à lancer vers l'écran des objets pointus pour que les spectateurs agissent par réflexe et essaient de les éviter (les projectiles fluides étaient aussi récurrents), comme si on voulait délimiter les possibilités de ce nouveau procédé, en établir les limites (en les franchissant, en sortant de l'écran) et démontrer ses possibilités. Il y a là un parallèle à faire avec les débuts des effets spéciaux et de l'animation par ordinateur, vers le milieu des années 90; oui, des films ont utilisé la technologie pour raconter de « meilleures » histoires, mais beaucoup misaient sur l'aspect nouveauté, l'idée de faire mieux techniquement que le film précédent. On peut même y voir un parallèle avec les premiers balbutiements du cinéma, alors que l'idée d'une mécanique qui permettrait de faire bouger des images était plus intéressante pour les spectateurs que les images elles-mêmes.
En novembre 2010, Élizabeth abordait le même sujet dans un Hebdo intitulé « La magie nécessite-t-elle le 3D? ». Depuis, les choses ont changé, mais pas tant que ça : la transformation des projecteurs 35mm en équipement numérique est pour ainsi dire complétée (une projection numérique est nécessaire pour présenter un film en 3D¹) et le procédé est mieux connu et plus fréquent. Il n'est cependant pas plus populaire.
Des exemples comme Avatar, qui reste le fleuron dans le domaine, sont bien loin, tant et si bien que la question du 3D et de sa surcharge est appelée à refaire surface. La curiosité de voir une nouvelle technologie qui n'offrirait rien de véritablement innovateur s'efface peu à peu. Prenons par exemple le cas d'Alice in Wonderland. Sorti en mars 2010 (donc en plein coeur de la mode 3D), le film avait amassé 116,1 millions $ lors de sa sortie, pour un total de 334,1 millions $ en Amérique du Nord; il s'agit à ce jour du septième film en 3D le plus rentable de tous les temps, du deuxième film le plus rentable de l'année dernière Toy Story 3, qui était aussi en 3D. Deux ans et demi plus tard, Tim Burton présentait son nouveau film, Frankenweenie, aussi offert en 3D dans presque autant de salles (3728 pour le premier, 3005 pour le second), qui n'amassera finalement que 35,3 millions $ au total.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet écart entre les films : la date de sortie, la qualité, la campagne de promotion et la compétition directe, mais il faut avouer que la différence est frappante. Examinons donc le cas des films Shrek Forever After, sorti le 21 mai 2010, et Kung Fu Panda 2, sorti un an plus tard. Il s'agit de deux films s'adressant à des publics similaires sortis à la même période de l'année. En 2010, le quatrième opus de la franchise Shrek a récolté 70,8 millions $ lors de son premier week-end; 61% de cette somme provenant de projections en 3D, selon BoxOfficeMojo. Toujours selon le même site, Kung Fu Panda 2 a amassé 47,7 millions $ lors de son premier week-end, dont 45% était tiré de projections en 3D.
En 2012, au cours du même mois de mai, 52% du montant amassé par The Avengers l'a été lors de projections 3D. Un an plus tard, en 2013, Iron Man 3 amassait 174,1 millions $ lors de son premier week-end, mais seulement 45% provenant de projections 3D.
Les propriétaires de salles et les distributeurs savaient dès le départ qu'ils ne pourraient pas appliquer une surcharge pour toutes les projections 3D indéfiniment, la technologie perdant peu à peu de sa nouveauté (on n'imaginerait pas, par exemple, payer un surplus pour voir un film en couleurs). Il semble de plus en plus que cette pratique s'éliminera d'elle-même prochainement par la force des choses, surtout si les longs métrages continuent d'être si souvent peu adaptés à l'idée de 3D. Surtout que le procédé n'ajoute rien aux histoires, et que ce sont elles qui marquent les mémoires, pas le nombre de javelots qu'on aura reçus en plein visage.
Ce n'est qu'en postproduction, en octobre 2012 (donc près de quatre mois après le début du tournage) qu'on a décidé chez la 20th Century Fox de convertir The Wolverine en 3D. Les raisons qui justifient cette décision ne sont pas visibles à l'écran. La question est maintenant de savoir s'ils le seront dans les coffres, et combien de temps encore les spectateurs accepteront de payer une surcharge pour voir un film en 3D.
¹ Technicolor avait tenté de proposer aux propriétaires de salles une lentille capable de projeter en 3D à partir d'une pellicule 35mm, mais n'a pas réussi à l'implanter à grande échelle. Certains films en pellicule IMAX 70mm sont aussi projetés en 3D.