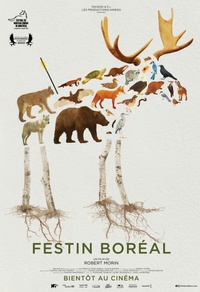À force de faire des films qui remportent beaucoup de succès en festivals mais qui sont trop peu vus à la maison, la tentation - ou la pression - peut être forte de mettre un peu d'eau dans son vin afin de rendre plus accessible son univers. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi tant que la singularité du créateur est toujours là. Rafaël Ouellet l'a fait sur Camion, Maxime Giroux avec Félix et Meira et l'on se demande si ce sera un jour le cas de l'intraitable Denis Côté. Boris sans Béatrice annonce d'ailleurs un pas dans cette direction dans sa façon de simplifier ses enjeux usuels.
En regardant sommairement, rien n'a vraiment changé dans les histoires que le cinéaste québécois raconte depuis déjà plus d'une décennie. Il y a toujours un héros qui cherche à se connecter aux autres pendant que la société s'écroule, un grand sentiment de solitude, des personnages aux physiques atypiques, un inconnu qui vient chambouler une quiétude fragile, etc. Le ton alterne constamment entre le drame et la comédie et on peut cette fois tout interpréter comme un rêve hanté de fantômes d'un disciple de Scrooge. Celui de l'orgueilleux Boris (James Hyndman) qui doit apprendre à devenir une meilleure personne devant la maladie mystérieuse de son épouse Béatrice (Simone-Élise Girard) et dont les clés de son succès résident dans sa propre tête.
Le ton de satire peut rappeler Bunuel et le magistral Teorema de Pasolini, sans toutefois atteindre le même degré de maestria. La bourgeoisie n'est pas épargnée et avec elle monsieur et madame tout le monde qui se prennent pour des dieux et des déesses. Une connotation renforcée par toutes ces allusions à la mythologie grecque. Il y en a tellement que le manque de subtilité devient flagrant. On finit par les oublier grâce aux nombreuses surprises qui ponctuent le récit, ses rebondissements imprévisibles, les apparitions furtives de Denis Lavant (l'acteur fétiche de Leos Carax) qui semble sortir d'un cauchemar de David Lynch et celle du roi du cinéma indépendant gai Bruce LaBruce dans le rôle du Premier ministre du Canada!
Ce sentiment de farce finit par décaler ce qui arrive et tromper du coup l'émotion. Est-ce que la quête de rédemption du protagoniste afin de se faire aimer de son amoureuse, de sa fille et de sa mère est sincère comme chez Bernard Émond ou il ne s'agit que d'une autre ironie qui se moque de ce sujet éprouvé? À force de douter, rien n'est impossible. Peu importe les véritables raisons et motivations, les interprétations sont multiples et le plaisir palpable. À condition seulement de ne pas trop élaborer sur le rôle misogyne de la femme (autant l'épouse que l'amante et la domestique) et de ne pas s'attendre aux mêmes qualités scénaristiques que les supérieurs Curling et Vic + Flo ont vu un ours.
Mieux vaut plutôt admirer la magnifique réalisation, une des plus maîtrisées de la carrière de Côté. La première scène avec l'herbe et l'hélicoptère donne rapidement le ton et une grande minutie a été apportée aux cadrages, à cette façon de cacher les individus et de les révéler progressivement. L'homme derrière l'étonnant Nos vies privées utilise d'ailleurs le retour dans le temps pour la première fois de sa filmographie, y insufflant des couleurs et une mobilité différentes. La théâtralité de toute cette entreprise ne tarde toutefois pas à émaner, donnant une nouvelle dimension aux mots qui peuvent alourdir certaines situations. C'est le cas également de la musique de Ghislain Poirier, redondante à ses heures.
Porté par un impressionnant James Hyndman qui fait enfin son retour au cinéma par la grande porte, Boris sans Béatrice intrigue et déroute tout à la fois. Souvent trop écrite, l'oeuvre n'est pas la meilleure de son auteur, qui se surpasse cependant au niveau de la mise en scène. Il s'agit pourtant d'une intéressante initiation à l'univers unique de Denis Côté, à son chaos parfois froid et cérébral qui finit par imprégner le cinéphile et lui laisser une grande impression.