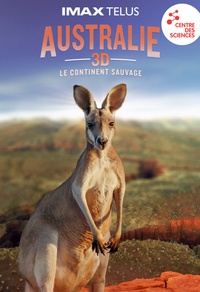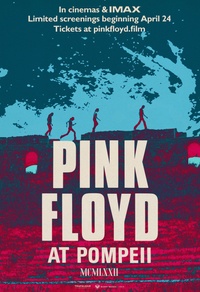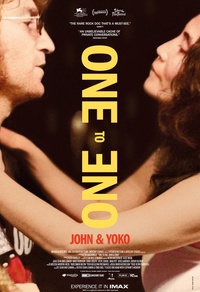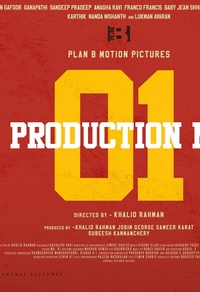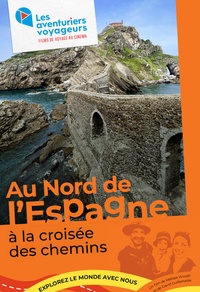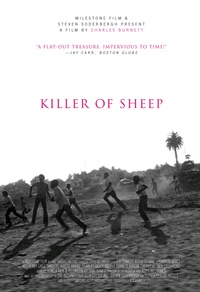La plupart des films suivent la même courbe narrative : un personnage, sa quête, ses embûches, le climax et enfin, la résolution de la quête principale. Dans le cas des films de science-fiction, les héros doivent empêcher une menace externe d'affecter le destin de l'humanité, dans le cas des comédies sentimentales, le héros doit trouver l'amour. Avec la sortie de Casse-tête chinois, c'est la quête identitaire de Xavier qui connaît sa conclusion. Après trois films narrés au « je », Xavier referme le livre. Après le coloré et éclectique chapitre de L'auberge espagnole et le plus sage, mais toujours vibrant Les poupées russes, Klapisch propose une troisième résolution, plus ou moins claire, à son personnage. Comme quoi, le destin n'est pas une chose fixe, même si le cinéma voudrait bien nous le faire croire.
Cependant, avec toutes ces suites qui pullulent à Hollywood - et si on exclut l'intérêt mercantile à la base même du système des franchises - on dirait que l'on a enfin compris au pays des paillettes que, dans la réalité, rien ne finit jamais : tout se recycle à l'infini. Malheureusement pour nous, pauvres spectateurs. Ironiquement, Hollywood a pris des décennies à comprendre qu'une fin ouverte pouvait être intéressante et paver la voie à l'imaginaire. Là où le système des studios n'a cependant pas assimilé le concept, c'est que la beauté d'une fin ouverte réside justement dans le fait qu'elle ne nécessite pas de réponse... Dieu merci, il reste encore, dans le cinéma commercial, des Christopher Nolan pour résister à l'envie de tout dire.
On lui doit d'ailleurs l'un des meilleurs films, focalisé sur la quête identitaire d'un héros et narré au « je ». Avec sa ligne narrative brisée et anachronique, Memento a créé une véritable commotion cinématographique et a rappelé aux cinéastes en tous genres que le médium est aussi mouvant et polyvalent que l'être humain qui l'utilise. Dans Memento, Nolan démontre que, même pour Leonard Shelby (Guy Pearce), la destinée, ce que l'on devient, est une question de choix. Cette leçon n'est en bout de ligne servie qu'au spectateur, puisque Leonard aura choisi d'oublier ce qu'il a fait pour continuer à donner un sens à sa vie, pour mener sa quête à perpétuité. Cette absurdité, toute camusienne, le porte à l'action, mais ce sont en fait ses choix, lors d'un moment-clé, qui déterminent la personne qu'il est devenu et qui déterminent qu'il n'évoluera plus jamais. Pas de résolution pour Leonard, sa quête sera sans fin. Il est au purgatoire.
Cette quête identitaire au scénario vient en général du fait que les personnages semblent, au début de l'histoire, flotter dans leur existence, sans trouver leur place dans le monde, ou alors souffrent d'un enlisement dans lequel leur personnalité s'est dissipée avec le temps. C'est un sentiment que tous ressentent à un moment ou un autre de son existence. Le besoin de se définir devient donc primordial, que ce soit à l'adolescence (C.R.A.Z.Y., The Name of the Rose), au début de l'âge adulte (Trainspotting, Muriel's Wedding, L'auberge espagnole) ou lors de moments charnières comme le début de la trentaine (Bridget Jones's Diary, Limitless, Les poupées russes) ou la crise de la quarantaine (American Beauty, Casse-tête chinois). Cette découverte, intime, doit se faire par le dur apprentissage de leçons de vies où chaque choix entraîne des conséquences que les protagonistes doivent apprendre à gérer. Comme chaque âge a ses défis propres, le « qui suis-je? » ne trouvera pas les mêmes réponses si on s'adresse à un public adolescent ou à un public mature.
Mais si ces films mettent en scène un questionnement universel, la plupart échouent à se démarquer et à marquer. Tout y est un peu comme dans la vie, à la différence que dans la plupart, une fois les leçons apprises, le personnage trouve « sa vérité » et redevient inerte. Après tout, lorsque le film répond par une finale concrète à la question identitaire du personnage, il le confine à un cadre statique prédéterminé. En quelque sorte, il réduit l'être fictif vivant et complexe en un cliché amorphe et linéaire. C'est là toute la difficulté de faire des films sur la quête identitaire qui soient marquants et intemporels. Car seuls les films qui permettent à leurs héros de vivre au-delà de l'histoire proposée arrivent à bien mettre en scène la vie. Car cette dernière ne cesse de nous en apprendre sur nous-mêmes. Pour réussir à marquer, l'histoire doit, via l'identification au personnage, enseigner quelque chose au spectateur. Ce dernier doit ressortir du film en ayant appris sur lui-même, mais aussi avec les questionnements nécessaires pour continuer son cheminement.
C'est peut-être pour favoriser cette identification que beaucoup de ces films utilisent la narration à la première personne. Pour focaliser la quête, la personnifier. Ce qui, dans d'autres genres, s'avère particulièrement agaçant, trouve ici une justification. Très littéraire comme procédé, la narration fait ici office de journal intime. Elle est même parfois dédoublée, c'est-à-dire qu'on la met en scène à l'intérieur du récit, quand par exemple on voit le héros mettre par écrit ses pensées que l'on entend également en voix off (trilogie de Klapisch). Et comme l'identité fait partie intégrante de la psychée d'une personne, on n'arrive pas à se passer de narration pour entrer dans la tête des personnages.
Au final, c'est l'usage de cette narration, sa temporalité ou sa mise en contexte qui permet à certains grands films de se distinguer. Dans American Beauty, la narration est dans une temporalité indéfinie puisque c'est un mort qui parle. Dans The Name of the Rose, c'est un homme vieux moine mourant du Moyen-Âge dont la voix, tout droit sortie de ses mémoires, relate les moments marquants de sa jeunesse, alors qu'il était l'apprenti d'un être singulier pour son époque. Quant à Memento, c'est plutôt le contenu de la narration, son côté décousu et la place de l'anecdote de Sammy Jenkins dans le film, qui donne toute sa profondeur à la quête identitaire de Léonard.