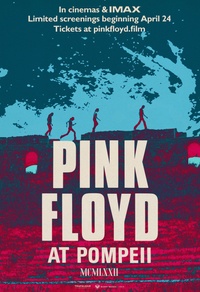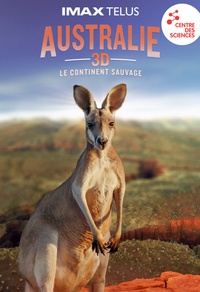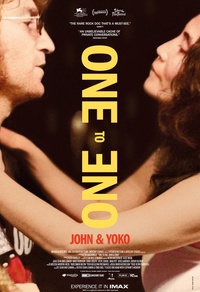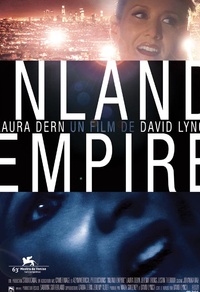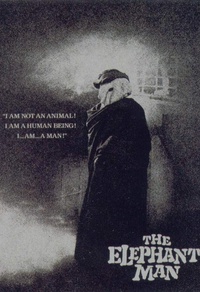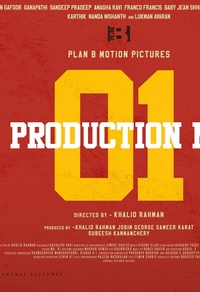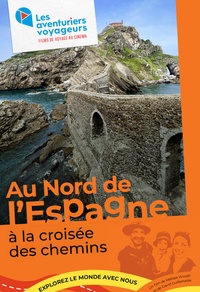Que ce soit en raison d'un petit budget, pour des fins dramatiques ou de suspense, ou simplement parce que l'histoire que l'on veut raconter le réclame, le huis clos est un style narratif particulièrement efficace et dont les mécanismes narratifs, savamment dosés, produisent généralement un très fort impact émotionnel. Dans une industrie comme la nôtre qui a peu de moyens, le huis clos est souvent une très bonne option pour produire un film marquant, à peu de frais. C'est entre autres la raison pour laquelle certains réalisateurs le choisissent pour leur première oeuvre. C'est d'ailleurs le cas pour Bunker, un film québécois dont l'action se déroule dans un endroit perdu au milieu de nulle part et qui prenait l'affiche hier. À la fois huis clos et film catastrophe ramené à dimension humaine, Bunker commence par un long plan-séquence fixe. Encore plus que le lieu restreint, théâtre de l'histoire, ces longs plans qui s'éternisent créent l'isolement des personnages.
Ainsi, dans Hunger, Steve McQueen propose de longs plans séquences sur trépied, quasi insoutenables, où seul l'activiste Bobby Sands (Michael Fassbender) vit à l'écran les derniers jours d'une grève de la faim qui lui coûtera la vie. McQueen, l'un des réalisateurs les plus aptes à rendre intolérables des images lentes et esthétiques, est passé maître dans l'art du drame psychologique intimiste. Après tout, Shame et 12 Years a Slave sont également deux films qui parlent d'une forme de claustration, à la limite du huis clos.
Mais deux des huis clos les plus marquants de l'histoire du cinéma nous ont été donnés par un très grand réalisateur : Stanley Kubrick. Dans The Shining, les personnages sont abandonnés dans un immense endroit désert et reculé qui rend l'atmosphère étouffante. Stanley Kubrick, roi du sentiment d'oppression, des longs travellings en grand-angle qui semblent déformer l'espace tout en rendant l'image claire, amplifiant une impression d'espace, alors que le cadre lui ne montre que des parties de ce qu'il devrait montrer, provoquant un malaise inconscient qui sert le suspense. De même, dans 2001: A Space Odyssey, c'est ironiquement l'infinité de l'espace qui opprime les personnages, l'isolation au milieu du néant dans un vaisseau qui dérive. Après Kubrick, plusieurs films de science-fiction ont repris le huis clos, utilisant narrativement l'immensité de l'espace comme un personnage qui s'opposerait au héros (la série des Alien, Moon).
Par contre, la durée des plans n'est pas le seul outil à la disposition du réalisateur pour créer la tension dramatique d'un film où le nombre de personnages est généralement limité. La photographie et la direction artistique jouent également un rôle-clé.
On n'a qu'à penser aux drames d'époque dont l'action est restreinte à un endroit bien précis (un paquebot dans le cas de Titanic et du magnifique 1900) ou encore aux drames se déroulant en majorité dans des sous-marins (Das Boot, U-571, K-19: The Widowmaker, The Abyss). Dans ce type de film, le nombre de personnages est généralement plus grand. L'isolation des personnages ne résulte donc pas de l'absence de liens sociaux. Le sentiment de claustrophobie est provoqué par un manque d'espace réel qui limite les mouvements de caméra ainsi que par la redondance des décors et des images. Le tout permet de maintenir le spectateur sous stress, permettant au ressort de l'identification de prendre toute sa place : parlez-en à John MacClane (Die Hard)! Souvent la réalisation réussit à accentuer le malaise par l'usage de cadres resserrés dans lesquels les personnages semblent coincés, par des mouvements de caméras épaule et par une uniformité tonale qui aplatit l'image. Ainsi, l'espace physique dans lequel se déroule l'histoire étant limité, c'est la psychologie des personnages qui devient l'objet de la focalisation du spectateur.
C'est le cas dans le drame carcéral The Shawshank Redemption : à Shawshank, tout est gris, même le ciel. Seules certaines scènes utilisent la couleur et des establishings panoramiques : les scènes où Andy Dufresne, le protagoniste interprété par Tim Robbins, ressent de l'espoir ou ceux qui nous permettent de suivre le personnage de Red (Morgan Freeman) après sa libération.
Et dans Buried, le drame de Rodrigo Cortés mettant en vedette Ryan Reynolds, le huis clos atteint un niveau jusque-là inégalé. Ici, même le son est un outil au service du réalisateur. Les premières minutes, insoutenables, se déroulent seulement au son, alors que le personnage de Reynolds se réveille paniqué quand il comprend qu'on l'a enterré vivant. Le thriller, mené de main de maître, enferme la caméra avec le personnage de Reynolds... et pourtant. Même si toute l'action se déroule dans une boîte de quelques mètres cubes, le réalisateur se permet des travellings et des compositions d'image complexes qui étouffent le spectateur. D'une simplicité désarmante au niveau de la forme, le film s'attarde donc à donner une véritable profondeur aux émotions et à la psychologie.
C'est ce qui fait toute la force d'un huis clos - et de n'importe quel film - bien mené : la forme doit absolument renforcer le fond de l'histoire. Qu'il soit intimiste ou à grand déploiement, le huis clos est une forme narrative qui vise d'abord et avant tout l'émotion. Même dépourvu d'artifices, il s'avère bien souvent plus efficace à ce niveau que bien des films prenant place dans une multitude d'endroits et de temporalités. Très théâtral dans son approche initiale, le huis clos a su trouver, au cinéma, un langage et des codes qui lui sont propres.