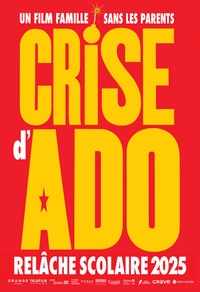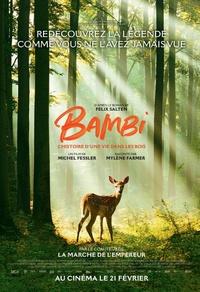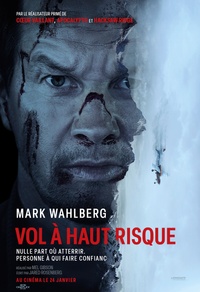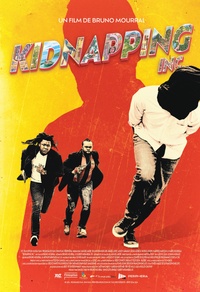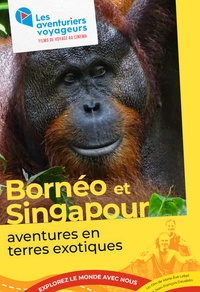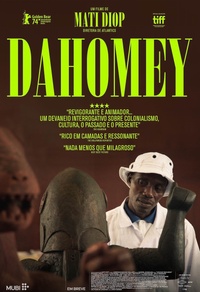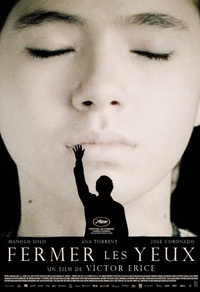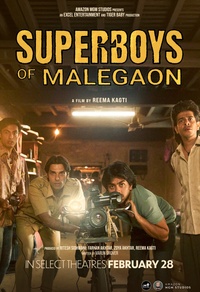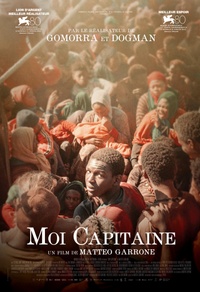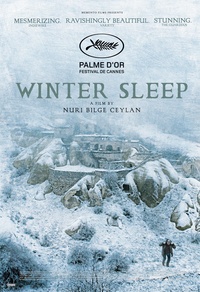Certaines fonctionnalités sont temporairement indisponibles en raison d’une mise à niveau; retour à la normale sous peu. Merci de votre compréhension.
Monument de cinéma brutal.
Une œuvre issue du cinéma d’auteur de plus de trois heures et demie avec un entracte de quinze minutes semble une anomalie dans le paysage cinématographique et pourtant Brady Corbet l’a fait. Et on peut dire que sa fresque monumentale est une réussite. Peut-être pas le chef-d’œuvre incontestable attendu mais, en tout cas, une œuvre qui fera date dans l’Histoire du septième art! Le réalisateur de l’imparfait mais singulier, méconnu et passionnant « Vox Lux » avec Natalie Portman (qui diagnostiquait déjà une certaine Amérique malade par le biais de ses tueries lycéennes et de ses pop stars dans un même film) réalise un tour de force avec « The Brutalist » qui a coûté à peine dix millions de dollars mais paraît en avoir coûté dix fois plus (coucou Francis Ford Coppola et son mégalomane « Megalopolis » complètement foiré qui en a coûté 120!). Dans la même veine que le « There will be blood » de Paul Thomas Anderson mais bien plus accessible et plaisante, cette chronique pharaonique sur le parcours de cet architecte hongrois sorti des camps de concentration est un long-métrage mémorable qui se révèle aussi puissant qu’intemporel. Comme s’il était impossible de le dater. Et qu’il sera encore impossible de le faire dans plusieurs années entre testament passéiste fondu dans un écrin à l’ancienne mais aussi projet visionnaire, indéboulonnable et indémodable. Dès la scène d’introduction incroyable, on sent que l’on va assister à quelque chose d’unique, de rare et de mémorable, bien aidé par la musique imposante et extraordinaire de Daniel Blumberg, une partition qui résonne encore longtemps en nous après la projection.
« The Brutalist » entend à la fois parler du parcours d’un homme et de son métier (celui d’architecte) que d’Histoire et de la manière dont l’Amérique s’est créée. Comme si le film entendait rappeler les fantômes du passé à un pays de plus en plus malade. On dénote en filigrane les notions de capitalisme, de racisme ou encore de lutte des classes et d’art ainsi que tous les maux d’un pays fantasmé et bercé sous les oripeaux du fameux « American Dream ». Les thématiques invoquées par ce film fleuve sont multiples et pourraient avoir besoin d’une seconde vision tellement elles sont nombreuses. On sent pléthore d’allégories dans ce scénario à la fois riche mais concret et compréhensible par tous. Certains pourraient être rebutés par la durée. Et si le film se révèle certes dense, touffu et pointu, il n’est cependant jamais trop versé dans les travers intellos du cinéma d’auteur bien qu’il soit certes très bavard et difficile à digérer. Quant à la mise en scène de Corbet, elle en impose à chaque seconde et fera date dans sa maîtrise impeccable des outils du cinématographe. Le jeune cinéaste enchaîne les plans marquants et ambitieux avec d’autres plus minimalistes et délicats. Que ce soit les plans inauguraux sur la Statue de la liberté ou ceux sur les carrières de marbre italienne, Corbet a une patte commune à nul autre.
Voilà donc un film aussi passionnant que foisonnant dont les deux parties distinctes coupées par un entracte de quinze minutes se répondent et ne font qu’une. On pourra reprocher tout de même une durée trop généreuse. Trois heures auraient probablement amplement suffi pour narrer ce portrait plus grand que nature étalé sur plusieurs décennies. Quelques longueurs dans la seconde partie se font sentir. Mais c’est peut-être aussi ce qui fait la singularité d’un projet incroyablement maîtrisé de bout en bout où les moments épiques se situent aussi bien dans ce que l’on voit que dans ce que l’on entend et ressent. La distribution est irréprochable en tous points et on ne saurait retirer une prestation plus qu’une autre même si le film est porté par un Adrian Brody qui nous rejoue un rôle aussi notable que celui qu’il incarnait pour Polanski il y a vingt-cinq ans dans « Le Pianiste » de Roman Polanski, oscarisé plusieurs fois. Le tout est sombre et austère mais parfaitement en accord avec ce que le film souhaite évoquer. Certaines séquences feront date, notamment dans le seconde partie (celles en Italie ou le cri du cœur final du personnage de Felicity Jones) alors que la première apparaît pourtant plus homogène et agréable. Dans tous les cas « The Brutalist » s’inscrira au panthéon du grand cinéma et pourrait même, tel le bon vin, gagner en saveur avec le temps. Cinéphiles, tentez-le, ce genre d’expérience entière et monstrueuse en ambition n’est pas si commune.
Plus de critiques cinéma sur ma page Facebook Ciné Ma Passion.
Guerre à l’opium du peuple
Après la sortie de l’échec commercial Vox Lux en 2018, Brady Corbet annonçait travailler sur un troisième long métrage en collaboration avec Mona Fastvold. Après six ans, le film fait son entrée à la Mostra de Venise où il reçoit une ovation de 12 minutes.
The brutalist suit la vie fictive de l’architecte juif László Toth qui s’établit aux États-Unis pour fuir l’Europe de l’après-guerre. Séparé par une entracte d’une quinzaine de minute, la première moitié de l’œuvre se penche sur le parcours migratoire de Toth. Sublimé par une ode à l’architecture et au design, cet acte est marqué par les défis de l’exclusion, de la pauvreté et de la dépendance jusqu’à ce que Toth se voit offrir la construction d’un centre communautaire chrétien.
Dans le second acte, Corbet dévoile la véritable portée de son oeuvre alors que l’architecte mène à terme son projet. Traitant en surface d’inégalités sociales, The brutalism apporte un paradoxe critique profond sur les dérives de l’Église. Le personnage d’Harrisson, interprété avec justesse par Pearse, devient le miroir de cette institution. Que ce soit les abus, les pertes en vie humaines, l’autoritarisme, l’évangelisation, la démonisation de la sexualité ou la concentration des richesses, aucun détails ne semble avoir échappé à Corbet. Même le lieu du dévoilement du film n’est nullement anodin.
Avec son format atypique en 70mm, son entracte ainsi que ses critiques sociales complexes et nuancées, le réalisateur américain révolutionne le 7e art. Les prises de vue saisissantes, notamment celles de la mine à ciel ouvert, la trame sonore évoquant l’expension économique des années 50 ainsi que les décors méticuleusement conçus nous submergent dans l’univers artistique de Corbet. Quant à Adrien Brody, il navigue dans son rôle avec une telle aisance que son personnage semble avoir été conçu pour lui.
Ambitieux, imprévisible, irrépressible et spectaculaire, The brutalist se positionne comme une oeuvre phare de la décennie. Il se révèle être un coup de coeur absolu, notre favoris en vue de la cérémonie des Oscars qui se tiendra le 2 mars prochain.