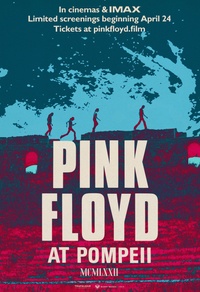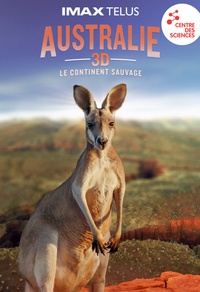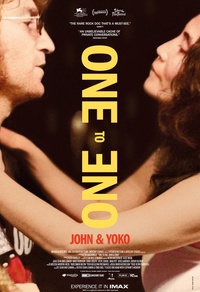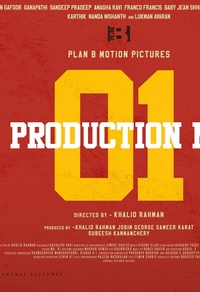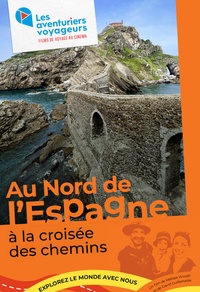Une femme respectable serait le dernier film de Bernard Émond, l'un des cinéastes québécois les plus importants du 21e siècle et réalisateur notamment de La neuvaine (2005) qui s'impose comme son chef-d'oeuvre. Si c'est le cas, il s'agit d'un chant du cygne tout à fait honorable.
Se déroulant à Trois-Rivières pendant la crise économique qui sévit toujours au début des années 1930, son neuvième long métrage de fiction se concentre sur le destin de Rose (Hélène Florent), une bourgeoise qui accepte de prendre soin des enfants que son mari jobeur (Martin Dubreuil) a eu à l'extérieur de leur mariage. Elle le fait par charité chrétienne ou pour des raisons personnelles?
Peu importe, il s'agit d'un magnifique portrait de femme, dont l'auteur est passé maître, de La femme qui boit (2001) à Pour vivre ici (2018). Rose est sans doute l'une de ses héroïnes les plus captivantes et complexes, ne se livrant pas totalement, voulant le bonheur des autres en les enfermant dans une cage dorée. Sa solitude est totale, alors qu'elle apparaît seule dans le cadre de l'écran, réfrénant constamment ses désirs et ses pulsions, jusqu'à une conclusion crève-coeur. Son interprète Hélène Florent (Les oiseaux ivres) livre une nouvelle performance splendide, encapsulant son jeu dans les non-dits propres à son créateur. Elle forme un duo marquant avec Martin Dubreuil (la retenue lui va comme un gant), développant des rapports humains qui rappellent ceux des classes sociales.
La froideur de la protagoniste se réchauffe comme ces icebergs à la dérive, au fil des mois d'hiver qui finiront bien un jour par se terminer. Un tango entre l'ombre et la lumière que le metteur en scène illustre magnifiquement. La superbe photographie de Nicolas Canniccioni capte aisément le regard, à l'instar de la demeure de Rose qui est une continuité de sa personnalité. La pénombre règne dans ce lieu chargé, accueillant et étouffant à la fois. Malgré quelques échappées vers l'extérieur, il s'agit d'un drame de chambre, dont les échos au cinéma d'Ingmar Bergman sont palpables au fil d'une réalisation étudiée dont le rythme lent privilégie l'observation à l'action ou aux dialogues.
En adaptant la nouvelle Toute la vie, le coeur en peine de Luigi Pirandello (un auteur italien que les frères Taviani ont déjà porté à l'écran avec le magistral Kaos), Bernard Émond continue à traiter de ses thèmes de prédilection - la perte des repères, la quête des valeurs dans un monde dominé par l'argent - tout en posant un regard contemporain sur le Québec d'aujourd'hui. Celui à la croisée des chemins, marqué par la crise économique, qui doit apprendre à tendre la main et vivre avec sa propre conscience. Contrairement à ses précédents efforts (comme Le journal d'un vieil homme et Tout ce que tu possèdes), il a eu la présence d'esprit de tenir la narration au minimum, préférant le silence aux mots. La charge humaine, sociale et émotionnelle se veut ainsi moins didactique, plus subtile, même si quelques passages demeurent trop démonstrateurs.
Après quelques essais plus discutables, Bernard Émond renoue avec l'essence de son cinéma : un art de gravité où la dignité finit par avoir le dernier mot. En voilà un qui risque de nous manquer, même si la retraite n'est pas une fin en soi (parlez-en à Hayao Miyazaki).