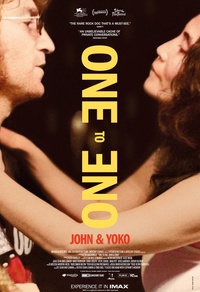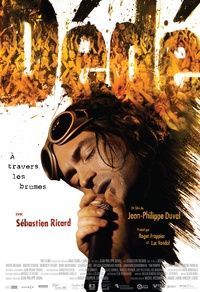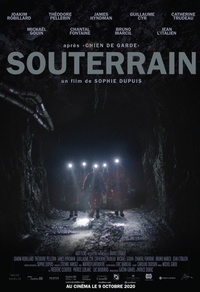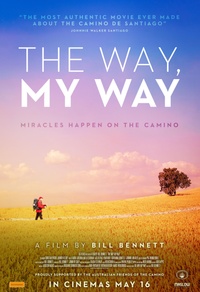Présenté au dernier Festival de Cannes, The Sweet East est une de ces pépites qui permettent au cinéma américain indépendant de briller. Dommage que le film, fascinant à bien des égards, ne soit pas toujours à la hauteur.
Il est mis en scène par Sean Price Williams, directeur photo attitré d'Alex Ross Perry (qui agit ici comme producteur) et des frères Safdie (sur leur brillant Good Time). Deux noms importants du septième art américain contemporain qui peuvent créer des attentes chez les cinéphiles.
Pour sa première réalisation, Price Williams mise sur ce qu'il sait faire le mieux : fabriquer des images. Elles sont soignées, magnifiques et d'un grand pouvoir d'évocation, usant de formats différents afin de créer l'ambiance la plus appropriée, de camper l'atmosphère la plus unique.
The Sweet East ressemble parfois à un rêve, à un trip hallucinant et halluciné qui n'aurait pas déplu au journaliste gonzo Hunter S. Thompson. Les textures peuvent paraître tape-à-l'oeil, mais elles s'inscrivent pourtant dans un riche héritage qui va de Larry Clark à Harmony Korine, en passant par les premiers longs métrages de Gus Van Sant.
Le scénario, concocté par le critique de cinéma Nick Pinkerton, laisse toutefois à désirer. Il s'agit d'une relecture d'Alice au pays des merveilles, alors qu'une étudiante passe de l'autre côté du miroir afin de vivre 1000 aventures incroyables. Un procédé qui n'est pas sans rappeler le singulier Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette.
On se retrouve devant un récit picaresque sur l'Amérique. Une odyssée qui tente de tâter le coeur et les fondements des États-Unis, autant sa jeunesse qui aspire à changer le monde, que de ses hommes blancs qui se réunissent en plein air, en passant par ces gens qui souhaitent faire un film important, et les autres qui semblent comploter dans le bois.
Outre l'introduction et la conclusion, l'ensemble est séparé - à la façon d'un film muet - en quatre parties distinctes. Des sketchs d'une qualité très variable, qui vont du sublime au plus quelconque, sans offrir un tout réellement satisfaisant.
Le plus ironique dans tout cela, c'est que derrière son côté complètement imprévisible, ses mélanges de tons et ses répliques vives (un gag sur Merchant Ivory est toujours le bienvenu), l'effort finit par tourner à vide. Il n'a pas grand-chose de significatif à dire sur son sujet, si ce n'est d'enfoncer des portes ouvertes avec des personnages qui semblent vivre dans leur propre réalité alternative.
Ce manque de substance est compensé par une énergie punk contagieuse. La caméra ne tient pas en place et les plans se succèdent. Un rythme qui peut paraître essoufflant, épuisant même. Cela se calme heureusement par la suite. Quand la musique s'en mêle, notamment lors d'une séance chantée ou d'une déflagration jazzée, le film devient ce qu'il voulait : une expérience viscérale sur le fait d'être dans ce pays d'exception.
Le long métrage offre également un bel inventaire de jeunes talents qui ne le resteront pas très longtemps. On pense ici à l'héroïne Talia Ryder, déjà mémorable dans Never Rarely Sometimes Always, et à Jacob Elordi, qui volait la vedette dans Saltburn et Priscilla. Il y a également Earl Cave, le fils du grand Nick, et surtout Simon Rex, cet ancien acteur porno qui s'est refait une réputation grâce à l'hilarant Red Rocket et qui attire encore ici tous les regards.
On ne sait jamais à quoi s'attendre devant The Sweet East et c'est probablement sa plus grande qualité. Si le résultat final déconcerte allègrement, on pourra toujours se raccrocher à sa photographie étincelante et à cette sensation trop rare d'accéder à un monde à part.