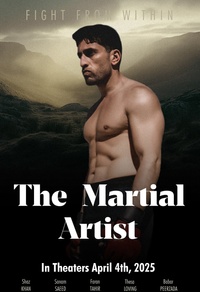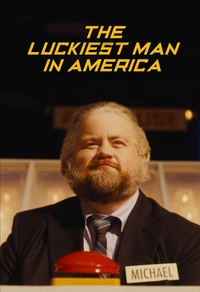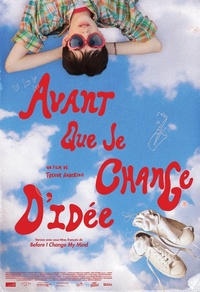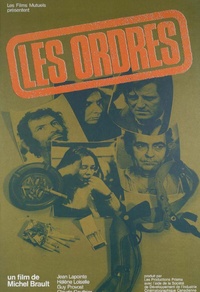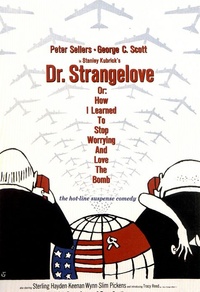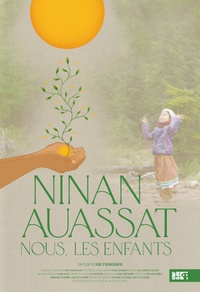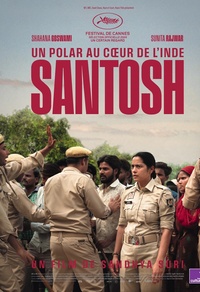Le film de lutte (ou de boxe) semble être le genre de prédilection pour permettre à un cinéaste talentueux d'atteindre les ligues majeures. Darren Aronofsky l'a fait avec The Wrestler, David O. Russell avec The Fighter et c'est au tour de Sean Durkin de s'essayer avec son solide The Iron Claw.
Le long métrage débute dans l'arène, et son introduction ne peut que rappeler Raging Bull, le chef-d'oeuvre de Martin Scorsese. C'est là qu'on fait la connaissance du patriarche Von Erich (Holt McCallany), un lutteur féroce qui s'apprête à utiliser une prise spéciale afin de museler son adversaire. La magnifique photographie en noir et blanc de Matyas Erdély (Le fils de Saul) symbolise à la perfection ce personnage qui semble incapable de voir les nuances de l'existence. Selon lui, pour triompher, il faut seulement multiplier les efforts et croire en soi.
Le récit fait un saut vers le présent, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, à l'aide d'une mise en scène vigoureuse et vivante qui n'est pas sans rappeler celle du récent The Holdovers d'Alexander Payne. Une texture de couleurs spéciale teinte l'écran, présentant les fils Von Erich, alors qu'ils sont encouragés à se battre. Papa a tout orchestré, et ses enfants possèdent la graine de champions. Cette section légère et amusante, baignée des mélodies de Richard Reed Perry (qui vient de faire des merveilles avec la trame sonore d'Eileen), permet à la fois de développer la chimie du clan que de dresser un portrait éloquent de l'époque qui bénéficie d'une subtile reconstitution historique.
Puis le drame survient, et rien ne semble vouloir l'arrêter. Des épreuves frappent de plein fouet cette famille qui espère, malgré tout, garder la tête hors de l'eau. Une malédiction s'abat sur les Von Erich depuis belle lurette, et le destin continue de s'acharner sur eux. Le rythme jusqu'alors posé s'ankylose graduellement et la puissance des ellipses ne manquent pas de hanter.
Continuant à traiter du spectre du patriarcat après deux oeuvres formidables (Martha Marcy May Marlene et The Nest), le cinéaste Sean Durkin l'explore cette fois au niveau micro et macro. Il y a ce père de famille obnubilé par le succès, et les États-Unis qui sont sur le point d'embrasser le néolibéralisme. Dans les deux cas, la tragédie - grecque, comme dans le Warrior de Gavin O'Connor - n'est jamais loin, surtout quand l'argent et la gloire finissent par terrasser l'âme et la santé. En filigrane se déploie une réflexion probante sur le rêve américain et la masculinité.
Le scénario de Durkin n'est cependant pas sans faute, et il se complaît parfois un peu trop dans les clichés des biopics historiques, avec ces hauts vertigineux et ces bas abyssaux. L'ensemble se veut plutôt prévisible et la finale, religieuse comme le pays où se déroule l'action et les vertus guidant ce clan hors de l'ordinaire, soutirera des larmes ou fera rire aux larmes, selon la sensibilité.
Le plus grand atout du long métrage est sa distribution. Tous les acteurs sont impeccables, des rôles principaux aux personnages secondaires. Ils ont d'ailleurs chacun leur moment pour briller, que ce soit l'intense Jeremy Allen White (des séries Shameless et The Bear), le charismatique Harris Dickinson (Triangle of Sadness) et l'imperturbable Holt McCallany (Wrath of Men). Tous les yeux sont tournés vers Zac Efron, qui trouve son meilleur rôle en carrière. Le comédien est médusant dans la peau d'un lutteur qui, à l'instar de Gael Garcia Bernal qui personnifiait Cassandro dans le drame de lutte du même nom, fera l'impossible pour trouver le bonheur, et ce, sans y laisser sa peau.
Que l'on soit fan de lutte ou non, The Iron Claw demeure un film universel sur des gens qui veulent toujours voler plus haut et qui finissent, comme Icare, par brûler leurs ailes. Leur destin a beau être éphémère, ce qu'on retient est l'amour sincère porté par ce clan, et la difficulté de réaliser que la famille est peut-être la victoire la plus importante à remporter.