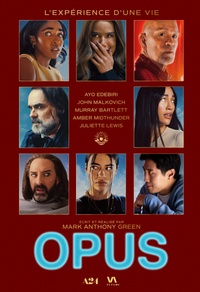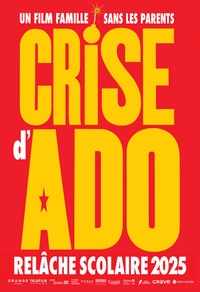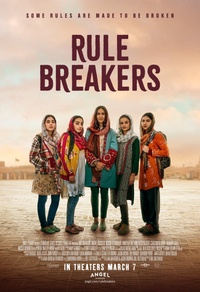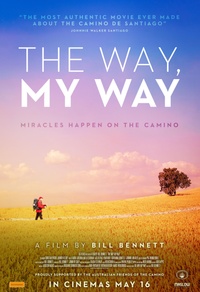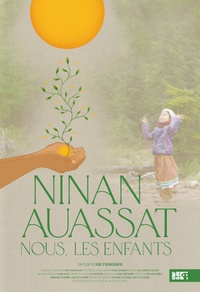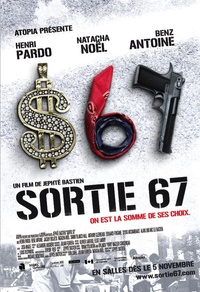Il n'y a plus de films « nécessaires », de nos jours, même si le milieu du cinéma aimerait bien le croire. Et si on était complètement honnête, on avouerait que la critique de cinéma n'a plus l'importance ni l'impact qu'elle a déjà eus, au travers des nouvelles technologies, du traitement sensationnaliste des médias conventionnels et de la multiplication des leaders d'opinion. Changer les choses par le cinéma, c'est une affreuse illusion, qui s'accompagne à chaque fois par une désillusion équivalente. Et comme la critique n'est pas le lieu pour juger de la valeur sociale ou morale d'un film - il en va de chaque spectateur, de chaque individu, de prendre ses responsabilités et de le faire - il ne reste plus que la valeur cinématographique.
Alors qu'il était enfant, Jecko a assisté à l'assassinat de sa mère par son père. Déterminé à se venger, il est récupéré par les gangs de rue où il apprend les rudiments de la criminalité en travaillant pour Brooklyn, le chef du gang, dans le monde de la drogue et de la prostitution. Alors que se prépare une transaction importante, Jecko appréhende la sortie de prison de son père. Confronté à ses responsabilités familiales, il remet en question ses priorités et décide de quitter le milieu criminel. Mais un gang rival kidnappe ses proches, et Jecko doit sacrifier sa vie pour les sauver.
En voulant aborder tous les problèmes, Sortie 67 opère une surdramatisation qui le sert mal. Les thématiques se nuisent, puisqu'elles tentent en quelque sorte de justifier les actes criminels posés. La question de la justice et du pardon - des thématiques primordiales - est à peine effleurée. Une accumulation de ralentis insignifiants et improvisés vient détruire le rythme chancelant qu'imposait le scénario, déjà confus. Au travers de tout cela : des déclarations d'amour incongrues, des personnages qui s'improvisent poètes, une paternité avouée par hasard (sérieusement?), des prostituées disparues et des messages « subliminaux » déclinés sans subtilité (on est tous maître de ses choix de vie, compris?). On parle d'une dizaine de refus auprès des institutions... peut-être qu'on aurait dû avoir la puce à l'oreille?
Ce qui est le plus frustrant cependant, c'est ce refus du malheur, cette conviction du happy end qui fait que même des personnages de gangsters (donc des criminels, des individus craints, intransigeants) trouvent au fond de leur coeur un peu d'amour pour laisser la vie sauve à leur ennemi. En plus d'être totalement incohérent, c'est particulièrement injuste envers ses propres personnages qui perdent ainsi toute leur crédibilité. Et on ne retire aucun impact émotif : c'est tellement idiot qu'on est plus fâché qu'ému. Et dire qu'on nous fait le coup trois fois (oui, trois fois)! Comme si une n'était pas assez, comme si pisser dans ses culottes était une punition suffisante pour une vengeance ruminée pendant des décennies!
Vouloir montrer la diversité et le talent des acteurs noirs du Québec (ils ne sont pas tous talentueux, d'abord), ce n'est pas non plus une qualité cinématographique. C'est même pratiquement condescendant; on n'engage jamais de Noirs dans les films québécois, tellement qu'ils en sont réduits à ne jouer que dans les « films de Noirs » (pardon), où ils doivent incarner des personnages aussi mal définis qui propagent les stéréotypes des gangs de rue. Est-ce vraiment mieux que de les engager pour jouer un chauffeur de taxi?
Et il n'y a pas d'excuse de manque de budget qui tienne (on a été sévère avec Le poil de la bête, on le reste); même si ce n'est pas très agréable à constater, ne pas avoir assez d'argent, c'est une excellente raison de ne pas faire un film, aussi important soit-il. Il faut avoir conscience de ses limites, il faut s'assurer de bien faire les choses pour s'assurer d'être bien entendu et bien compris. Pour éduquer les jeunes, peut-être, mais ne me parlez pas de cinéma.