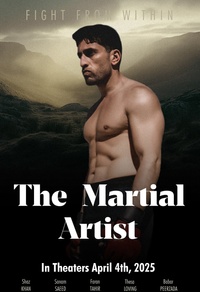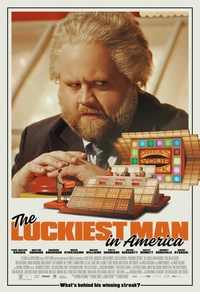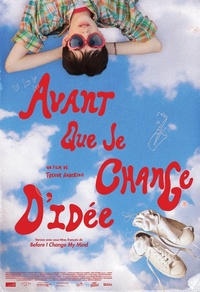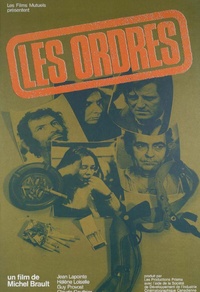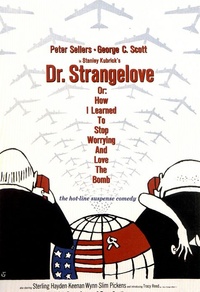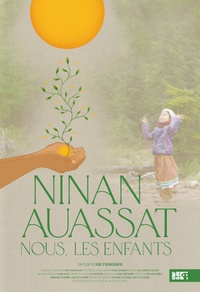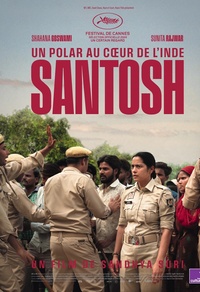Après Londres, Barcelone et Paris, c'est au tour de Rome de faire l'objet d'un hymne signé Woody Allen. Grâce à un film choral, somme toute bien ficelé, le célèbre réalisateur fait découvrir à ses fidèles une ville d'une grande beauté architecturale et poétique ainsi que dotée d'un grand potentiel scénaristique. Comme dans toutes oeuvres de ce genre - où les histoires s'entrecroisent, se heurtent et s'alimentent -, certains passages s'avèrent moins intéressants que d'autres, moins signifiants dans leur portée symbolique aussi. Allen exploite de nombreuses (certains diront probablement trop) thématiques à travers ces chroniques. On passe de la célébrité instantanée au triangle amoureux, en passant par le désir animal et l'affrontement d'idéaux sociaux et politiques entre gens de milieux opposés. Ces récits sont toujours assez ludiques - avec Woody Allen on est rarement dans le réalisme cartésien - et nous transportent habilement dans des univers dissemblables, mais tout autant enveloppants.Il est bon de revoir ce cinéaste marquant jouer sur grand écran. Le personnage qu'il incarne - un américain retraité et ronchonneur qui travaillait dans le monde de la musique depuis des lustres - brille au sein de cet amalgame d'énergumènes tous aussi fascinants les uns que les autres. Même si Ellen Page n'a pas le physique d'une femme fatale, Allen a tout de même décidé de faire de l'interprète de Juno l'une de ses croqueuses d'hommes que l'on dépeint normalement avec une poitrine et des lèvres plantureuses, et le résultat est surprenant. On croit presque instantanément à cette jeune actrice coureuse de jupons qui exsude le désir et le sexe. Même si son histoire est probablement la plus anodine, la moins bien intégrée au reste de la narration, l'acteur italien Roberto Benigni livre une brillante performance dans le rôle d'un homme ordinaire qui se réveille un matin pour réaliser qu'il est maintenant une grande vedette poursuivie par les paparazzis et harcelée par les journalistes qui veulent savoir avec quoi il tartine ses rôties. Il faut mentionner aussi la présence remarquée à l'écran d'Alec Baldwin sous les traits d'un architecte/fantôme/matérialisation de la conscience individuelle qui donne une couleur particulière - et bienvenue - à la genèse d'un triangle amoureux (entre Jesse Eisenberg, Greta Gerwig et Ellen Page).Comme il l'avait fait avec Vicky Cristina Barcelona et Midnight in Paris, Woody Allen laisse une place importante à l'espace, à la ville dans laquelle l'action se déroule. Les lieux influencent les personnages et les personnages influencent les lieux. Allen ne confine pas ses intrigues dans des lieux clos. Les protagonistes se déplacent allègrement, de manière à dévoiler certains endroits mythiques de la capitale italienne et certains autres, moins connus.Le réalisateur a choisi de débuter et de terminer son film par l'intervention d'un narrateur qui se vante d'être le mieux placé pour raconter les péripéties qui ont lieu dans les rues de la ville. Même si le cinéphile n'est pas habitué à ce qu'un personnage sorte de son cadre et brise le quatrième mur pour s'adresser directement à lui, le procédé fonctionne assez bien ici et parvient à nous déstabiliser d'entrée de jeu en plus d'infliger une structure efficace à l'oeuvre globale.To Rome with Love n'est certes pas le film de Woody Allen qui traversera les époques et marquera une génération (comme Annie Hall ou Manhattan l'ont fait par exemple), mais il reste un divertissement intelligent et habile qui nous permet de découvrir une culture et une langue à travers les yeux d'un Américain qui, depuis quelques années, se prend pour un Européen.
Comme dans toutes oeuvres de ce genre - où les histoires s'entrecroisent, se heurtent et s'alimentent -, certains passages s'avèrent moins intéressants que d'autres, moins signifiants dans leur portée symbolique aussi.