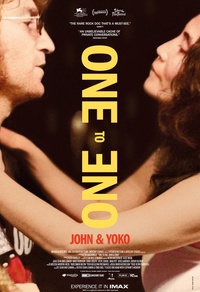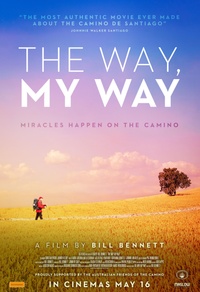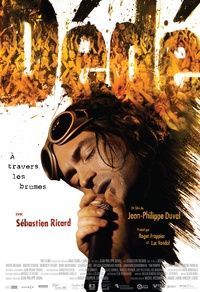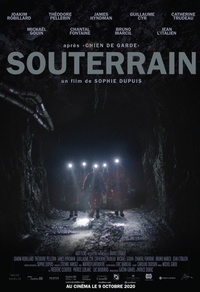Les mystères de la distribution sont parfois insondables. Il a fallu attendre plus d'une année avant de voir débarquer sur les écrans québécois Rodin, qui a été présenté en compétition officielle à Cannes en 2017. Au moins il est sorti et on pourra l'attraper sur grand écran. Ce n'est pas comme Ma'Rosa de Brillante Mendoza, prix d'interprétation féminine à Cannes en 2016 et toujours inédit dans notre contrée...
Vilipendé au plus important festival du septième art de la planète, Rodin se pose comme une illusion. Lorsqu'on le regarde sommairement, il ne s'agit que d'un biopic anonyme sur les hauts et les bas de l'immense sculpteur (Vincent Lindon) et de ses amours difficiles avec son ancienne élève Camille Claudel (Izïa Higelin). Ce film, on l'a découvert il y a 30 ans sous le titre de Camille Caudel de Bruno Nuytten, alors que Gérard Depardieu incarnait le mythique artiste. Une oeuvre classique de grande qualité qui a marqué les esprits. Aussi intéressante, mais bien différente de la version de Jacques Doillon, qui est tout sauf académique.
Comme toujours chez ce grand cinéaste, qui a composé ses opus les plus importants dans les années 80 et 90 (Ponette représente sans aucun doute son classique), le récit ténu ne raconte pas tant une histoire qu'une représentation d'un personnage dans son milieu donné. Il y a le héros qui travaille dans son atelier ou qui s'inspire de la nature. Le processus de création est à l'oeuvre et ça, c'est rare qu'on puisse le voir au cinéma (à moins de s'appeler Clouzot et de faire un documentaire sur Picasso). Les mains du protagoniste palpent les textures et façonnent la matière, encore et toujours.
L'action est évidemment redondante, ce que s'applique à démontrer la réalisation. La mise en scène dépouillée, volontairement grisonnante et âpre comme son sujet, représente ces couches de plâtre qu'on applique, biffe et améliore continuellement. Une forme qui répond au fond, que vient renforcir l'utilisation de longs plans, les jeux incessants dans l'espace et la précision chirurgicale des détails. Il y a même une omniprésence de fondus au noir avec de la narration afin de permettre une connexion intime. Ce procédé, bien entendu, ne fera pas l'unanimité.
En détournant les codes de l'usuelle biographie romancée, Rodin prend soin de se tenir loin de l'anecdote. Il y a amplement matière à des questionnements, surtout qu'une certaine fascination émane de l'ouvrage, qui finit par s'élever vers le divin. La première partie, plus romanesque, sépare l'artiste de l'être humain, forcément imparfait. Les relations étant éphémères, le sculpteur tente d'emprisonner ces moments de passion dans ses créations. Une sublimation lente et subtile, qui prend son sens dans le second segment, encore plus réussi malgré ses quelques errances. C'est là qu'il touche à une universalité, transformant le regard du cinéphile face à ce qui l'entoure, émouvant grandement lors d'une finale démocratisant l'art.
Impossible de passer sous silence la prestation de Vincent Lindon. Cet acteur peut absolument tout jouer et il le prouve à nouveau d'une brillante façon. L'âme de Rodin y est sans sombrer dans le maniérisme élémentaire, apportant une animalité qui force l'admiration. On ne peut malheureusement pas en dire autant d'Izïa Higelin (La belle saison), fille du célèbre musicien, bien pâle à côté d'Isabelle Adjani chez Nuytten ou de Juliette Binoche dans l'extraordinaire Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont. Ce n'est pas tant le jeu des comparaisons qui blesse que sa propension à être juste dans une scène et fausse dans l'autre.
À l'origine un simple film de commande, Rodin est sublimé par la forte composition de Vincent Lindon et la vision personnelle de Jacques Doillon. Le long métrage n'a peut-être rien de spectaculaire et il est sans doute plus radical que la moyenne, on y retrouve néanmoins suffisamment de beauté pour vouloir s'y investir. Sans doute qu'il faudra un peu souffrir au passage, mais ce n'est rien devant le résultat en place et ce qu'on garde en soi, longtemps après la tombée du générique.