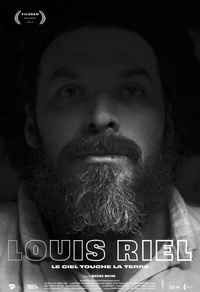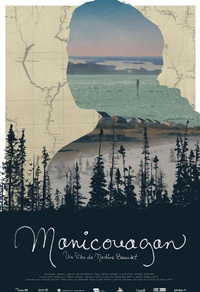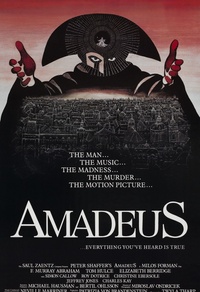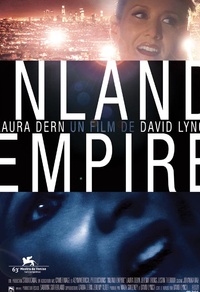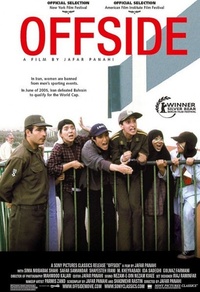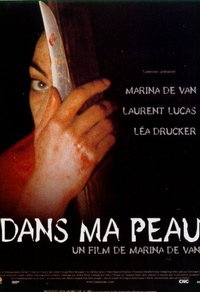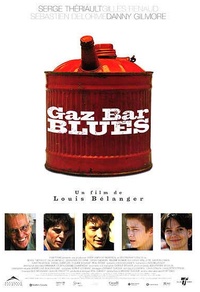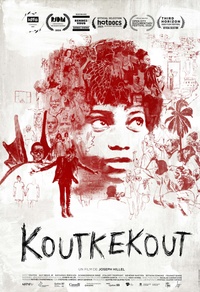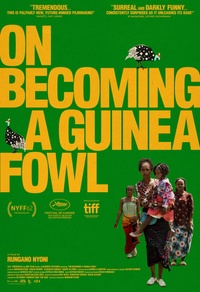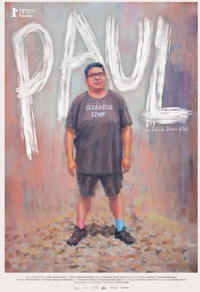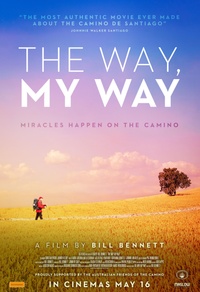Luca Guadagnino est sans doute le cinéaste contemporain à avoir le mieux filmé le désir. Il le fait généralement du point de vue de la jeunesse, comme ce fut le cas plus tôt cette année avec son virevoltant Challengers. Le voilà changer son fusil d'épaule avec Queer, où il rend le coeur plus léger à un homme d'âge mur.
William Lee (Daniel Craig) arpente les bars dans un Mexico fantasmé des années 1950, d'une immense beauté plastique. Il a soif d'aimer et d'être aimé, jetant son dévolu sur Eugene (Drew Starkey), un homme plus jeune. Ce dernier repousse ses avances, avant de se laisser séduire par cet inconnu obsessionnel qui lui fera vivre des aventures incroyables.
Le cinéaste italien a déjà filmé cette histoire. L'éblouissant I Am Love a lancé sa carrière à l'international, et Call Me by Your Name en a fait l'un des réalisateurs les plus estimés. Queer ressemble parfois à une parodie de son art : cette façon de faire monter le désir en utilisant la chaleur et la moiteur ambiante, avant de relâcher la tension qui explose lors de scènes érotiques.
Tout est une question de style chez Guadagnino. Sa mise en scène esthétisante vise souvent la surenchère, dont ces effets de ralentis qui rappellent Wong Kar Wai, tandis que les mélodies prennent toujours une place prépondérante. Cela donne des scènes marquantes sur fond de Nirvana et de New Order, qui bénéficient grandement des images exceptionnelles de Sayombhu Mukdeeprom (le directeur photo d'Apichatpong Weerasethakul), mais également un sentiment d'esbroufe et de frustration.
Ce qui sauve le film de l'exercice de style est la présence de Daniel Craig. La persona de l'ancien James Bond est utilisée afin de réfléchir sur la masculinité. L'acteur, touchant de vulnérabilité, trouve son meilleur rôle en carrière et devrait, en toute logique, décrocher une nomination aux Oscars.
Le comédien est si éblouissant qu'il fait de l'ombre à son partenaire de jeu. Drew Starkey ne possède ni la prestance ni le charisme pour lui tenir tête. Il s'avère davantage comme un double plus jeune et moins musclé de Craig. Une dualité qui fait beaucoup de sens avec le reste du récit.
Lorsque le long métrage commence à plafonner et à tourner en rond, le scénario (de Justin Kuritzkes, également auteur de celui de Challengers) propose un voyage aux comparses. Pourquoi ne pas visiter l'Amérique du Sud? Une façon de varier les enjeux pour offrir un second souffle au « couple ».
Surtout que William est à la recherche d'une plante spéciale. S'il est déjà adepte de drogue, sa nouvelle trouvaille l'amènera au septième ciel. Ces séances d'hallucinations qui flirtent avec le genre (ce qui n'est pas rare chez l'auteur de Bones and All et du remake de Suspiria) seront à prendre ou à laisser, fascinant ou déconcertant selon sa sensibilité.
Ils ne surprendront pourtant personne qui connaît l'oeuvre littéraire de William S. Burroughs, dont est inspiré Queer. Bien que Lee ressemble parfois à s'y méprendre au héros type de Hunter S. Thompson (autre auteur d'odyssées fantasmagoriques sous fond de psychotropes), c'est bien l'ADN de Burroughs qui est en place. Celui que l'on retrouvait déjà dans les brillantes adaptations de Naked Lunch de David Cronenberg et Les garçons sauvages de Bertrand Mandico.
Mais quel est le lien entre la passion qui dévore William et cette plante qui favoriserait la télépathie? Il s'agit de la quête identitaire qui dévore le protagoniste de l'intérieur. Celui que l'on découvre en train d'errer, cherchant avidement une présence pour rompre sa solitude. En trouvant Eugene, il accède non seulement à une forme d'amour, mais il arrive surtout à reconnecter avec son essence première. William ne l'accepte pourtant pas, ne s'estimant pas queer. La métamorphose se fait graduellement; la quête de la plante devenant la métaphore du changement.
Le tout est palpable lors de la conclusion. Le protagoniste retourne à l'endroit où il a consommé son désir. Le rouge de la chambre n'évoque plus la passion, mais ouvre plutôt une brèche vers l'univers de David Lynch. Un nouveau rêve ou cauchemar, à la fois énigmatique et inquiétant, mais surtout beau et touchant, qui renvoie directement à l'inoubliable monologue du père à la fin de Call Me by Your Name.
Plus que jamais, Guadagnino s'accroche aux fantômes, trépassés ou bien vivants. Il y a celui de Cocteau, cité par un extrait d'Orphée, qui lui permet de distiller de la poésie onirique, notamment avec ces effets de surimpression lorsque William fantasme à enlacer Eugene. Puis il y a les apparitions furtives de deux des metteurs en scène les plus fondamentaux des dix dernières années. En s'entourant de David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight) et de Lisandro Alonso (Jauja, Eureka), le réalisateur italien se permet de dialoguer avec leur univers respectif, notamment sur l'importance du temps qui passe.
Sans être le film le plus engageant de son auteur, Queer est sans doute son plus personnel et certainement son plus mélancolique. Clinquant et profond tout à la fois, complètement imprévisible après une première partie qui laissait présager le pire, l'effort n'hésite pas à sortir des chemins balisés et à prendre des risques. Que l'on adhère ou pas à la proposition, il sera impossible de ne pas se laisser séduire par Daniel Craig, dont la performance phénoménale ne manquera pas de hanter pendant longtemps.