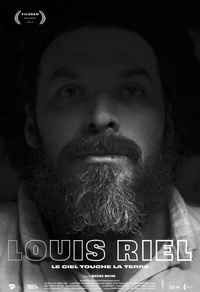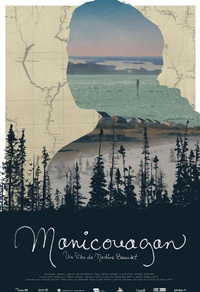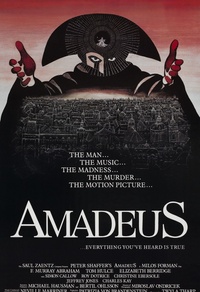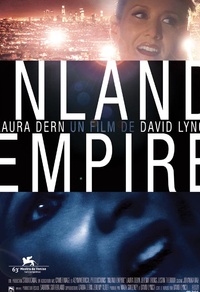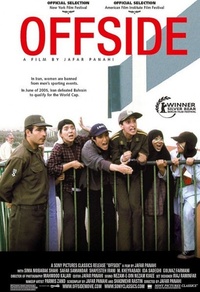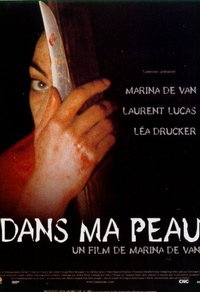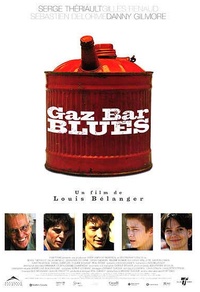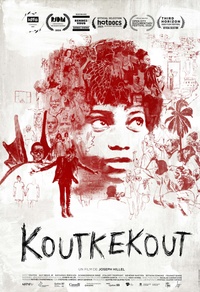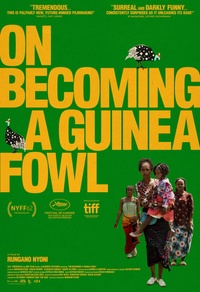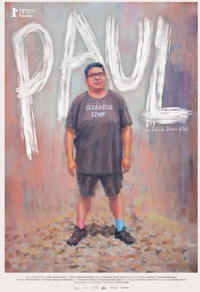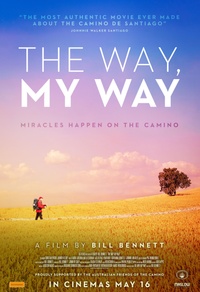Le parcours de Steven Soderbergh est fascinant. Depuis qu'il a remporté la Palme d'Or à 26 ans avec son premier long métrage (le bien nommé Sex, Lies and Videotape en 1989), le cinéaste américain s'amuse à brouiller les pistes, alternant films d'auteur et superproductions hollywoodiennes. Après un long détour vers les plateformes avec des oeuvres plus confidentielles et l'échec incommensurable de Magic Mike's Last Dance, le voilà de retour avec Presence.
Comme toujours chez le créateur de Ocean's Eleven et Erin Brockovich, un nouveau projet est l'occasion d'explorer un nouveau genre. Il est ici question du film de fantômes. Le premier plan donne rapidement la puce à l'oreille. Une présence semble habiter une maison vide. À l'aide d'un plan subjectif, on la suit regarder par la fenêtre. Elle se met ensuite à arpenter les pièces lors d'un plan séquence de plus en plus rapide. Lorsqu'une famille vient s'installer dans ce lieu qui est peut-être hanté, le cinéphile se retrouve dans la position du voyeur, de cette entité qui scrute les nouveaux venus.
Presence relève donc du trip formaliste. Soderbergh est un expert pour changer son style et sa façon de raconter une histoire, mettant constamment la forme à l'épreuve. Dans son thriller psychologique Unsane (2018), cela passait par l'utilisation d'un iPhone 7 Plus. Cette fois, c'est en épousant complètement le regard du fantôme. Un procédé assez stimulant... à condition de faire fi de la vraisemblance de certaines situations. À moins qu'il y ait plus d'un spectre dans la maison... Si l'effort relève parfois de la «gimmick» et qu'il finit par tourner à vide, l'ensemble est rehaussé par une mise en scène de qualité. Impossible, par exemple, de ne pas se laisser bercer par les mélodies harmonieuses du compositeur Zack Ryan.
Dommage que le récit ne bénéficie pas de la même ambition que la réalisation. Le script signé David Koepp (dont les plus grands succès, de Jurassic Park à Angels & Demons, en passant par War of the Worlds, les derniers épisodes d'Indiana Jones et le premier Spider-Man, sont basés sur du matériel existant) ne brille guère par son originalité. Il est question de conflits familiaux et de traumas du passé, de parents absents et d'adolescents laissés à eux-mêmes, d'oppositions entre la foi et la raison. Évidemment que la menace humaine est plus dangereuse que celle spectrale. Cela se termine par une illumination quasi religieuse où il faut se diriger vers l'immense lumière blanche... Une symbolique parmi tant d'autres, surtout avec une famille dont le nom de famille est Payne (proche de l'anglais «pain', qui signifie «douleur» en français) et tous ces miroirs qui permettent de communiquer avec «l'autre monde'.
Les acteurs ont parfois de la difficulté à se plier à l'exercice de style en place. Ce n'est peut-être pas le cas des vétérans comme Lucy Liu et Chris Sullivan qui modulent leur jeu selon les enjeux. Mais c'est plus apparent chez les jeunes comédiens moins professionnels, dont les performances parfois rigides manquent de nuance. Sans surprise, la présence la plus convaincante est celle du fantôme. Même si on ne le voit pratiquement jamais à l'écran, on sent son aura. Une mélancolie qui n'est pas sans rappeler celle du magnifique A Ghost Story de David Lowery.
Steven Soderbergh réalise presque un long métrage par année parce qu'il ne signe pratiquement jamais les scénarios. Mais quand il le fait, cela donne généralement des oeuvres personnelles et mémorables. Ce fut le cas avec son ingénieux remake de Solaris (2002), un puissant film fantomatique sous fond de désirs, de regrets et d'hallucinations. Beaucoup plus froid et austère, Presence laisse quelque peu de glace tant le créateur est obnubilé par la forme, assez novatrice, au détriment du fond, classique et secondaire.