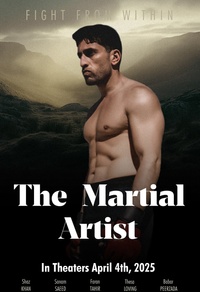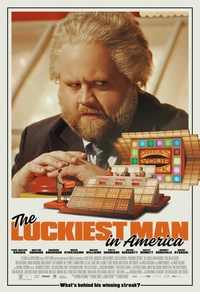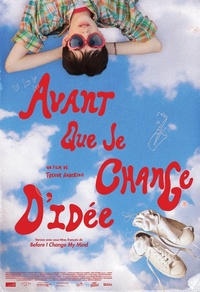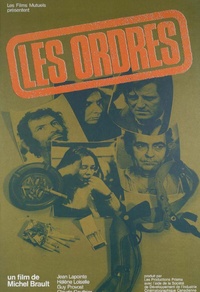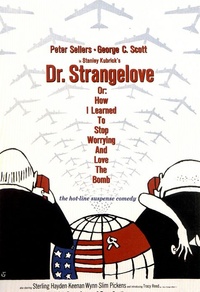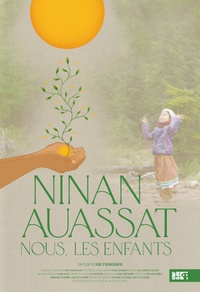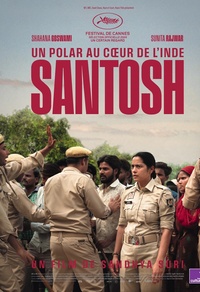En temps normal, Nadia, Butterfly serait allé à Cannes et il aurait obtenu un beau succès d'estime. Mais 2020 est tout sauf une année ordinaire. Cela n'empêche pas les cinéphiles de découvrir le joli film de Pascal Plante en salles.
L'oeuvre ne tarde pas à happer, impressionner par sa maîtrise. Dès le départ, la caméra suit inlassablement de gauche à droite une femme qui nage dans une piscine. Une introduction de style documentaire où la caméra ne coupe pas, permettant aux spectateurs de vivre le tout en temps réel.
Recourir aux silences et aux non-dits, dilater la durée, allonger les plans afin de faire sortir la vérité authentique de la fiction, jouer avec la forme : cela a toujours été le dada de ce talentueux créateur. Les composantes par excellence de ses courts métrages et les meilleurs moments de son précédent long Les faux tatouages. C'est également là où Nadia, Butterfly se démarque. En accompagnant continuellement sa protagoniste dans son quotidien, dans l'eau ou dans ses déambulations à Tokyo. Un aspect presque physique qui est magnifiquement mis en images par Stéphanie Weber Biron.
Sauf que ce type de projet est rarement subventionné au Québec. Le cinéma à l'état pur, c'est bien. Cela semble pourtant toujours vouloir venir avec un récit en bonne et due forme, des dialogues explicatifs, une psychologie fouillée des personnages. Des aspects qui sont moins la tasse de thé du réalisateur et qui finissent un peu par brimer sa créativité. Pas que ce projet ne contienne pas une histoire intéressante, bien au contraire. Entre la pression des Jeux olympiques, les sacrifices des sportifs et la peur de l'après-retraite, il y a amplement de quoi piquer la curiosité au sein de cet essai qui pourrait bien être un mix entre Parfaites et Sarah préfère la course.
Surtout que la prestation de la nageuse Katerine Savard est généralement au point. Il y a bien quelques anicroches au niveau des répliques et de l'émotion, mais rien pour écrire à sa mère. C'est au contraire dans l'intériorité qu'elle se démarque. Une force tranquille faisant émaner une amertume et une solitude dont les effets ne laissent pas indifférents.
L'ensemble manque seulement un peu de finition - narratif, pas esthétique - ici et là, qui apparaît par des échanges moins naturels, des situations plus quelconques, des passages trop symboliques ou des élans quelque peu clichés sur la jeunesse. Par exemple, suite à une enchanteresse séance de discothèque qui aurait presque eu sa place sur le premier Mektoub, My Love d'Abdellatif Kechiche, la suite dans l'après-party déçoit par sa construction moins élaborée, ses stéréotypes éculés. Ce n'est évidemment pas suffisant pour entraver le plaisir rencontré, seulement diminuer l'impact escompté.
Le metteur en scène semble avoir moins de liberté qu'auparavant (la claque qu'était le court Blonde aux yeux bleues, l'ovni du plus long La génération porn), même s'il s'agit d'un sujet éminemment personnel. En guise d'analogie musicale, il y a l'opus d'auteur, de très grande classe, personnifiée par la musique de Beach House, qui a de la difficulté à coexister avec la production plus accessible et adolescente, façon Avril Lavigne. Pourtant lors de la finale de son précédent effort, une chanson de Daniel Bélanger chavirait l'âme, arrivant l'espace d'une séquence inoubliable à rallier ces deux solitudes.
Il ne faut toutefois pas oublier que Pascal Plante est encore jeune et qu'à l'image de son héroïne, sa quête identitaire se poursuit. Elle est déjà bien ancrée avec Nadia, Butterfly et elle risque de l'amener loin.