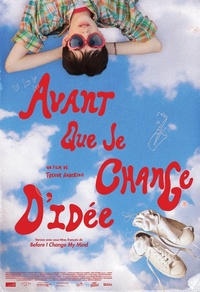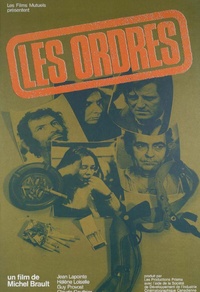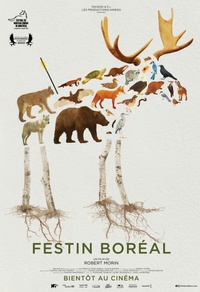Depuis qu'il a remporté les prix les plus prestigieux à Sundance en 2020, Minari séduit tout le monde sur son passage. Avec raison tant son charme et son humanité n'épargnent rien ni personne. Tout juste lauréat d'un Golden Globe, le long métrage vient d'être mis en nomination pour six Oscars, dont celui du meilleur film.
À première vue, il n'y a pourtant rien qui sépare cet opus des autres productions du même acabit. D'hier à aujourd'hui, l'immigration est un sujet éprouvé dans le cinéma américain et étranger, ayant abouti en de nombreuses oeuvres maîtresses. Cette histoire familière d'une terre d'accueil vue par ses nouveaux arrivants n'est toutefois pas traitée par la fresque grandiloquente, mais par l'entremise d'un regard intime et personnel d'un cinéaste qui s'est inspiré de son parcours et celui de ses parents.
Le récit forcément d'apprentissage et d'initiation en est donc un de rencontres, de frictions et de désillusions. Entre les États-Unis et une famille coréenne. Mais également entre un père qui aspire à de grandes choses et ses rêves qui se heurtent à la réalité de ses proches. Le désir d'une existence meilleure est à la portée de la main. Sauf que pour les atteindre il ne faut pas pour autant sacrifier l'équilibre familial.
De ces choix douloureux, Lee Isaac Hung (remarqué en 2007 avec Munyurangabo et qui devrait réaliser la très attendue adaptation du manga et anime culte Your Name) en a tiré un scénario riche, intelligent, sensible et d'un grand pouvoir d'évocation, qui fourmille de thèmes importants. En soignant ses plans tout en étirant le temps, le metteur en scène fait le pari de la vie ordinaire, ramenant la nature au coeur de ses préoccupations. Il veille méticuleusement sur son jardin fertile, luttant contre le déracinement en plantant tous les éléments nécessaires qui rejailliront avant la fin.
L'ensemble n'est pas toujours subtil (il y a même un travailleur qui porte littéralement une croix sur son dos), ce qui n'enlève rien à la beauté de la démarche. Surtout que l'ensemble fait rire et pleurer à la fois, alternant blague de pipi et bouleversante mélancolie. La musique sentie d'Emile Moseri (sur une lancée irrésistible depuis The Last Black Man in San Francisco et Kajillionaire) ajoute beaucoup à ce mélange d'allégresse et de tristesse.
Puis il y a ces magnifiques personnages, presque tous d'une justesse inouïe, qui font instantanément chavirer le coeur. C'est le cas du visage ensoleillé du jeune garçon (et alter ego du réalisateur), de la dévotion résiliente de maman (Han Ye-ri), de la force tranquille de papa (Steven Yeun de l'inoubliable Burning) et d'une grand-mère irrésistible campée par la truculente Youn Yuh-jung.
Finement écrit, d'une simplicité qui l'honore et entièrement centré autour de ses êtres attachants, Minari s'avère un splendide hymne à la terre et à la vie. Une oeuvre tendre et mature sur la famille et l'Amérique qui possède tous les prérequis afin de succéder à Parasite et de s'imposer à la prochaine cérémonie des Oscars.