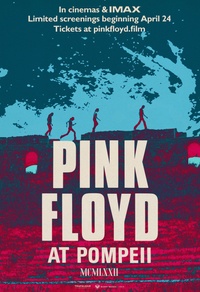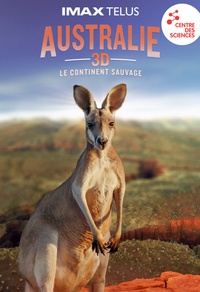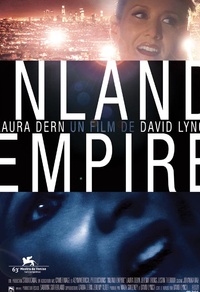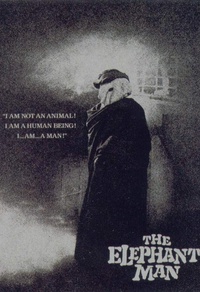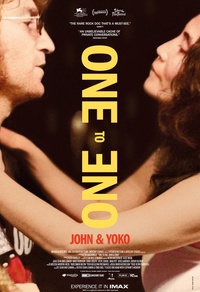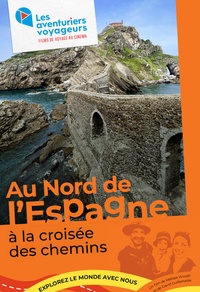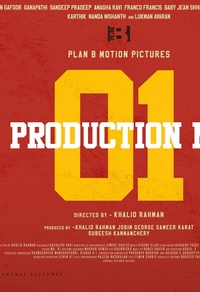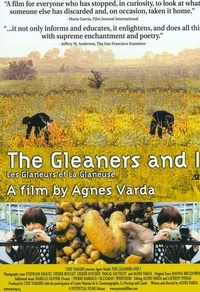Une décennie après son prenant Roméo Onze, Ivan Grbovic est de retour avec Les oiseaux ivres, un second long métrage encore plus maîtrisé et ambitieux, à classer instantanément parmi les meilleurs films québécois de l'année.
Il y a des rencontres difficiles à imaginer. Comme celle entre Willy, un Mexicain à la recherche de son grand amour, qui est embauché comme travailleur saisonnier au Québec sur la ferme Bécotte. Un choc de culture dû très souvent au manque de communication qui aura des répercussions insoupçonnées sur chaque individu.
Faire du neuf avec du vieux. C'est le mantra par excellence de cette création atypique qui se déroule entre ici et ailleurs. Il y a les thèmes nombreux et importants - relations entre exploitants et exploités, érosion de la cellule familiale, conséquences des mensonges et de l'ennui, absurdité des destins en marche, etc. - qui auront pu donner un essai formaté au possible, platement narratif. Ce que cet effort tente, sans cesser d'éviter malgré quelques retournements de situations prévisibles et des dialogues trop appuyés ou explicatifs.
Du banal réalisme, le récit fait plutôt le pari de l'onirisme. Le cinéphile se retrouve rapidement dans une sorte de rêve énigmatique, un fantasme magique qui ne manque pas de poésie. Un monde étrange, foisonnant et hypnotisant, qui répond à la logique même du cinéma. Bienvenue dans l'univers des possibles et c'est sans doute la meilleure façon de percevoir les symboles et métaphores qui fourmillent. Pas surprenant alors d'entendre un conteur et d'être littéralement projeté dans une de ses histoires en noir et blanc, rappelant par la bande l'importance à accorder aux quêtes romanesques, aussi obsessionnelles ou surannées soient-elles.
Tout cela est possible grâce à la photographie majestueuse de Sara Mishara (qui cosigne le scénario avec son amoureux Grbovic). Celle qui a offert quelques-unes des plus belles images du septième art québécois contemporain - des opus de Maxime Giroux à ceux de Stéphane Lafleur - propose ici une lumière bénie des dieux, faisant écho au chef-d'oeuvre Days of Heaven de Terrence Malick dans la multiplication des couchers de soleil. Sa caméra et son flair visuel en font pratiquement la co-réalisatrice de l'ouvrage.
Cela n'enlève rien au travail du cinéaste dont la grammaire cinématographique s'avère particulièrement élaborée. Sa mise en scène multiplie les plans ingénieux sans verser inutilement dans l'esbroufe. Son montage d'une précision chirurgicale au service d'ellipses réfléchies permettent peu à peu de mieux saisir l'essence de l'intrigue. Cela pourrait paraître maniéré, mais ça ne l'est jamais complètement. Puis il y a la musique minimaliste de Philippe Brault qui fait beaucoup avec peu. Des compositions qui contrastent avec celles, volontairement mélodramatiques, de son précédent travail sur Maria Chapdelaine.
Les oiseaux ivres se développe d'ailleurs aux antipodes de la production beaucoup plus classique et consensuelle de Sébastien Pilote. Autant dans sa façon de filmer la relation à la terre et au territoire que de réfléchir sur l'éternel questionnement entre partir ou rester. On y retrouve encore Hélène Florent dans le rôle d'une mère forte et triste, trouvant toutefois ici un personnage beaucoup plus complexe. À ses côtés se dresse l'impeccable Claude Legault (qui n'a pas été aussi habité au cinéma depuis 10 1/2) et la fortifiante Marine Johnson qui fait oublier quelques escapades moins convaincants à la ville. Ironiquement c'est le héros campé par Jorge Antonio Guerrero (découvert dans le Roma d'Alfonso Cuaron) qui présente la performance la plus effacée, la plus oubliable.
Sélectionné pour représenter le Canada dans la course pour l'Oscar du Meilleur film international, Les oiseaux ivres est un choix logique et conséquent. Cette oeuvre ouverte sur le monde et traitant de thématiques fédératrices sans oublier la notion d'artistique a, pour paraphraser Téléfilm Canada, « les meilleures chances de se classer parmi les finalistes de cette prestigieuse compétition. » Si tel est le cas, ce serait amplement mérité.