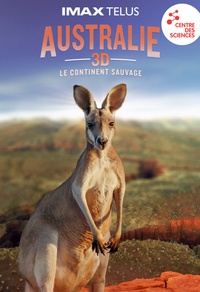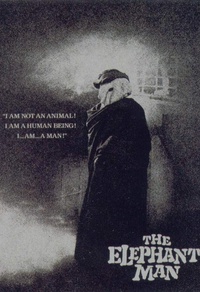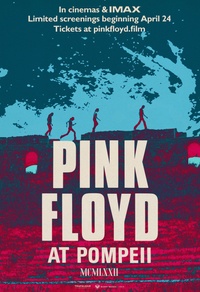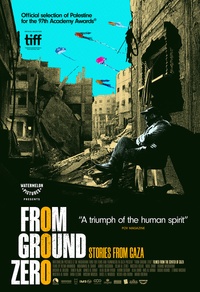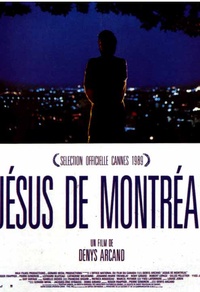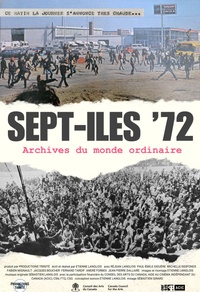Pas besoin de faire une recherche très exhaustive pour comprendre que la guerre - surtout la Seconde - est un sujet idéal pour le cinéma, dans presque toutes les cinématographies nationales. Les émotions et les gestes héroïques posés en temps de guerre forment des personnages de cinéma a priori fascinants. Et comme il n'est pas certain que les choses aient véritablement changé depuis ces démonstrations de fascisme et de racisme (le problème s'est à peine déplacé), ces reconstitutions historiques trouvent leur écho dans la société d'aujourd'hui.
Or, comme ces sujets sont souvent abordés au cinéma, ils deviennent parfois redondants et répétitifs. On n'en finit plus de compter les histoires de citoyens ordinaires qui aident les plus démunis en temps de guerre, au péril de leur vie (c'est aussi le cas, dans Les hommes libres), d'autant que le grand drame de l'histoire de la France, qui hante encore aujourd'hui les esprits français, la Collaboration, est une blessure vive qu'il faut apparemment encore cautériser. On en est encore à purger cette période sombre qui fait honte aux Français en punissant les coupables par procuration au cinéma.
Mais l'histoire de ces Hommes libres est inédite. Proposant une incursion dans le monde musulman de Paris et dans sa grande Mosquée, le film raconte une histoire pas comme les autres dans un contexte bien balisé. Quel dommage qu'elle soit si maladroitement racontée par un réalisateur aux tendances téléfilmesques et qu'elle se contente en fin de course de rejoindre les lieux communs du film de guerre. Il y avait une histoire tellement plus humaine et tellement plus universelle à raconter.
La caméra hésitante d'Ismaël Ferroukhi se contente de gros plans réducteurs et limitatifs et d'un montage utilitaire dénué de tout souffle artistique; on divise, on isole les personnages pour nous les montrer, eux, précisément, en tant qu'individus, alors que c'est l'histoire de tout un peuple qui est racontée. Ce problème, celui du plus petit dénominateur commun, n'est pas exclusif à Les hommes libres. On réduit, évidemment, à cause des limites du cinéma, la représentation des horreurs de la guerre à un ou quelques personnages que le public connaît. C'est donc tragique lorsque l'un d'entre eux est capturé, mais anodin lorsqu'un figurant est abattu, surtout qu'il l'est habituellement alors qu'il a « justifié » sa vie (ou sa mort) et qu'il peut, aux yeux du public, mourir en « paix ». Ce mécanisme n'est pas nouveau ni exclusif à ce film, mais il est grand temps de s'en affranchir car il dilue les émotions et dénature le concept d'humanisme.
Les comédiens Tahar Rahim et Michael Lonsdale s'acquittent bien de leur tâche, le premier étant à affiner et à diversifier son jeu, après sa performance mémorable dans Un prophète, le second étant en plein contrôle. Mais ce ne sont pas les performances d'acteur qui sont en cause ici, ce sont les habitudes télévisuelles et le manque de vision d'un réalisateur qui s'est contenté de bien peu niveau cinématographique. Le cinéma est un langage, il peu exprimer des choses que les hommes et les images fixes ne peuvent pas dire. Ferroukhi s'est contenté de raconter une histoire, nous voulions qu'il en fasse un objet de cinéma.