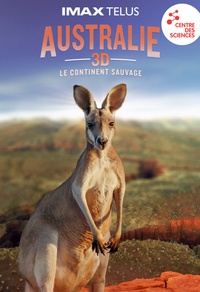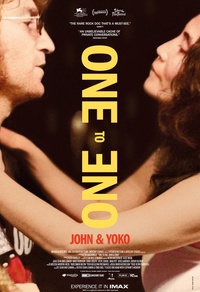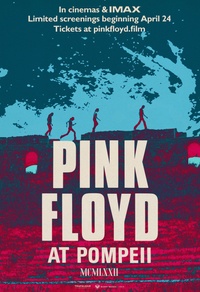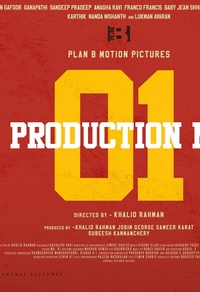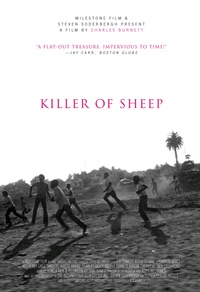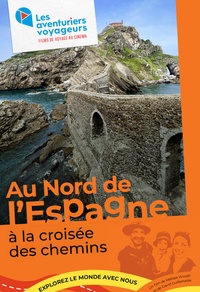Prouvant ainsi sa vitalité, le cinéma québécois offre chaque année une panoplie de premiers longs métrages réalisés par des cinéastes - souvent arrivés là par le court métrage (cette fois-ci Dust Bowl Ha! Ha!, en 2007) - qui proposent leur version du cinéma fait ici. Quel soulagement que cette créativité est foisonnante d'auteurs diversifiés et talentueux, qui proposent la plupart du temps une vision personnelle de leur milieu. Le plus récent à ajouter à cette liste : Sébastien Pilote, réalisateur de Le vendeur.
S'intéressant au quotidien banal d'un vendeur de voitures - le meilleur de la région - Le vendeur propose un portrait minutieux et patient d'un homme simple en apparence (comme il y en a tant, pourrait-on dire), qui s'avère être d'une grande richesse en tant que personnage de cinéma. Parce que sa simplicité est complexe : ses gestes sont simples, mais pas ses motivations, et on passe une bonne partie du Vendeur à essayer de le comprendre. C'est un exercice qui est fascinant lorsqu'il est si bien mené.
Au centre de cette réussite, Gilbert Sicotte, un grand acteur en parfaite maîtrise de son art, utilisant merveilleusement sa voix si particulière, afin d'incarner ce personnage de vendeur qui vend simplement des voitures. Vrai que décrit comme ça, ça n'a pas le charme de robots extraterrestres combattant pour sauver la planète ou d'une histoire d'amour épique étalée sur plusieurs décennies. Mais c'est bien plus humain et universel comme récit, tant les détails sont si efficacement manipulés par Pilote afin de contribuer à sa narration.
Sicotte est excellent, d'autant plus qu'on le voit si rarement au cinéma (La vie secrète des gens heureux), dans des rôles souvent modestes (Continental, un film sans fusil), mais puissants, qu'il est d'autant plus fort et engageant dans le rôle central de Marcel Lévesque. Cette humanité, décrite à petites doses dans la réalisation, trouve écho dans les émotions, fortes et affirmées, que propose le film. Justement, le défaut du film est quelque part dans cette finale qui s'étire trop; lorsque l'émotion frappe, pratiquement sans prévenir, on est chamboulé par sa force tranquille. C'est là qu'on saisit toute l'importance de ce temps qui passe, de cette mise en place, ce souci du détail qui démontre comment l'amalgame des spécificités cinématographiques peut créer des réactions chimiques à l'amplitude inégalée dans bien d'autres arts; mais voilà, parce que le film ne se contente pas de finir, tout simplement, cette émotion est diluée à travers quelques soubresauts narratifs qui tentent de contourner une émotion difficile qui découlait si simplement de la mise en contexte.
On aurait voulu partir avec cette émotion, marcher avec elle, la garder pour soi au moins quelques minutes, pour voir l'impact qu'elle aurait pu avoir sur nous. C'est l'avantage qu'ont ces films simples sans robots ni extra-terrestres : on peut profiter de ce que vivent les personnages pour l'appliquer sur soi. Ici, le drame est exclusif à Marcel Lévesque, et il s'en affranchit même, d'une certaine façon, lors du dénouement. Ce drame n'est pas pour nous, même s'il nous atteint. Dommage, mais cela n'enlève rien à l'efficacité du long métrage, qui ouvre la porte à un nouvel auteur dans le paysage cinématographique québécois.