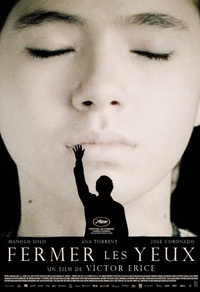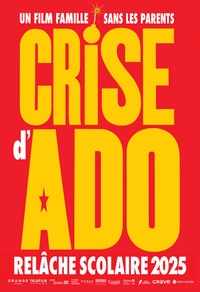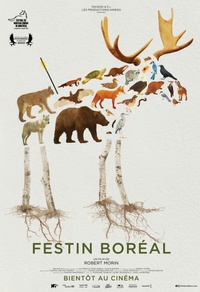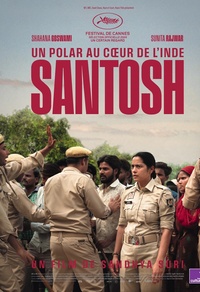Si le cinéma a un jour le pouvoir de changer quelque chose, comme il prétend le faire si fréquemment, c'est à travers des films comme Le ring qu'il y parviendra. Simple, clair, complet, le long métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette a du respect et de l'empathie pour son sujet, et ça paraît. Âgé d'à peine douze ans, le petit Jessy vit dans Hochelaga-Maisonneuve avec son père alcoolique et sa mère toxicomane. Affamé, Jessy ne fréquente pas beaucoup l'école et préfère passer son temps avec l'itinérant du quartier. Alors que son frère l'entraîne dans des magouilles de plus en plus sérieuses, Jessy continue de rêver : il veut devenir lutteur. La performance de Maxime Desjardins-Tremblay, un « initié », natif du quartier, rend tout à fait justice au scénario complet et laconique de Renée Beaulieu. Son interprétation d'un naturel désarmant suinte l'honnêteté, la vraie vie. Beaucoup du succès du film passait par là, ce réalisme qu'on n'atteint jamais au cinéma mais dont ne peut se passer. Le thème de l'enfance est en plein centre des préoccupations du film, avec ce portrait humain (et, au fond, très féminin) de Jessy, mais aussi de son frère et de sa soeur aînée (excellente Julianne Côté), qui ont leurs propres problèmes. Le ring met en scène de brillante façon la vie de gens ordinaires, qui ne sont pas en peine d'amour, qui ne se révoltent pas contre le gouvernement, qui vivent le quotidien un round à la fois. Un coup de poing au visage à la fois. Parce que dans Hochelaga, il fait gris, on trouve des prostituées au coin de la rue. Et tout de même, les moments de fraternité entre les membres de la petite famille parviennent à être les plus touchants du lot. René-Daniel Louis incarne magnifiquement un entraîneur de lutte qui fait le contrepoids à tout ce drame - qui s'accumule en effet un peu exagérément - et remet encore une fois les choses en perspective. Peut-être fait-il froid dehors, mais dans le sous-sol d'église où on joue à se lancer dans les câbles avec des costumes farfelus et du maquillage, il fait chaud. Les ventres gargouillent probablement depuis le matin, mais ces hot-dogs suffiront. Et la dignité, en plus, qui vient mettre un point final à l'histoire d'un combattant qui n'a pas encore envisagé la défaite et qui n'a pas l'intention de laisser de chance à son adversaire. Pas de fioritures dans la réalisation, pas de « concept », seulement des cadrages serrés qui ne prennent jamais en pitié. Le portrait d'une famille dans un quartier, vivant une étonnante symbiose. Simple mais pas simpliste et surtout pas infantilisant, Le ring fait ce qu'il faut pour émouvoir et choquer. Pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer les besoins des personnages. Le ring a l'extrême mérite d'exprimer les choses simplement, pour qu'elles soient claires. « Papa, j'ai faim, hostie. », de crier son personnage principal, à demi-nu sur le balcon. Le passé ne compte pas, on n'envisage pas l'avenir tout de suite. Ce n'est pas plus compliqué que ça, asteure (sic!) fait quelque chose.
Si le cinéma a un jour le pouvoir de changer quelque chose, comme il prétend le faire si fréquemment, c'est à travers des films comme Le ring qu'il y parviendra. Simple, clair, complet, le long métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette a du respect et de l'empathie pour son sujet, et ça paraît.