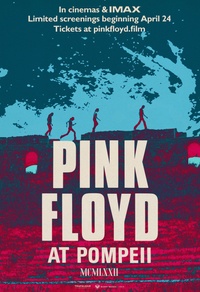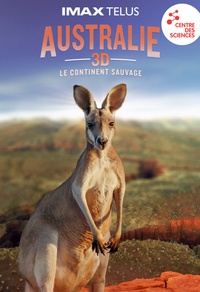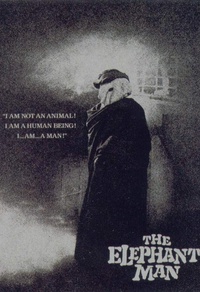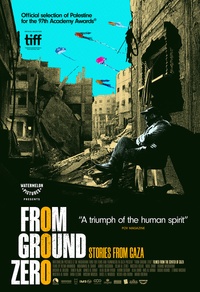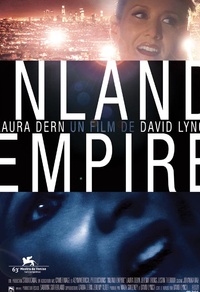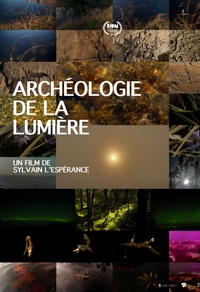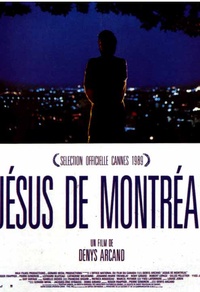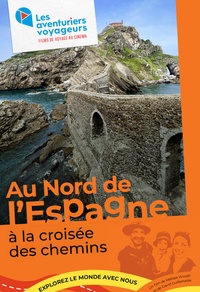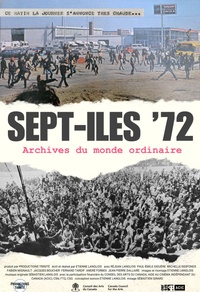Dans le cinéma de Darren Aronofsky, les dépendances semblent être les éléments convoyeurs des récits. Son oeuvre la moins forte (The Fountain), s'en éloignait justement, entre deux nébuleuses extrasolaires et les Conquistadors, tandis que son chef-d'oeuvre (Requiem for A Dream) s'y consacrait entièrement, de l'évidente dépendance à la drogue à celle à la télévision. The Wrestler abordait de la même manière la dépendance d'un homme pour son métier, et Black Swan, la folie d'une danseuse timide pour qui le ballet est la seule raison de vivre.
À New York, Nina Sayers est choyée d'apprendre qu'elle incarnera le personnage principal du ballet Le lac des cygnes que prépare le metteur en scène Thomas Leroy. Pour ce dernier, il ne fait aucun doute que Nina est l'interprète idéale du Cygne blanc, mais il ne la croit pas capable d'incarner le Cygne noir. Sa rigueur au travail et sa précision sont exemplaires, mais elle manque de sensualité. Afin de s'ouvrir au rôle, Nina se rapproche de Lily, une danseuse plus incarnée qui attire l'attention du metteur en scène. Pendant les répétitions, Nina sombre dans la folie.
Contrairement à ce qu'on verrait dans d'autres films du genre, Nina n'a pas de difficulté à apprendre la chorégraphie du Lac des cygnes et le film n'est pas la démonstration de ses efforts. On s'intéresse plutôt à l'impact de ce rôle sur sa vie et sur sa personnalité. Et cette intrusion dans l'intimité d'une danseuse - elle pourrait être comédienne, musicienne, peintre, etc. - est d'une ampleur enivrante, d'autant que le film ressemble davantage à un film d'horreur qu'à un film de ballet. Et le personnage de Nina en subit les conséquences.
Le talent d'Aronofsky est de l'avoir mise à l'écran avec cette dualité. Mais l'accumulation des hallucinations s'avère parfois répétitive, le mécanisme étant inutilement lourd face à l'impact émotif souhaité. Il en va de même pour les bruits d'ailes qui, plus subtiles au départ, ajoutent au mystère avant de souligner maladroitement l'évidence lors de la finale. Les quelques effets spéciaux du film déçoivent eux aussi quelque peu (à l'exception de la scène finale); ils sont si peu nombreux qu'on aurait certainement pu s'assurer de leur qualité.
La finale, qui est certainement un magnifique moment de cinéma, est construite minutieusement par une montée dramatique savante. Rien d'inhabituel chez Aronofsky, qui s'établit avec ce film comme un fin monteur et un directeur d'acteurs de premier plan. La portée métaphorique des personnages de Black Swan rappelle le travail que doit effectuer le comédien à chaque fois qu'il endosse un nouveau personnage, et c'est l'occasion pour Natalie Portman de démontrer une redoutable force autant qu'une délicate fragilité, qui rappellent justement l'art du ballet. Vulnérable mais entièrement dédiée.
En posant ce regard cruel - mais humble tout de même - sur l'acte artistique, en soulignant qu'il faut être humain, donc imparfait (par extension sexué), donc vivant, pour pouvoir faire naître la beauté (ou sa manifestation en valeur négative, l'horreur) chez nos semblables, on se souvient qu'on trouve souvent l'émotion là où on s'y attend le moins. On réalise que les efforts ne remplacent pas le talent, et qu'ils ne sont pas, comme on essaie pourtant de nous le faire croire, gages de succès. Parce qu'il l'a oublié quelques fois, Aronofsky en fait trop, et ne réalise pas l'oeuvre la plus forte de l'année. Mais il est passé près.