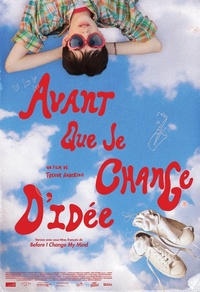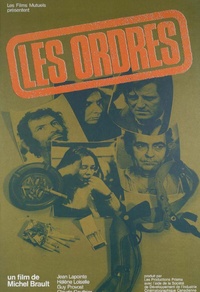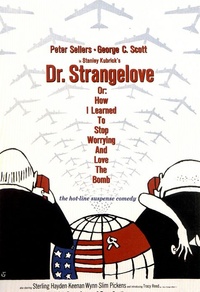Le concept, c'est de mettre une marionnette à la main gauche de Mel Gibson et de le laisser se débrouiller avec ça. Déjà, on sourit. Parce qu'au-delà de son image publique récente, Gibson est un acteur de grand talent qui a un charisme fou. Mais étonnamment, Mel Gibson qui parle à un castor en peluche pendant 90 minutes, ce n'est pas si drôle que ça. Il en faut donc davantage : une histoire familiale tordue, une compagnie à redresser, un fils adolescent et ses mésaventures, un couple vacillant... voilà qui s'avère beaucoup plus prévisible que promettait de l'être The Beaver.
Il faut admettre qu'on n'avait pas vu Gibson aussi en forme depuis un bon moment sur les couvertures de nombreux tabloïds américains. Aussi touchante que drôle, sa performance est renversante de candeur et de véracité. Les rapports de Walter avec ses fils et sa femme, malgré les revirements assez prévisibles du récit, sont crédibles et souvent même émouvants. C'est parce que sa dépression est abordée avec humour et légèreté (même une tentative de suicide s'avère burlesque) qu'on peut ainsi mieux s'identifier au personnage et mieux chercher à comprendre la douleur qu'il ressent et sa vulnérabilité. Un ton didactique ou moralisateur aurait eu l'effet inverse.
Malheureusement, tous les personnages ne sont pas aussi intéressants. Sa femme, Meredith (Jodie Foster, qui s'acquitte aussi de la réalisation), est assez stéréotypée, tandis que son fils aîné, Porter (incarné par un Anton Yelchin trop mature pour le rôle) vit toutes sortes de mésaventures scolaires assez mal intégrées au récit. Son discours et son histoire d'amour sont assez peu inspirants, et nous éloignent du point principal : Gibson et sa marionnette. Heureusement pourtant, là non plus le ton n'est pas mélodramatique, et on parvient même à surprendre avec quelques retournements du récit qui sont assez audacieux et qui sont bienvenus car ils permettent de relancer l'histoire, qui a quelques temps morts.
La réalisation de Foster s'avère elle aussi assez peu inspirée, entre une féérie factice qu'on voudrait apparemment comparer à American Beauty et la simplicité pragmatique d'une histoire à raconter. La caméra ne parvient pas à ajouter au récit et aux prestations des comédiens autre chose que ce qu'ils sont déjà, ce qui se retrouvait sans doute déjà au scénario.
Rien de tout cela n'aurait d'importance si la proposition était aussi drôle qu'on pouvait le croire à la lecture du synopsis. Mais il n'en est rien. Car après quelques blagues d'usage (qui misent toute sur l'incongruité de la situation de parler à un homme adulte et son jouet en peluche), on se rend vite compte qu'il n'y a rien de très drôle dans tout ça. Dommage, parce que c'était justement ça l'idée : parler de choses sérieuses au travers de l'humour, pour qu'on soit plus réceptif à y réfléchir. Au début du film, Walter Black a un problème : la dépression. À la fin du film, il a un autre problème : une schizophrénie. Qu'est-ce à dire sur la dépression pathologique?