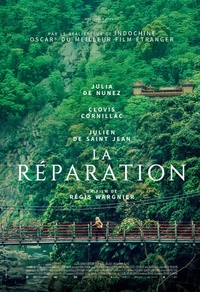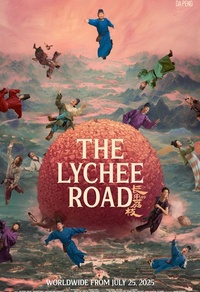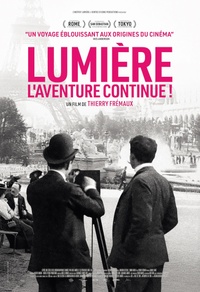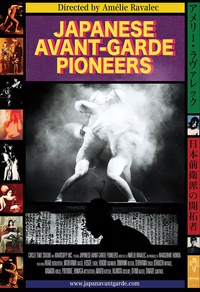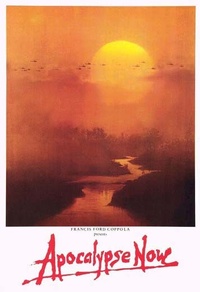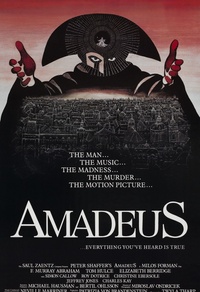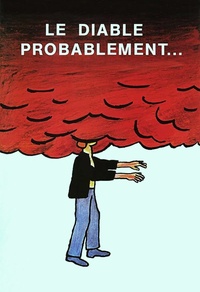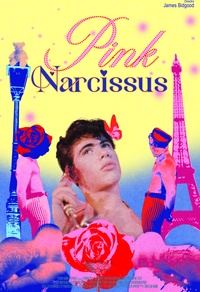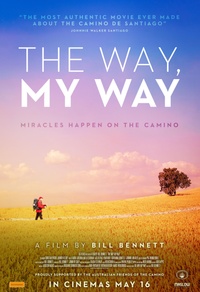On savait déjà que Quentin Tarantino marquerait l'histoire. Ses films, de Pulp Fiction à Kill Bill, des fables ludiques sous fond d'ultra-violence, avaient leur manière spécifique, aujourd'hui théorisée, de fasciner le cinéphile (nom masculin et adjectif signifiant « amateur de cinéma », ou, « consommateur de cinéma ». À définir : « cinéma »). Voilà que l'Histoire marque Quentin Tarantino. S'attaquant, en s'octroyant tous les droits, aux années de l'Occupation nazie, le cinéaste réalise ce qui pourrait bien être son meilleur film, parce qu'à sa théorie du cinéma, il ajoute le commentaire social. Un commentaire choquant, abscons certainement, qui fait de ses héros de sanguinaires « bâtards inglorieux » (sic), semblables à la Bête. Il y a les rats, les aigles, les traîtres et les bâtards.
Le Lieutenant Aldo Raine réquisitionne huit soldats Juifs-Américains qui sont parachutés en France occupée afin de décimer les troupes nazies. Mis au courant que la première d'un film mettant en vedette un jeune héros de guerre allemand se déroulera dans un cinéma parisien géré par Shosanna, jeune juive ayant échappé de justesse au massacre de sa famille par le Colonel Hans Landa, les « Bâtards » se rendent à Paris afin de gâcher la petite fête organisée par les SS. Shosanna a elle aussi un plan afin de se venger : elle envisage de fermer les portes et de mettre le feu à son cinéma (le fantasme, fort possiblement, de l'ensemble des réalisateurs, si on remplace les Nazis par les critiques de cinéma...).
On a parfois l'impression, au cinéma, d'entamer un dialogue avec l'auteur du film (pour peu que ce dernier s'en donne la peine...), mais on a rarement l'impression d'être pris au sérieux. Les déroulements prévisibles et fins consensuelles sont d'affligeantes tares pour le cinéma (américain, mais pas seulement). Avec son Inglourious Basterds, Tarantino fait une nouvelle fois la preuve qu'il connaît et qu'il manipule le cinéma. Insolent, il fait subir à son spectateur de multiples digressions, d'un narrateur impromptu à des notes écrites directement sur l'image, et semble admettre et accepter que son spectateur ait vu un grand nombre de films. Cela réduit considérablement le nombre d'irritants causés par le mépris que portent les réalisateurs pour la masse populaire qui consomme le cinéma comme un divertissement. Le déroulement du film en est dynamisé, sans cesse renouvelé puisque jamais là où on l'attend. Des personnages sont sacrifiés pour que le déroulement du film étonne encore les plus sceptiques, tandis que les dialogues sont, comme toujours, de haute-voltige.
Or, Inglourious Basterds est un divertissement. Drôle, bien rythmé même si frappé de quelques longueurs, bourré de fusillades et d'explosions, le film a tout d'un blockbuster; même les vedettes. Il n'en est pourtant pas un. Le soin porté aux langues (les Français parlent le français, les Allemands l'allemand et les Américains l'anglais... enfin, un peu de rigueur!) est un autre symptôme du sérieux avec lequel Tarantino envisage sa tâche. Et la grandiloquence avec laquelle il s'approprie les droits de l'Histoire, postmoderne et fascinante, presque caricaturale, repousse les limites du « permis » et de « l'interdit ».
C'est donc un festin cinéphilique, comme toujours chez Tarantino, que de se soumettre à Inglourious Basterds. L'expérience, sans doute la plus fascinante de l'année, souffre de quelques longueurs, en effet, et de quelques interprétations plus... disons, moins... rigoureuses, mais on a quand même droit à un récit grandiose, une intensité rare, glorifiée par la musique, par les images, magnifiques, et par une caméra qui, contrairement à bien d'autres, plus anonymes, n'est pas qu'un moyen de montrer, mais aussi de faire vivre.
Et le dialogue avec le réalisateur se termine en même temps que le film : « I think this might be my masterpiece. »