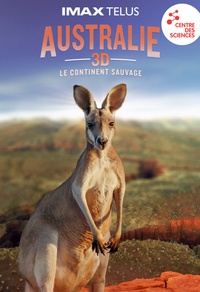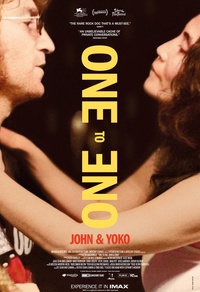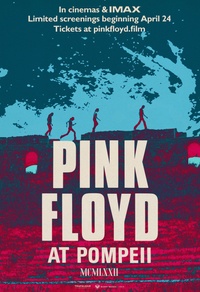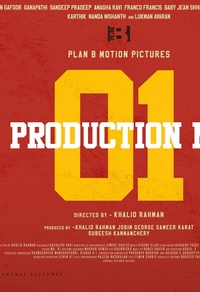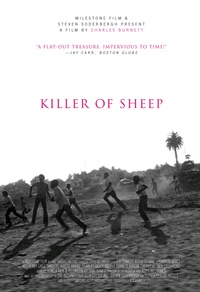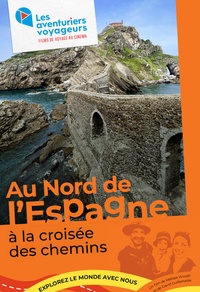Après avoir transposé Le torrent d'Anne Hébert au cinéma, Simon Lavoie s'attaque à La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy, autre livre jugé inadaptable. Une relecture d'une grande beauté plastique dont l'immense intensité laisse toutefois sur sa faim.
La ruralité canadienne-française est à la mode dans le cinéma québécois. Ce long métrage se rapproche toutefois davantage du brutal Les affamés que du trop doux Pieds nus dans l'aube. Il s'agit pratiquement d'une oeuvre horrifique dans sa description d'un milieu étouffant régi par le mensonge et l'obscurantisme. Celui d'un clergé sur ses fidèles et d'un père (Jean-François Casabonne) qui isole ses enfants. Une métaphore foudroyante de la Belle Province d'antan et de plusieurs sociétés contemporaines.
Le récit initiatique de l'héroïne (Marine Johnson) en quête d'émancipation et de son frère (Antoine L'Écuyer) n'est toutefois pas le plus aimable. Il y a des viols dans l'air, de la violence, beaucoup de cruauté, des porcs qui copulent et même une bête grotesque enfermée dans la grange. Une horde de symboles sur la douleur quotidienne qui donne froid dans le dos.
Ce climat d'épouvante est sans cesse transporté par une hallucinante et très sensorielle photographie en noir et blanc. La lumière réchauffe les âmes, avant de devenir plus opaque et d'alimenter les cauchemars. Une atmosphère suffocante qui permet de s'élever du réel, là où la menace semble perpétuelle. Des images à la fois poétiques et gothiques, presque inédites dans notre cinématographie.
Tout cela demeure très intéressant. Surtout que l'interprétation chargée de talentueux acteurs (retenez le nom de Marine Johnson tant on risque d'en réentendre parler bientôt) s'avère dans l'ordre de ces personnages oppressés et hystériques.
Qu'est-ce qui cloche d'abord? Le scénario trop démonstratif qui finit par expliquer tout le mystère en place au lieu de se fier à l'ambiguïté. Des dialogues ampoulés qui manquent de naturel. Un rythme instable où il est parfois difficile de s'agripper. Plusieurs ruptures de ton qui forcent inutilement l'étrangeté. Ainsi qu'une pléthore de thèmes intéressants (identité, féminité...) explorés superficiellement et peu subtilement, laissant trop souvent l'émotion de côté.
Ce qui agace le plus est ce désir de vouloir jouer à l'Auteur avec tous ces tics prétentieux. Comme sur son précédent Le torrent, le cinéaste semble parfois trop se complaire, se regarder filmer. Ici, c'est le clin d'oeil à Carl Theodor Dreyer. Là-bas, c'est le plan-séquence façon Béla Tarr. Puis, il y a cette fuite devant un bâtiment en feu qui fait clairement référence au chef-d'oeuvre Le sacrifice d'Andreï Tarkovski. Simon Lavoie a beau avoir les meilleures influences du monde, il faut savoir les digérer et s'en détacher. Icare s'est brûlé les ailes en se prenant pour Dieu et c'est un peu le cas du metteur en scène. C'était peut-être ça au fond le rôle de Mathieu Denis, son coréalisateur des supérieurs Laurentie et Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau: catalyser sa radicalité pour offrir quelque chose d'unique, de complètement authentique.
Cela ne fait pas de La petite fille qui aimait trop les allumettes un mauvais film pour autant. Il s'agit même d'un des récits québécois les plus soignés de l'année, l'un des plus audacieux. C'est juste que l'ensemble avait tout en sa possession pour être plus mémorable que le résultat final. On le prendra alors comme un objet de curiosité, obsédant au possible.