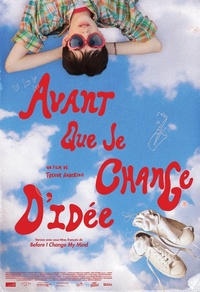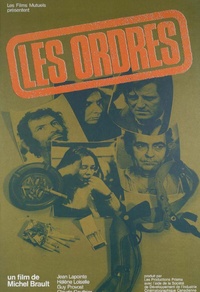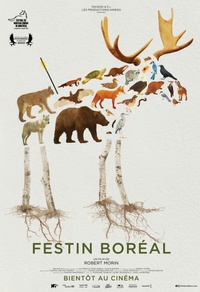Le septième art fait drôlement les choses. Lorsqu'un événement bouleverse la vie de tous les jours, il y a généralement un film qui prend l'affiche au même moment pour en parler. Devant la vague de réfugiés syriens qu'accueille et qu'accueillera le Québec, Là où Atilla passe sort sur les écrans de façon prophétique et il traite du déracinement, de la difficulté de l'intégration, du manque de repères, de l'isolement et de l'aliénation du quotidien. Des thèmes universels qui se répercutent à tous les niveaux.
Comme toute chronique qui se respecte, ce n'est pas tant l'histoire qui est intéressante que les personnages. Atilla (Émile Schneider), un jeune homme de 20 ans d'origine turque, a des problèmes de comportement, au grand dam de ses parents adoptifs (Roy Dupuis, Julie Deslauriers). Mais lorsqu'il rencontre une belle étudiante turque (Dilan Gwyn) qui est sur le point de retourner chez elle, tout risque de changer...
Chacun des individus de ce film chaleureux, doux et sincère est prisonnier d'une solitude latente, de deuils à faire et de rêves à conquérir. Un menu parfois trop chargé, surtout si l'on rajoute à ça le désir d'émancipation d'une jeunesse et une relation père/fils qui n'est pas piquée des vers. Très attachants, les personnages existent réellement à l'écran et malgré la forte présence d'Émile Schneider (vu dans Après la neige et bientôt dans Le rang du lion), son personnage est certainement le plus antipathique du lot. On se surprend à suivre davantage la distribution secondaire: Roy Dupuis qui est devenu un expert dans le non jeu et la réplique humoristique bien placée, la trop rare Julie Deslauriers qui fait passer ses émotions par ses yeux et les êtres qui côtoient Atilla et qui souffrent en silence.
Ne maîtrisant pas encore totalement le pouvoir des mots qui peuvent être encombrants à quelques occasions et des métaphores trop appuyées, le cinéaste turc Onur Karaman qui a grandi au Québec a pris du gallon depuis son précédent long métrage La ferme des humains. Il laisse son essai trouver et imposer son propre rythme, utilisant sobrement sa mise en scène ponctuée de plans larges sans verser dans l'esbroufe (il y a bien une ou deux exceptions, comme cette caméra qui part soudainement dans le ciel et ces ellipses qui ne sont pas parfaitement intégrées). Ses envolées poétiques et lyriques vers la lumière évoquent le cinéma de Terrence Malick, sa romance touche parfois la grâce d'un Félix et Meira et si les écueils du mélo moralisateur font leur apparition à la toute fin, ils ne gâchent en rien le bonheur éprouvé. Le réalisateur possède cette rare faculté à créer presque instantanément une ambiance particulière, une atmosphère qui fait entrer tout le monde dans la danse et qui donne le goût de connaître cette culture turque par sa musique et sa nourriture, ses moeurs et ses riches personnages.
Les films qui traitent des communautés culturelles n'étant pas nombreux dans notre cinématographie (les plus marquants étant probablement Roméo Onze et L'ange de goudron), Là où Atilla passe y trouve une place à part. Malgré toutes ses légères imperfections, on retient une oeuvre charmante et bien de son temps, qui réfléchit sur l'existence sans se prendre la tête inutilement.