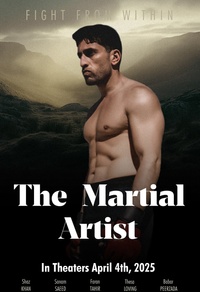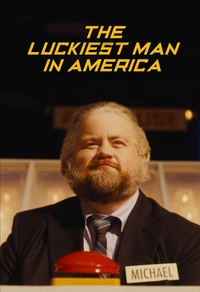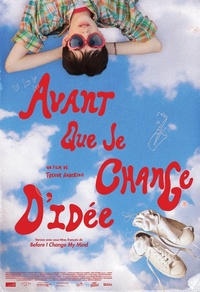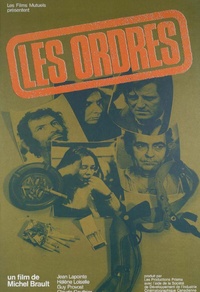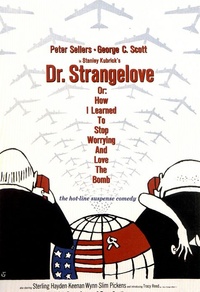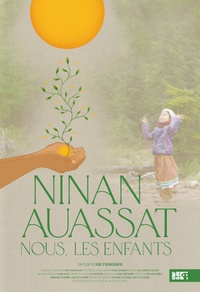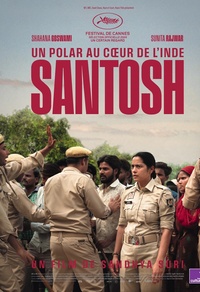Il y a des films qui ne semblent exister que pour remporter des prix. C'est le cas de Empire of Light.
Se déroulant dans l'Angleterre du début des années 80, le long métrage met en scène une femme (Olivia Colman) souffrant de problèmes de santé mentale et un jeune homme (Micheal Ward) qui est victime de racisme. Ensemble, ils pourront peut-être résister au monde extérieur et faire disparaître leur solitude.
Réalisateur de grandes fresques dont American Beauty, Revolutionary Road et Skyfall, Sam Mendes a la main lourde avec son premier scénario écrit en solo. Vouloir traiter d'enjeux importants comme le racisme et la maladie mentale est noble : il faut seulement savoir le faire correctement. C'est d'ailleurs tout le problème de ce script manipulateur et superficiel, qui ratisse large en y adjoignant une relation amicale et même amoureuse. Cela se fait en vain tant les enjeux laissent complètement indifférents. Après son flamboyant exercice de style 1917, le cinéaste retourne à un récit beaucoup plus lent et posé, qui se veut vite banal, ennuyant et décevant. L'ensemble est peut-être très personnel, le traitement, lui, apparaît plutôt plaqué.
Ce n'est pourtant pas la faute des acteurs. Sur une lancée irrésistible depuis The Favourite, The Father et The Lost Daughter, Olivia Colman est une nouvelle fois extraordinaire dans la peau d'un être malmené par le destin qui aspire seulement au bonheur et à la sérénité. Face à elle se tient le charismatique Micheal Ward, découvert dans le brillant Small Axe: Lovers Rock de Steve McQueen. Les deux comédiens affichent une forme resplendissante, même si leur chimie n'apparaît jamais très palpable et crédible à l'écran. Colin Firth fait ce qu'il peut dans un rôle ingrat (un patron qui se croit tout permis envers ses employés) et Toby Jones incarne un projectionniste dévoué.
En plus de jouer sur les plates-bandes sociales et politiques, Empire of Light se déroule principalement dans un cinéma. L'idéal afin de séduire l'Académie des Oscars, s'il faut se fier aux sacres de Birdman et The Shape of Water. On a ainsi droit à un passionnant cours sur la lumière et le métier de projectionniste. Malheureusement pour Mendes, The Fabelmans vient de prendre l'affiche et il n'y a personne de plus compétent que Steven Spielberg pour parler des rudiments du septième art et de la magie du cinéma.
Sur le simple plan esthétique, cette production en impose. Les plans majestueux sont nombreux, autant ceux se déroulant au bord de la plage que les feux d'artifice. Normal quand il s'agit du chevronné Roger Deakins à la photographie. Ses images sont tellement splendides que ce sont elles qui véhiculent l'émotion. Elles sont secondées par la bande sonore particulièrement inspirée de Trent Reznor et d'Atticus Ross, dont le processus créatif est en effervescence depuis le récent Bones and All. C'est la musique qui dynamite les moments les plus puissants - comme l'émeute - afin de les élever.
C'est à se demander ce qu'aurait donné Empire of Light avec un scénario digne de ce nom. Sûrement à un résultat plus subtil, enlevant et convaincant. Sam Mendes demeure un excellent cinéaste, même en mode intimiste, et il a seulement besoin de quelqu'un de compétent pour concocter et développer les histoires qu'il met en scène. Cela fait toute la différence entre un film qui arrive à recréer la vie et celui qui s'enferme dans la simple illusion de l'existence, forcément plate et plus ou moins crédible.