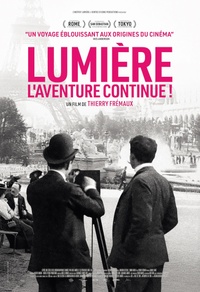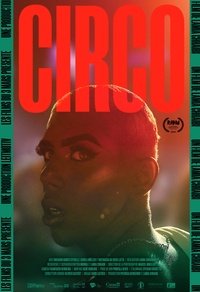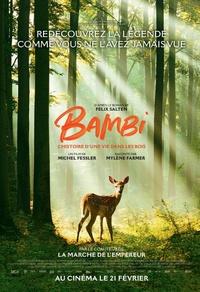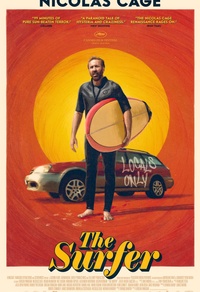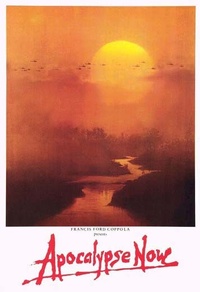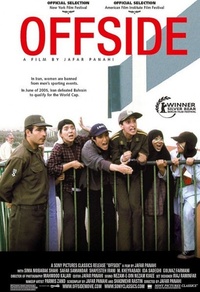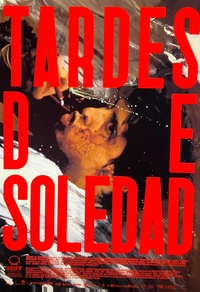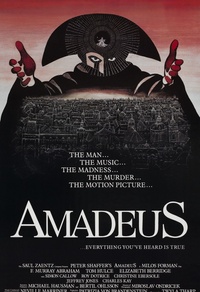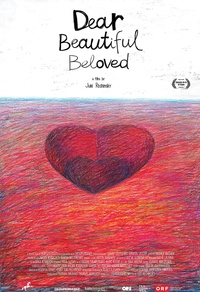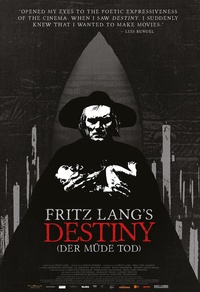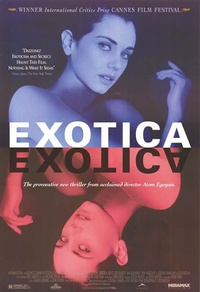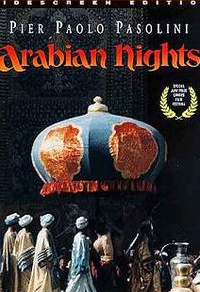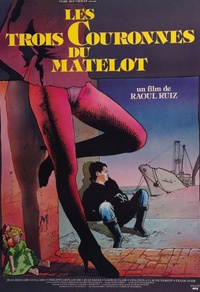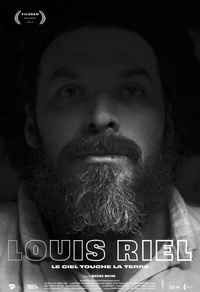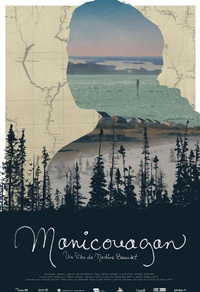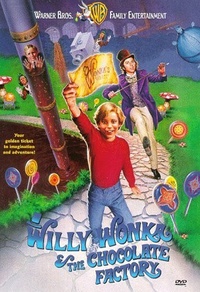On n'a plus les films de Pâques qu'on avait. Avant, ils s'apparentaient à des péplums spectaculaires et violents comme Ben-Hur et The Passion of the Christ. Maintenant, ils sont beaucoup plus insidieux, mettant souvent le cinéma de côté pour se concentrer sur leurs insistants messages religieux. C'est le cas du plus que douteux Father Stu.
Inspiré d'un fait véridique, cette quête de rédemption est celle de Stuart (Mark Wahlberg), un ancien boxeur qui, après avoir frayé avec Hollywood et la boisson (deux suppôts de Satan, tout le monde le sait), retrouve le droit chemin en allant à l'église. Au début, c'est pour les beaux yeux de Carmen (Teresa Ruiz). Mais peu à peu, sa conscience se développe au contact de Dieu et il veut devenir prêtre. Peut-être que cela pourra lui permettre de se rapprocher de son propre père colérique (Mel Gibson). Ni la maladie, ni un accident de la route ou le jugement des autres ne pourront ébranler ses convictions.
Depuis quelques années, ces longs métrages qui semblent propager les discours de propagande de la droite religieuse américaine sortent en douce, rarement sur les écrans et principalement par l'entremise des plateformes. Le péché est partout, les âmes sont damnées et seule la foi peut sauver l'humanité. L'important est de véhiculer des messages lourds et édifiants, puis de présenter une horde de métaphores - toujours les mêmes - où il est question de la lumière qui guide et de la figure réconfortante de la Vierge Marie. Presque toute l'iconographie chrétienne y figure, pendant plus de deux heures.
Ce type de récit est rarement produit par un acteur de renom. C'est pourtant le cas ici avec Mark Wahlberg qui, après le presque aussi pénible Joe Bell, s'intéresse à une nouvelle histoire vraie lénifiante. L'occasion est belle pour le comédien, qui n'a jamais été un enfant de choeur, de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Que ce soit de passer de la comédie au drame et de prendre du poids dans cette incarnation moderne de la parabole de Job. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour impressionner les bonzes de l'Académie. Car rien n'est naturel dans son jeu et encore moins dans cette création prévisible et imbuvable qui s'abreuve du moindre cliché. La première partie singe The Fighter, le reste est encore pire et la conversion du héros n'apparaît jamais plausible. On est loin du protagoniste de La communion qui empruntait des chemins similaires en surprenant constamment, ou celui de First Reformed qui cachait une véritable blessure.
Si ce n'est pas suffisant, un second dessein se dessine en filigrane. Rosalind Ross qui signe le scénario (d'un classicisme qui donne la nausée) et la réalisation (académique et portée par des mélodies laissant à désirer) semble être là pour réhabiliter Mel Gibson, son amoureux dans la vie. Une star déchue vilipendée par Hollywood après des déclarations antisémites et qui erre depuis longtemps dans le désert, enchaînant plus souvent qu'autrement les rôles douteux, dont récemment celui d'un Père Noël blasé dans Fatman. Son personnage irascible envers sa progéniture (Gibson et Wahlberg campaient déjà un duo père/fils dans le consternant Daddy's Home 2) va lui aussi s'illuminer et devenir une meilleure personne, aller aux séances des alcooliques anonymes, retrouver la foi et se rapprocher de son ancienne femme (campée par la toujours juste Jacki Weaver). Après avoir expié ses fautes, peut-être s'attend-il à être accueilli à bras ouvert par l'industrie, prête à le voir reprendre du service pour Lethal Weapon 5...
Dans une existence où les épreuves sont déjà suffisamment nombreuses, pourquoi vouloir en rajouter une nouvelle avec Father Stu?