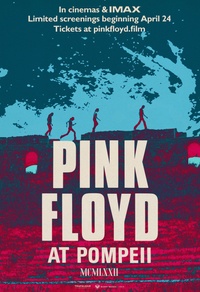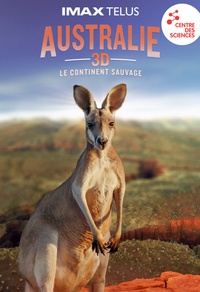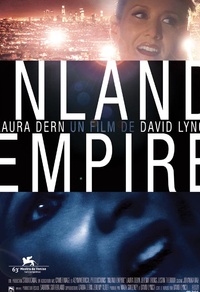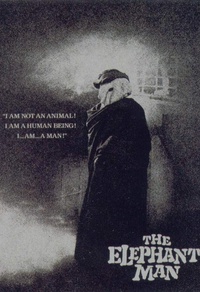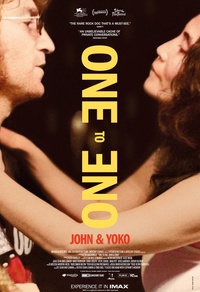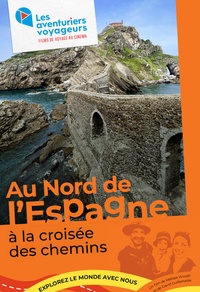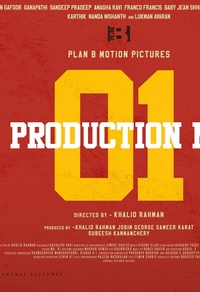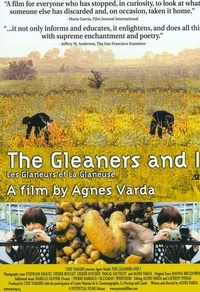Commençons d'abord avec une clarification de la plus haute importance : même si le récit se déroule durant le temps des Fêtes, Eileen est loin - très loin - de pouvoir être considéré comme un film de Noël.
En fait, rien ne vous empêche de le voir ainsi (qui sommes-nous pour juger ou vous dire quoi faire?), mais disons que vous aurez potentiellement besoin d'une bonne dose de Ciné-Cadeau après coup pour vous remettre sur le piton.
Comme son titre l'indique, le deuxième long métrage de William Oldroyd (Lady Macbeth) tourne autour d'Eileen (Thomasin McKenzie), une jeune femme habitant le Massachussets dans les années 1960, et occupant un poste tout sauf vivifiant dans un centre de détention pour jeunes délinquants.
Entre la morosité de son environnement, la mort de sa mère et les frasques de son père alcoolique ayant souvent des mots très durs pour sa progéniture, Eileen cherche désespérément sa place tout en attendant impatiemment l'étincelle qui mettra le feu aux poudres.
L'espoir renaît lorsqu'elle fait la rencontre de Rebecca (Anne Hathaway), une psychologue venant tout juste de se joindre à l'équipe du centre où elle travaille.
Au cours d'une soirée dans un bar, Eileen s'éprend de plus en plus de sa nouvelle collègue, qui l'invite par la suite à passer le réveillon en sa compagnie. Mais dès son arrivée, Eileen est accueillie dans une demeure en désordre, puis conviée à un festin composé d'un pot de cornichons quasi périmés et d'une brique de fromage.
Inutile de vous dire que la suite vous surprendra...
Eileen est une proposition que nous pourrions qualifier de « slow burner ». Un film qui prend tout son temps afin de bien établir l'atmosphère limitative et oppressante dans laquelle évolue le personnage principal. Le tout est appuyé par le somptueuse direction photo feutrée et granuleuse d'Ari Wegner, qui évoque allègrement l'époque revisitée sans passer par un excès de fioritures.
Dans le rôle-titre, Thomasin McKenzie offre une performance sobre, mais communiquant parfaitement à travers son regard et sa gestuelle hésitante, voire maladroite, le désir d'émancipation et de liberté bouillonnant à l'intérieur de son personnage.
Mais le film de William Oldroyd nous rappelle continuellement que nous sommes bien loin d'Hollywood, et qu'il ne s'agit pas que de vouloir une chose pour qu'elle se réalise automatiquement dans des conditions parfaites.
Le scénario de Luke Goebel (qui adapte ici une nouvelle d'Ottessa Moshfegh) prend d'ailleurs un détour pour le moins sombre, dur et chaotique pour confronter Eileen à ce dur constat.
Une situation inattendue qui forcera également celle-ci à prendre conscience de jusqu'où elle devra aller pour parvenir à ses fins.
L'ambiguïté de la finale, qui intègre d'une manière étonnamment habile les accents d'un suspense hitchcockien à un drame que plusieurs avaient pu comparer jusque-là - avec raison, d'ailleurs - au Carol de Todd Haynes, était un pari risqué, mais qui se révèle ultimement payant.
La structure du récit, découpée avec une précision (un peu trop?) chirurgicale, risque néanmoins de ne pas être la tasse de thé de tout le monde. Mais c'est dans cette audace et cette prise de risques qu'Eileen trouve son souffle, de même que ses scènes les plus troublantes et marquantes. Les désirs du personnage principal deviennent dès lors le miroir d'une trame dramatique qui ne demandait, elle aussi, qu'à sortir de sa torpeur.
Bref, un film qui déploie autant ses pulsions (dramatiques et narratives) que son discours et ses idées (inattendus, mais jamais dépourvus de sens) à l'intérieur d'un cadre qui, dès le départ, était destiné à voler en éclats.