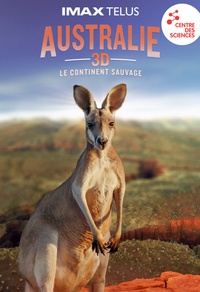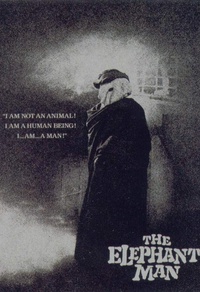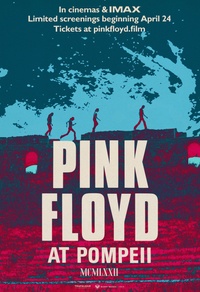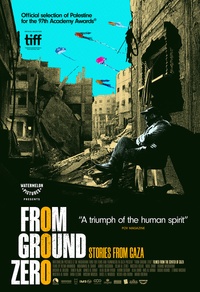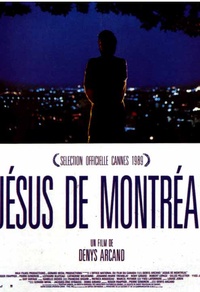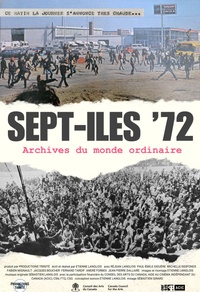Dix années après l'immense succès de Taken, le cinéaste français Pierre Morel tente à nouveau avec Peppermint de transformer une star reconnue pour son registre dramatique en vedette d'action éplorée par sa condition.
C'est justement ce qu'est Riley (Jennifer Garner) : une victime. Son mari et sa fille ont été froidement assassinés. Devant les largesses des policiers, des tribunaux et de la loi, elle décide de prendre les armes et de faire couler le sang pour que justice soit faite.
Depuis les exploits de Clint Eastwood et surtout de Charles Bronson dans les années 70 avec la référence Death Wish, les films sur les vigilantisme sont devenus un genre à part entière. Il y en a eu d'excellents et de très douteux. Peppermint se situe dans la seconde catégorie, n'embrassant guère de nuance dans son cheminement.
Bien que l'héroïne ne prenne aucun plaisir à se venger, le scénario contestable valorise cette façon de se faire justice soi-même. Le personnage principal est là pour aider les pauvres faibles sans défense (écho à The Equalizer, en plus manipulateur) et le discours final d'un flic lui donne pratiquement l'absolution sur tous les crimes violents qu'elle a pu commettre. Et ça, c'est toujours dangereux dans une société où l'accès aux armes à feu n'a jamais été aussi facile. Si au moins l'ensemble ne se prenait pas tant au sérieux, on aurait pu se retrouver devant un divertissement délirant à la Mandy ou Assassination Nation, qui marqueront à coup sûr ce mois de septembre.
Même les scènes d'action laissent à désirer. Le comble pour un des spécialistes du genre, qui avait offert par le passé The Gunman, From Paris with Love et surtout Banlieue 13. Ces séquences trépidantes aux cascades omniprésentes manquent trop souvent de tension et d'originalité (exception faite de l'introduction qui soutire un sourire), ne transcendant jamais ce qui s'est fait auparavant. Devant une histoire aussi mince et prévisible, c'est souvent la qualité de la mise en scène qui fait toute la différence. Pensons seulement à Quentin Tarantino qui a su élever Kill Bill ou à John Wick qui est parvenu à sortir du lot avec ses excès de style. Il n'y a rien de tout ça au sein de cette série B, si ce n'est ce sentiment de déjà vu et de lassitude qui plombe rapidement le moral.
Sans doute que le réalisateur était plus intéressé par le cauchemar de sa protagoniste. Cela explique pourquoi, à l'image de l'inégal In the Fade de Fatih Akin, il privilégie sa quête jusqu'aux Enfers. Sauf que Jennifer Garner, aussi musclée et à l'aise soit-elle en surprenante veuve qui botte des culs, ne possède pas la même fougue tragique que Diane Kruger. Cela donne ainsi des passages plus maladroits où l'émotion n'arrive pas toujours à ressortir correctement.
Ce n'est toutefois rien devant l'exploitation machiste de ce personnage, qui se voit rapidement instrumentalisé avec des ralentis regrettables et des clichés sexistes, où pratiquement toutes les femmes sont nécessairement gentilles (elles s'extasient même devant des enfants!), alors que les hommes ne sont que de méchants salauds. À une époque où l'on tente enfin de valoriser les rôles féminins de qualité dans des registres qui sortent des sentiers battus (les exemples probants sont nombreux récemment avec Mile 22 et Atomic Blonde), cet archétype du Rambo avec un vagin ne paraît pas seulement simpliste, mais arriéré.
Un constat que l'on peut également porter sur les visées rétrogrades qui sont développées ici sur le sentiment d'autojustice, où tout est mis en oeuvre pour palper l'immoralité des situations et flatter les plus bas instincts... mais sans livrer aucun discours justifiable sur, justement, cet échec de la justice. Derrière sa banalité, Peppermint cache un arrière-goût qui le rend encore plus dommageable.