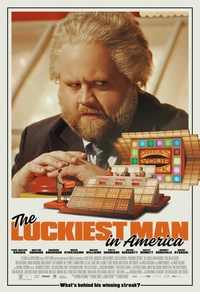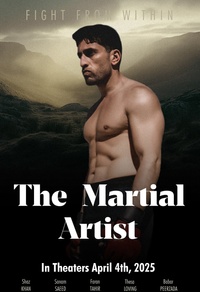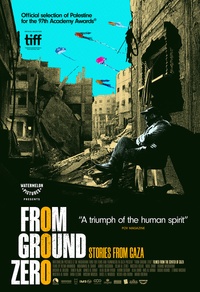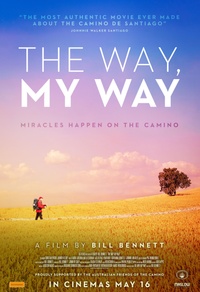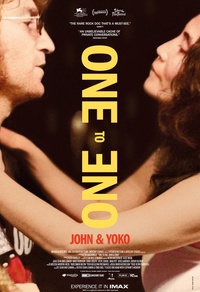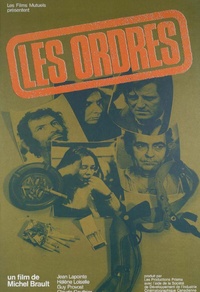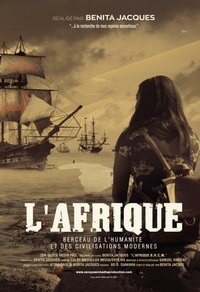Si la vitalité du cinéma québécois est reconnue à travers le monde, si notre cinématographique nationale est forte (démesurément, pour un peuple aussi « petit en nombre »), s'il fait même la fierté du cinéma canadien (dont même le chauvinisme ne parvient pas à en minimiser l'importance), et s'il est cité sur les plus grandes scènes internationales, ce n'est pas à cause de Bon Cop, Bad Cop. Pas non plus à cause de De père en flic. Probablement pas grâce à Piché - Entre ciel et terre. Même si ces films sont « réussis », dans leur genre, ce n'est pas grâce à eux si le cinéma québécois se porte si bien à travers le cinéma mondial. C'est à cause de cinéastes comme Denis Côté, qui sont parvenus, en une poignée de films, à se créer un univers, une « filmographie » cohérente où on remarquerait non les traits d'un réalisateur de métier capable de passer d'un genre à l'autre, mais celle d'un cinéaste pour qui le cinéma est central.
Jean-François habite avec sa fille Julyvonne dans une maison de banlieue. À 12 ans, elle n'a jamais fréquenté l'école et son père la surprotège en lui interdisant de quitter la maison. Il travaille dans un salon de quilles et comme concierge dans un motel, et il croit que tout va bien. Alors que Julyvonne, au cours d'une promenade, fait une découverte qui va la mettre en contact avec l'horreur du monde extérieur, Jean-François réalise qu'il devra, tôt ou tard, permettre à sa fille de sortir du cocon qu'il a prévu pour elle.
Il n'y a pas de doute possible : Curling est un film de Denis Côté. Cette ambiance lourde, cette curiosité de la marge et cette fascination pour les mésadaptés (sans le sens péjoratif qu'on associe habituellement au mot) sont encore une fois bien présent dans ce récit plus « simple » - narrativement parlant - que les précédents efforts du réalisateur. On peut reconnaître, ici et là, les ressorts d'un schéma narratif. Cela permet d'ouvrir le film aux spectateurs, plutôt que d'être l'étude parfois désincarnée des mécanismes de la fiction. On ressent davantage d'empathie pour les personnages, et on vit plus cordialement les soubresauts dramatiques, ici particulièrement bien trouvés.
Le regard qui est posé est au service du récit et des personnages; les acteurs, tous efficaces (et presque tous inconnus), contribuent à cette atmosphère de fin de monde, alors que la rigueur de l'hiver circonscrit les personnages au conte dans lequel ils semblent évoluer. Cette incursion est fascinante parce qu'elle est personnelle et cohérente - moins conceptuelle, plus efficiente. Les acteurs sont dans le ton, cela est admis. Mais Emmanuel Bilodeau est-il trop connu, trop associé à d'anciens personnages pour être l'acteur parfait pour ce rôle sorti des considérations du monde réel? Possible. Mais pas surprenant que le public de Locarno l'ait récompensé, face à l'efficacité qui ressort de sa prestation.
Mettre le cinéma sur au piédestal, le placer au centre de sa démarche, sans le réduire à des simples fins de divertissement ou de rentabilité, c'est le seul moyen de s'inscrire dans le Cinéma - avec un C majuscule comme on met un A majuscule à « Art ». C'est aussi particulièrement stimulant, alors que la génération émergente de cinéphiles, gavée d'images depuis des années, prend plaisir à voir ses attentes désamorcées par un cinéma aussi conscient de lui-même et de ses moyens.