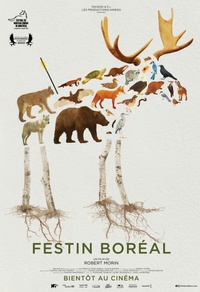Primé à Cannes, aux Golden Globes et sans doute bientôt aux Oscars, Drive My Car est une oeuvre éblouissante, que l'on se garde pour les grandes occasions. Cela tombe bien : elle se pointe le nez sur les écrans pour coïncider avec la réouverture des salles de cinéma.
2021 fut l'année de la consécration pour Ryûsuke Hamaguchi. Avec Wheel of Fortune and Fantasy, primé à Berlin, le cinéaste continuait d'être le digne héritier d'Éric Rohmer, traitant de hasards et de désillusions sentimentales. Pour son plus récent projet, sa fascination de la condition humaine est poussée à son paroxysme, traitant son sujet avec une rigueur exceptionnelle qui ne peut que rappeler Ingmar Bergman... en moins austère.
Drive My Car est une transposition de nouvelles de l'acclamé Haruki Murakami. Un auteur qui ne cesse de fasciner, comme en fait foi la magistrale adaptation cinématographique de Burning de Lee Chang-dong. Ici aussi, des disparitions plongent nos personnages principaux dans la solitude et la mélancolie, amenant un metteur en scène de théâtre (Hidetoshi Nishijima) et sa conductrice (Tôko Miura) à se rapprocher.
Le réalisateur nippon avait peut-être déjà traité de la perte avec son brillant Asako 1 & 2 et au lieu d'explorer à nouveau ces mystères de l'existence de façon quasi proustienne, il s'en tient au thème de prédilection de sa filmographie : la difficulté de communiquer. La parole, abondante et presque omniprésente, rapproche et repousse, ayant des fonctions sensuelles et même érotiques. Pourtant tous ces mots finissent par tenir à distance, à glacer le quotidien. Un froid qu'entretient la première partie de l'ouvrage, jusqu'à un point de non-retour.
Le long métrage se réchauffe par la suite lorsque les protagonistes arrivent à panser leurs plaies. Cela est possible en créant des liens vers les autres, mais également en s'immergeant dans l'art, alors qu'une troupe réunie à Hiroshima tente de monter Oncle Vania de Tchekhov. Leurs corps tout entiers deviennent ainsi vecteurs de changement. Pas besoin de connaître la langue de l'autre pour se comprendre réellement. Cela donne des séquences mémorables, d'une poésie certaine, notamment lorsqu'une jeune femme malentendante fait son entrée dans l'histoire.
Ce processus de deuil et de guérison prend évidemment son temps, s'exprimant dans les nombreuses répétitions théâtrales. Sans nécessairement allonger ces scènes, Hamaguchi fait confiance à la durée, laissant toujours le rythme de la vie triompher. L'immense film qui l'a révélé, Happy Hour, durait plus de cinq heures et il a marqué les esprits. Cette fois, le trajet est de trois heures et la balade berce et apaise l'âme. Sa douce mise en scène demeure d'une fluidité remarquable. Sa photographie s'avère exquise et son symbolisme, quoiqu'un peu trop apparent, se révèle dans son montage ingénieux, où par exemple les roues d'une voiture en mouvement se transforment soudainement en bande de cassette audio.
Cette image est d'ailleurs la parfaite métaphore du récit. Habitué à tenir le volant de sa vieille Saab 900, notre héros devra apprendre à lâcher prise, alors qu'une conductrice lui est assignée pour ses déplacements. Cela ne l'empêchera pas de continuer à se concentrer sur cette voix enregistrée. Il s'agit d'extraits d'Oncle Vania. Sauf que très souvent, la vie se mêle à l'art, créant une symbiose saisissante et révélatrice. Tout cela est notamment possible grâce au brio des interprètes, Hidetoshi Nishijima en tête. Connu pour ses performances intenses dans Creepy de Kiyoshi Kurosawa et Dolls de Takeshi Kitano, l'acteur utilise constamment les non-dits à son avantage, se révélant davantage par son écoute.
Rare et précieux, Drive My Car est un opus inestimable, qui rappelle que la beauté existe encore. Il faut seulement savoir où regarder, s'y investir le moindrement pour recevoir de plein fouet un riche moment de cinéma.