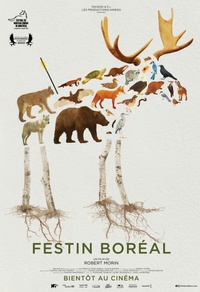Pour son quatrième et plus ambitieux film de fiction à ce jour, Anaïs Barbeau-Lavalette adapte le livre Chien blanc de Romain Gary avec un résultat audacieux qui risque toutefois de ne pas faire l'unanimité.
Publié au début des années 1970 et faisant écho aux mouvements sociaux et raciaux qui ont secoué les États-Unis en 1968 (le meurtre de Martin Luther King, les climats de violence et de manifestations, etc.), Chien blanc s'active autour de la figure de Romain Gary (ici incarné par Denis Ménochet) et de son épouse l'actrice Jean Seberg (Kacey Rohl) qui recueillent un chien entraîné pour mordre les personnes noires. Peut-on le guérir du mal qui l'afflige ou faut-il s'en débarrasser avant qu'il fasse de nouvelles victimes?
Cette épineuse interrogation qui utilise la métaphore animale pour parler du racisme systémique devient presque un prétexte à tous les autres thèmes traités. On y aborde notamment les différentes formes d'engagements et le privilège blanc dans un conflit à la fois engageant et étranger. Puis il y a une plongée au sein du mythique couple Gary/Seberg qui, sans tourner vers le traditionnel biopic, prend beaucoup de place. Avant d'élargir le regard sur la société, ses luttes d'hier à aujourd'hui. Tout cela en 95 minutes.
Le long métrage a tôt fait de crouler sous son ambition, d'aborder trop de sujets sensibles sans nécessairement faire le tour de la question. La matière est tellement riche qu'on lui pardonnera. Cela n'empêche pas la façon de procéder de laisser dubitatif. Le scénario d'Anaïs Barbeau-Lavalette et de Valérie Beaugrand-Champagne ne brille pas par sa subtilité. La démonstration s'avère souvent lourde, appuyée, répétitive et parfois même manipulatrice dans sa façon de vouloir titiller l'émotion en recourant à la musique, aux ralentis et à la présence d'enfants. À ce sujet, la finale longuette et inutilement explicative vient bien près de tout gâcher.
C'est d'autant plus dommage qu'on se retrouve devant une oeuvre de qualité, à la mise en scène éclatante de beauté. Faisant suite à La déesse des mouches à feu (son meilleur film à ce jour), Anaïs Barbeau-Lavalette propose une nouvelle réalisation étudiée et stylisée, trop touffue narrativement, mais qui arrive à respirer lors de séquences plus poétiques et impressionnistes. Il y a cette nature environnante qui semble envelopper les personnages principaux dans un cocon protecteur. Puis ce fil du temps dressé entre les époques, des esclaves issus de plantations à ces gamins blancs qui poursuivent leurs camarades noirs, que n'aurait sans doute pas reniés Barry Jenkins ou Steve McQueen.
La qualité de l'interprétation est également au-dessus de la moyenne. Découvert dans Inglourious Basterds et trouvant depuis de grands rôles dans de nombreuses productions comme Jusqu'à la garde et As bestas, Denis Ménochet campe un Romain Gary plus vrai que nature, habité et nuancé, en s'avérant par exemple plus intense et convaincant que Pierre Niney dans La promesse de l'aube. Face à lui, l'actrice canadienne Kacey Rohl (White Lie) module sa prestation avec sensibilité et délicatesse, n'ayant rien à envier à Kristen Stewart dans le ronflant Seberg.
En choisissant de se détourner de son sujet principal (le chien peut-il être rééduqué? Un postulat qui fut la base du plus mordant White Dog du vétéran Samuel Fuller, sorti en 1982 et qui lorgnait davantage le film de genre), Chien blanc ratisse beaucoup plus large et c'est ce qui constitue sa force et sa faiblesse. En espérant que le cinéphile ne retienne pas uniquement ses considérations sociales, parce que c'est sur le plan cinématographique que l'effort arrive à sortir quelque peu du lot.