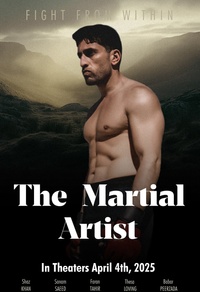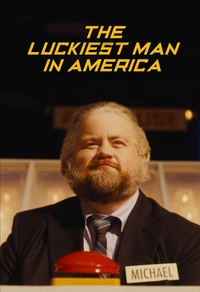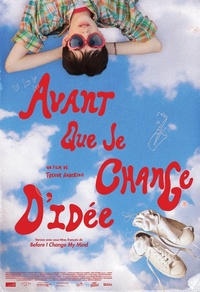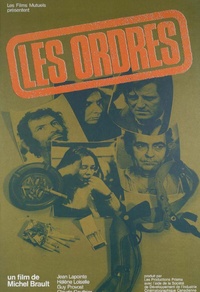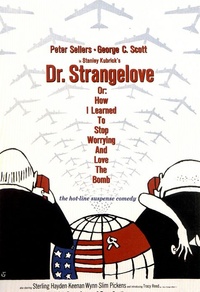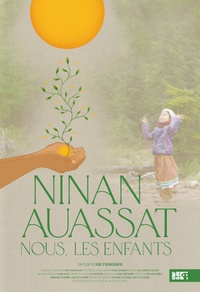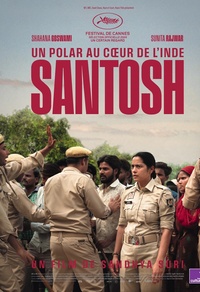Rare remake/reboot/suite à tenir la route, Candyman reprend l'essence du classique de 1992 pour le remettre au goût du jour de façon personnelle et engagée.
Candyman est un des meilleurs films d'horreur américains des années 90. À partir d'une courte histoire de Clive Barker, Bernard Rose avait réalisé une création terrifiante et extrêmement efficace, d'une profondeur insoupçonnée. Le seul hic était cette image de Père Fouettard noir qui s'en prenait à une pauvre victime blanche, perpétuant des stéréotypes racistes.
Ce défaut est évacué de la nouvelle mouture qui pousse encore plus loin les aspects sociaux et économiques de l'original. Il est toujours question de relations houleuses entre les populations riches et pauvres de Chicago, mais également de gentrification violente et d'arrestations brutales des forces de l'ordre. Le tout étant doublé de questionnements probants sur le rôle de l'artiste dans la vie de tous les jours.
Puis il y a cet impressionnant théâtre d'ombres et de marionnettes qui donnent naissance aux légendes urbaines. Par ces mots véritables ou pas d'outre-tombe, le passé et l'Histoire reviennent hanter le présent, s'abattant comme des épées de Damoclès sur des individus, faisant ressortir leurs pires traumas. Tout peut arriver lorsque cette souffrance se manifeste et elle s'exprime brillamment dans la quête de notre héros, campé avec verve par Yahya Abdul-Mateen II. Ce qu'il vit est réel ou le fruit de son imagination de plus en plus délirante? L'abondance de miroirs révèle évidemment un combat intérieur (d'identité, de personnalité), alors que son problème de peau annonce une mutation.
Ce Candyman du 21e siècle est donc à prendre comme une fable politisée, peu subtile, mais résonnant énormément à une époque marquée par Black Lives Matter. Pas surprenant de retrouver au scénario Jordan Peele, dont les précédents Get Out et Us empruntaient un chemin similaire. Les dialogues sont marqués de son humour, de sa façon reconnaissable de parler des enjeux raciaux d'aujourd'hui. Son script ne fait pas seulement reprendre une icône de la culture populaire. Il la renverse complètement, se l'appropriant de façon étonnante en y amenant une vision singulière, une résistance ambiguë qui a le mérite d'ouvrir les consciences et le dialogue. Qui est continuellement tourmenté? Qui finit par perdre la vie brutalement? Dommage que l'ensemble soit parfois plombé de trous scénaristiques et de révélations à l'emporte-pièce.
Sauf que ces registres sociaux et dramatiques si importants ont tendance à empiéter et plomber les aspects d'épouvante, légèrement moins convaincants. En dehors d'une ambiance et d'une atmosphère tendues, le long métrage manque de frissons mémorables. L'introduction saugrenue montre la figure monstrueuse un peu trop rapidement, alors que les autres séances de «carnage» débutent souvent par de faux sursauts pour se muter par des affrontements à sens unique - sanglants et secs - que l'on pouvait retrouver dans les slashers des années 70 et 80.
Pourtant le travail de mise en scène de Nia DaCosta (révélée par le très joli Little Woods) n'est pas en cause. Sa réalisation demeure précise et imaginative, élégante et brutale à la fois. Elle a une façon bien à elle de capter la lumière et de la faire rejaillir dans cet univers sombre et torturé. Un problème de rythme permet d'ailleurs de mieux observer son montage élaboré. Face aux mélodies inoubliables de Philip Glass qui donnaient un souffle presque épique au premier tome, le compositeur Robert Aiki Aubrey Love offre de vibrantes pulsations électroniques et spectrales. L'hommage y est, tout comme ce désir de palper l'âme humaine par le son et le bruit.
Même s'il ne fait pas dans la dentelle, ce nouveau Candyman possède tous les atouts pour marquer les esprits, utilisant l'horreur afin de mieux parler du monde contemporain. N'est-ce pas ce à quoi aspirent les plus pertinentes oeuvres du genre, de Night of the Living Dead à The Invisible Man?