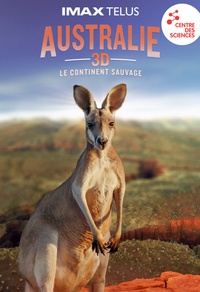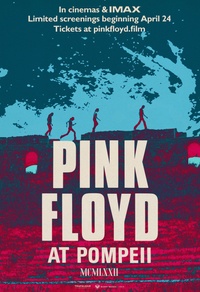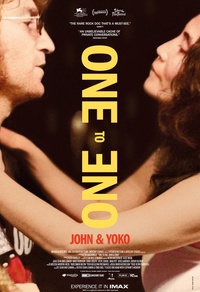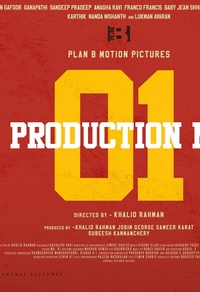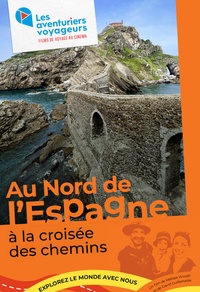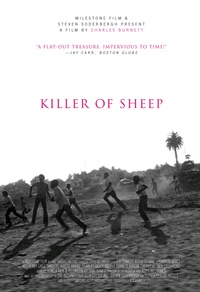S'il y a un indicateur qui ne ment pas, c'est bien le prix du public du festival international du film de Toronto. Les lauréats passés (Nomadland, Green Book, La La Land...) ont presque toujours été favoris aux Oscars, remportant les statuettes les plus importantes. Cette année, les regards seront tournés vers Belfast.
Quelle drôle de carrière quand même que celle de Kenneth Branagh. En tant que cinéaste, il a débuté en réalisant des fresques immenses adaptées des classiques de Shakespeare (Henry V, Much Ado About Nothing, Hamlet), avant de vendre son âme à Hollywood, alors que chaque nouvel effort (Thor, Jack Ryan: Shadow Recruit, Cinderella, Murder on the Orient Express) était moins intéressant que le précédent, jusqu'à la déconfiture totale d'Artemis Fowl l'année dernière. Le voilà enfin reprendre du poil de la bête, signant son premier scénario depuis The Magic Flute en 2006.
Avec Belfast, il propose son film le plus personnel. Ce petit garçon qui cherche sa place dans une ville divisée par les conflits entre les communautés catholiques et protestantes, c'était sûrement lui à la fin des années 60. Faut-il partir ou rester? Un dilemme à la Maria Chapdelaine qui vaut son pesant d'or. Conventionnel sur papier (la grande Histoire qui rencontre la petite histoire, le traditionnel récit d'initiation et d'apprentissage), le long métrage se voit gratifié d'une vision sensible et honnête qui fait toute la différence. L'authenticité ne naît pas seulement de la fabuleuse direction artistique, mais du regard de son auteur.
Peu importe que cette chronique classique et anecdotique traîne en longueur malgré ses 98 petites minutes. Elle possède du coeur et de l'émotion à revendre, arrivant à alterner moments drôles et tristes, bouleversant par quelques dialogues justes avant de toucher la grâce par une parole fredonnée ou une danse inusitée. La musique de Van Morrison, natif de Belfast comme Branagh, apporte un supplément d'âme, lui qui chante la lutte ouvrière comme pas un (désolé Springsteen), tout en proposant des thèmes mélodiques instrumentaux d'une mélancolie certaine.
Tout passe également par les acteurs, étincelants de vérité. Qui ne voudrait pas avoir comme grands-parents Judi Dench et Ciaran Hinds? Caitriona Balfe campe une mère digne et même Jamie Dornan de la misérable trilogie Fifty Shades of Grey prouve qu'il a du talent en père qui devra effectuer un choix important. Évidemment, c'est le nouveau venu Jude Hill qui va monopoliser l'attention et il est irrésistible à défaut d'être nuancé. La construction du script n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui du chef-d'oeuvre Les 400 coups avec cet enfant qui découvre le monde secret des adultes et de ses parents.
C'est justement son regard pur et enfantin qui est mis à l'avant-plan, guidant ce qui apparaît à l'écran tout en conservant une part importante au hors champ. Une mise en scène fluide et souvent en mouvement, comme ces balbutiements incessants de la jeunesse. Après une courte introduction en couleurs, l'ouvrage s'affiche dans un noir et blanc somptueux. Fidèle complice du réalisateur depuis son remake de Sleuth (2007), le directeur de la photographie Haris Zambarloukos se surpasse avec ses magnifiques images évocatrices. La seule échappatoire de cette époque manichéenne est le théâtre et le cinéma. Le septième art devenant souvent une métaphore d'un quotidien magique, éclairant de mille couleurs, où les films vus sont utilisés à des fins de comédie, de suspense ou simplement de poésie.
À la fois intime et universel, d'auteur et grand public, Belfast possède suffisamment de charme pour se rendre loin aux Oscars. De l'ombre naît la lumière et une forme de nostalgie tendre, sentimentale et réconfortante qui fait un bien fou par les temps qui courent.