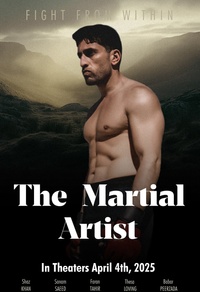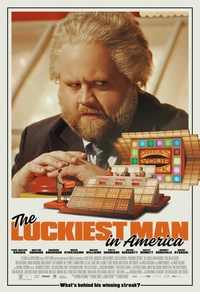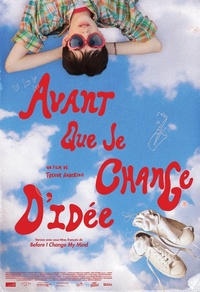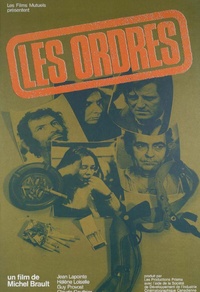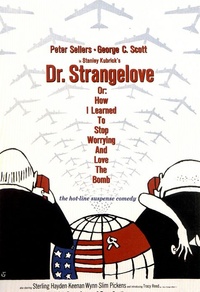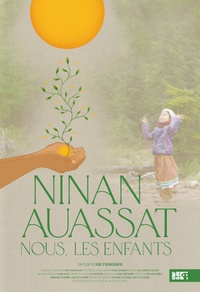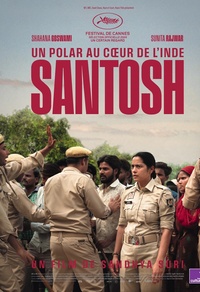Le mal-être généralisé depuis la dernière élection américaine se matérialise déjà au cinéma. Il s'affiche clairement dans Beatriz at Dinner, un petit film porté à bout de bras par ses excellents comédiens.
On retrouve dans cette fable une immigrante mexicaine (Salma Hayek), dévouée et profondément honnête, qui consacre sa vie à prendre soin des autres. Lorsque sa voiture tombe en panne, une amie l'invite pour souper à un repas où assiste un riche et influent magnat (John Lithgow) aux idées particulièrement tranchées.
Le clash peut difficilement être plus grand. Tous les invités semblent être des géants à côté de la minuscule héroïne. L'argent, le pouvoir et le capitalisme mènent la discussion et ce sont les échanges de valeurs qui guideront le dîner. L'argumentation, parfois simpliste, manque clairement de subtilité. Le trait est grossi pour rappeler l'absurdité de la vie de tous les jours à une époque de plus en plus trouble.
La nuance apparaît plutôt dans le jeu de Salma Hayek, qui offre sa meilleure performance depuis Frida. Tout se passe dans les yeux de l'héroïne qui regarde en tentant de ne pas trop juger. Elle est faite de compassion, de douceur, de lumière, et sa confrontation avec John Lithgow n'en est que plus troublante. Ce dernier, monstre de cupidité à rendre jaloux Donald Trump, dévore tout sur son passage avec son charisme dangereux, rajoutant à son palmarès un nouveau méchant terrifiant.
À l'instar du chef-d'oeuvre L'ange exterminateur de Luis Bunuel, quitter la maison s'avère impossible. Plus la protagoniste y demeure, plus elle rencontrera des injustices chroniques et le racisme ordinaire. L'ombre de Get Out plane rapidement sur ce huis clos et si Beatriz at Dinner n'est pas fait du même bois, la satire finit par fonctionner grâce aux contrastes en place. À priori, il s'agit d'une comédie sociale portée par des dialogues ravageurs, où la noirceur du propos finit par faire écho au trop peu connu The Last Supper qui mettait en vedette Cameron Diaz.
Pourtant le rire devient rapidement jaune, alors que le ton se mute en quelque chose de plus philosophique, existentiel et tragique. Le malaise qui y règne est palpable et un sentiment d'inconfort se développe presque instantanément. La tension alimente le suspense qui se heurte à une trame sonore qui est loin d'être de circonstance. L'omniprésente musique évoque plutôt la quiétude et l'espoir, rendant magique la quête de la protagoniste. Pas surprenant que la première et la dernière scène du long métrage s'avèrent intimement liées, exerçant une échappée surréaliste qui pourra être prise favorablement ou pas par le spectateur. Des métaphores et des symboles qui sont parfois trop évidents.
Plus politisé que jamais, il est rafraîchissant de voir le cinéaste Miguel Arteta revenir à un cinéma personnel après Cedar Rapids, Youth in Revolt et Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Il renoue avec la plume de Mike White qui lui a procuré ses deux meilleurs opus : The Good Girl qui prouvait au monde entier que Jennifer Aniston avait sa place dans ce métier et surtout Chuck & Buck, ce sombre joyau indépendant qui a marqué une génération de cinéphiles.
Moins risqué, plus limité dans sa faible durée, Beatriz at Dinner n'en demeure pas moins une oeuvre bien de son temps, où la confusion de l'existence demande un retour aux sources, surtout sur le plan humain. Ce conte aura beau paraître naïf, dichotomique et manipulateur, il est porté par un réel souci de brasser la cage, de faire réagir et de changer les choses. Et ça, c'est moins courant que l'on pense.