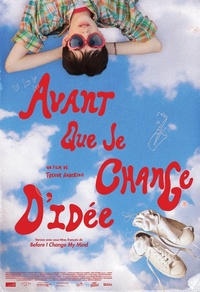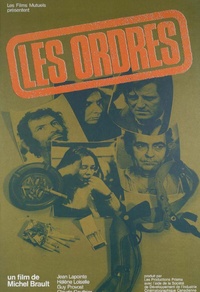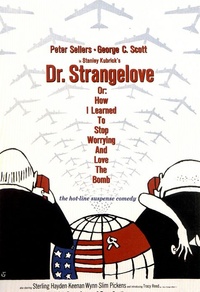Au nom de la terre a remporté un grand succès public en France qui risque bien de se reproduire au Québec.
Ce n'est guère surprenant avec un sujet aussi important. Longtemps un fondement de nos sociétés, les fermes et ses agriculteurs ont de plus en plus été relégués dans l'ombre. Même s'il s'agit d'un métier primordial, sa dureté et sa précarité ont tôt fait d'altérer son héritage qui s'est détérioré au fil du temps.
Lui-même fils et petit-fils de paysan, Édouard Bergeron filme un peu son histoire avec ce western agricole, où le sort de la famille dépend constamment de celui de la terre. Les liens ne sont plus à faire entre ces deux entités, que ce soit dans la façon de confronter le passé au présent, les traditions à la modernité. Seuls les plus forts aux valeurs parfois douteuses peuvent penser survivre dans cet univers devenu incontrôlable - c'était déjà le cas à l'époque de Zola - qui est dominé par l'argent et le rendement... alors que les autres risquent de se faire avaler tout rond. Lorsque la transmission n'est plus possible ou même souhaitable, rien ne va plus.
Cette matière fertile aurait pu prendre le chemin du documentaire comme l'avait fait Raymond Depardon sur son essentiel La vie moderne. Bergeron en a décidé autrement et à l'aide de ses deux coscénaristes, il a écrit une fiction éminemment personnelle, malheureusement lourde et démonstrative, dont le rythme des saisons épouse le désarroi des personnages. Donc s'il y a de la neige, tout va mal.
Entre le récit d'initiation d'un fils (Anthony Bajon) et les rêves d'une vie clémente de son père (Guillaume Canet), c'est le symbole qui mène le pas. Celui qui souligne constamment ce qui arrive (le paternel est prisonnier d'un engrenage... alors à quoi bon le montrer au volant d'un véhicule qui n'avance pas si c'est seulement pour répéter ce que le spectateur sait déjà?) et qui prend le pas sur l'émotion. C'est le cas de la finale, particulièrement mélodramatique et manipulatrice, où un souvenir heureux avec un enfant au bord de la plage et une mélodie de Barbara sont supposés décupler les larmes. Difficile de faire plus pathos.
Avec sa magnifique photographie clairement inspirée par le chef-d'oeuvre Days of Heaven et les délicats airs instrumentaux de Thomas Dappelo qui ne sont pas sans évoquer ceux du compositeur Carter Burwell, ce premier long métrage titille allègrement les sens. Sauf que cela ne se traduit pas nécessairement dans la mise en scène, modeste et académique, dont les ellipses de temps - censées annoncer les espoirs et fatalités de cette saga qui se déroule sur plusieurs décennies - manquent clairement de souffle épique. Après une superbe introduction, le récit entre tranquillement dans le rang et n'en ressort jamais. Au contraire du récent et excellent Petit paysan qui était plus riche d'idées et de cinéma ou, plus près de chez nous, du sensible Le démantèlement.
Convaincu par ce projet jusqu'à devenir un des producteurs, Guillaume Canet trouve un autre rôle gratifiant, retournant à un registre dramatique après quelques escapades comiques réussies. Il porte le film sur ses épaules, tentant la nuance lorsque le vieillissement ne l'aide pas. Le développement de l'intrigue le force toutefois à en faire des tonnes et l'acteur, très expérimenté, évite généralement la caricature. En gardant le cap sur l'humain, le scénario l'entoure de bons comédiens, que ce soit Veerle Baetens (Duelles) en épouse dévouée et Anthony Bajon qui confirme les espoirs fondés en lui depuis La prière.
Au nom de la terre portait les graines d'une grande fresque qui reste en jachère. Trop collé à son propre parcours, le réalisateur manque de recul et de vision, finissant par pondre un film appliqué au sujet nécessaire qui ressemble à tout sauf à lui-même. C'est pourtant son histoire, unique et universelle, dont on avait tant besoin.