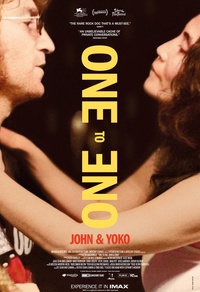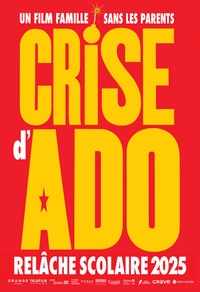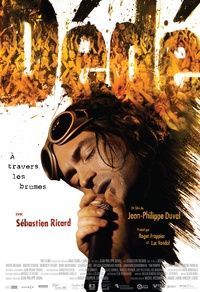En mai dernier, le cinéaste américain Sean Baker (Tangerine, The Florida Project) repartait du Festival de Cannes avec la toujours très convoitée Palme d'or. Comédie dramatique aussi crue et étourdissante que désopilante, Anora vient planter le dernier clou dans le cercueil de ce que certains appelaient encore un conte de fées.
Évidemment, les parallèles avec le Pretty Woman de Garry Marshall sautent aux yeux dès le départ. Ivan (Mark Eydelstein) un jeune homme très fortuné, fils d'un oligarque russe, s'amourache d'une danseuse érotique nommée Anora, dit Ani (Mikey Madison), au cours d'une soirée particulièrement arrosée.
Tombant sous le charme de la jeune femme, Ivan invite Ani dans son immense demeure, puis l'engage pour passer toute la semaine avec lui. Ce tourbillon de sexe, d'alcool, de drogue et de nuits folles les mènent jusqu'à Las Vegas pour un autre séjour de débauche entre amis.
Dans un instant de « lucidité », Ivan fait la grande demande à Ani, qui finit par accepter. Pour la jeune femme, ce mariage lui permettrait d'accéder à un univers de luxe et d'abondance qu'elle ne pouvait même pas imaginer dans ses rêves les plus fous. Pour son nouveau mari, il s'agit - en théorie - d'une façon de pouvoir demeurer en permanence aux États-Unis sans que ses parents aient un mot à dire.
Évidemment, la réalité est tout autre lorsque ces derniers sont mis au parfum des frasques de leur progéniture, s'envolant aussitôt pour New York avec la ferme intention d'annuler cette union, et chargeant entretemps leurs sbires de garder la situation sous contrôle jusqu'à leur arrivée.
La première moitié d'Anora est totalement dédiée à la rencontre d'Ani avec son prince charmant de l'ère TikTok, Sean Baker nous passant notre passe VIP autour du cou pour nous donner accès à un monde d'excès et de débordements sans conséquences qui ferait saliver n'importe quel influenceur.
Le style clinquant alors privilégié par le cinéaste ne peut qu'embrouiller et exalter les sens, tout en exacerbant la candeur pas si innocente d'Ani, et le caractère d'adulescent ayant accès à beaucoup trop de ressources d'Ivan.
La seconde moitié d'Anora prend une tournure comique aussi inattendue que réjouissante, plaçant tous les personnages dans une position de perte de contrôle totale.
Si nous avions pu nous attendre à ce que les hommes de main d'un riche homme d'affaires russe emploient la manière forte, nous sommes plutôt confrontés à trois gaillards complètement dépassés par les événements - lire : l'entêtement et la combativité du personnage titre -, et cherchant désespérément à ne pas faire de vagues de peur que le tout aboutisse dans la presse et/ou sur les réseaux sociaux.
Le réalisateur demeure d'ailleurs plutôt vague en ce qui a trait aux raisons et aux motivations poussant Ani à vouloir protéger à tout prix son mariage d'à peine quelques jours avec Ivan. Loin de vouloir nous faire croire au coup de foudre, Baker laisse tout de même entrevoir que tout n'est pas non plus qu'une question d'argent. La vérité se trouvant quelque part au milieu, il émane néanmoins du langage corporel et des regards d'Ani toute l'attention que celle-ci désire accorder à Ivan, tout comme celle qu'elle voudrait qu'il lui consacre à son tour.
Le dernier droit est d'autant plus significatif à cet égard, alors que Baker nous confronte à un personnage égaré, ayant trop longtemps mêlé sa sexualité à l'expression de ses sentiments. À cet égard, Anora est d'abord et avant tout le film de Mikey Madison, qui offre une performance aussi authentique que touchante et hilarante dans la peau d'un personnage dans lequel elle s'est totalement investie.
Arrivé à ce point du récit, cela fait déjà un bon moment que toutes les comparaisons possibles avec Pretty Woman ont pris le champ. Les deux univers que met en relation Anora sont aussi excessifs et délurés l'un que l'autre, n'étant différenciés au final que par la quantité d'argent qui les font tourner.
Sous ses allures d'anti-conte de fées, Anora se révèle aussi une oeuvre sur l'état d'un monde évoluant à un extrême ou un autre, mais rarement au milieu. Ce qui demeure toutefois inébranlable chez Sean Baker, c'est sa façon de regarder à travers les hommes et les femmes qu'il met en scène, à considérer leur impulsivité, leur fragilité, leur immaturité, mais également la bonté et la bienveillance pouvant encore émerger là où on les attend le moins, voire plus du tout.