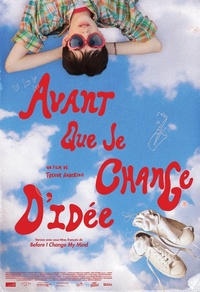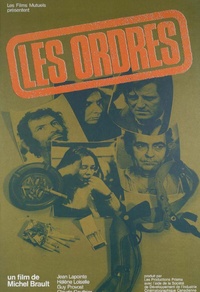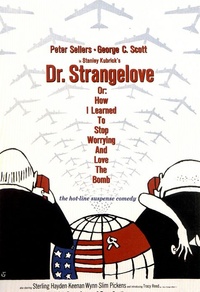Face à la bêtise ambiante, il faut s'unir et résister. C'est le mantra d'Adieu les cons, un divertissement hilarant et intelligent consacré sept fois aux Césars (les Oscars français), notamment pour la qualité du film, de la réalisation et du scénario.
Albert Dupontel est l'électron libre de l'Hexagone. Qu'il soit devant ou derrière la caméra, son style punk court-circuite la morale bien-pensante. Même en vieillissant, il n'a pas perdu cette touche abrasive, caustique et corrosive qui fait souvent toute la différence.
Sur une lancée irrésistible depuis 9 mois ferme et Au revoir là-haut, Adieu les cons consacre encore davantage ce véritable auteur iconoclaste qui n'a pas peur de nager dans le cinéma populaire sans jamais perdre son âme. Il traite depuis ses débuts de sujets souvent douloureux (filiation, maternité, solitude, aliénation) par le rire et l'absurde, en véritable héritier des Monty Python.
Son plus récent long métrage est d'ailleurs dédié à Terry Jones, multipliant les hommages au classique Brazil en offrant même un caméo à Terry Gilliam. Le monde du travail n'a jamais paru aussi déshumanisant, empêchant ici un spécialiste de l'informatique (Dupontel) d'obtenir sa promotion, condamnant là une coiffeuse malade (Virginie Efira) qui tente de retrouver son enfant né sous X. Devant les injustices chroniques et la mort qui plane, l'improbable duo opte pour la vie (merci suicide raté!), se tenant droit face à l'implacable rouleau compresseur des forces de l'ordre et de la bureaucratie.
Le récit prend la forme d'un conte, un road trip invraisemblable, mais si savoureux dans sa façon de mélanger les genres, de passer en un instant de la comédie jaune ou noire au drame social, du suspense ludique à la tragédie burlesque. Un peu plus et cela ressemble à une création coréenne... sans la violence. Le metteur en scène pousse d'ailleurs comme jamais l'humour décalé, la romance tendre et le mélodrame exubérant. Une symbiose un peu excessive qui ne sera forcément pas pour tous les goûts... et qui permet justement à l'opus de sortir du lot.
La réalisation au diapason cumule les plans de caméras frénétiques et les effets volontairement kitschs (si on peut appeler ça du CGI) afin de révéler l'état d'esprit affolé des personnages qui évoluent dans des existences faussées. Peu à peu, ces univers d'ombres laissent la place à une lumière soignée empreinte d'espoir. Très présente, la musique harmonieuse ajoute un baume sur les plaies.
Des procédés cinématographiques permettent de créer de la poésie. Déjà, la fluidité narrative s'avérait impayable, nouant allègrement les différents destins. On ajoute à cela un jeu dichotomique sur l'image et le son (parfois les ellipses nostalgiques du passé n'ont pas besoin d'explications, ou c'est la voix de l'héroïne qui arrive à nouer deux coeurs) pour un résultat encore plus relevé.
Chaque scène possède son importance, son moment de grâce au sein de ce court film où l'émotion coule à flots. C'est le cas de ce trajet en automobile qui permet de constater comment Paris a changé (et pas seulement pour le mieux) et cette réunion magique entre un médecin atteint d'Alzheimer et son épouse qui semble provenir tout droit du Fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Toujours aussi imprévisible, sensible et ténébreux, Albert Dupontel l'acteur sait s'éclipser devant Virginie Efira, certainement la comédienne la plus intéressante du moment. Celle qui brillait dans Sibyl offre une autre performance truculente et nuancée. Complétant ces marginaux qui désirent prendre part à une société plus humaine et solidaire se trouve Nicolas Marié, formidable en attachant aveugle un peu gauche.
Sans doute que la fin simpliste laisse un goût amer en bouche. Non seulement elle s'inscrit trop facilement dans l'air du temps, mais elle pourra également paraître d'un opportunisme douteux. Faut-il se rappeler qu'on se retrouve devant une fable sentimentale dont la quête d'amour, de liberté et de cinéma est absolue?
L'oeuvre idéale pour ramener les gens dans les salles (son succès est foudroyant en France), Adieu les cons fait valser rires et pleurs en parfaite harmonie, se voulant aussi léger et grave que cette vie qui se voit sublimée par le septième art. On en redemande.