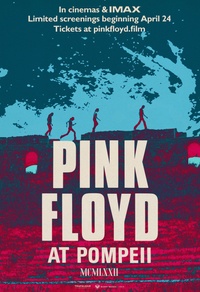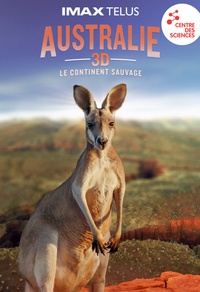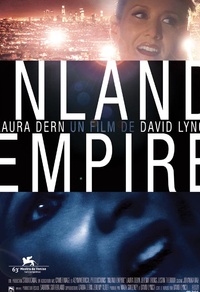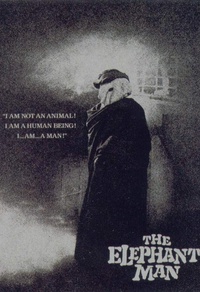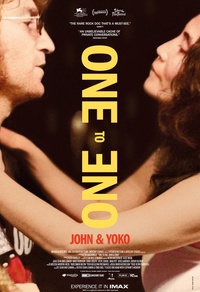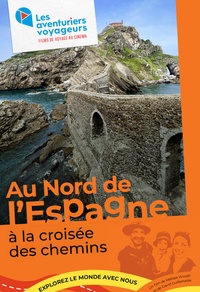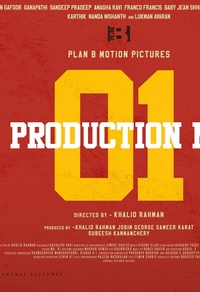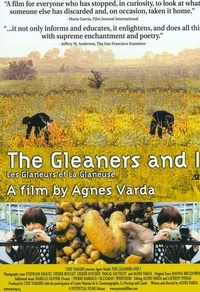Depuis la sortie de Je me souviens en 2009, le cinéma d'André Forcier semble être tombé dans la fontaine de jouvence. Le réalisateur des films cultes L'eau chaude l'eau frette et Au clair de la lune a trouvé une énergie et une inspiration nouvelle afin d'offrir des satires tour à tour grinçantes et hilarantes. Ababouiné en est l'aboutissement le plus éclatant, même s'il s'avère plus brouillon que ses prédécesseurs.
En 1957, des gens du Faubourg à m'lasse de Montréal tentent de prôner un Québec laïc. Le clergé ne l'entend évidemment pas ainsi, utilisant tous les moyens à sa disposition pour enrayer la menace. De ce combat entre le Bien et le Mal où ressort des thèmes toujours d'actualité (obscurantisme religieux, montée de la droite, hypocrisie conservatrice), le script prône un manichéisme qui fait sourire, près de la bande dessinée. Les enfants pauvres et malades, les vieilles personnes et les femmes courageuses se dressent devant des religieux violeurs ou imbus d'eux-mêmes, ainsi que des paternels injustes qui font régner la violence.
La subtilité n'a jamais été la tasse de thé de son auteur qui, maintenant âgé de 77 ans, continue à faire des films comme s'il avait 12 ans. Forcier manie l'ironie et l'imaginaire mieux que quiconque, se plaisant avec ses contes surréels de rappeler que l'amour a le dernier mot et qu'il faut se mettre ensemble pour changer les choses. Avec l'espoir et la solidarité, rien n'est impossible.
Ce n'est pas surprenant si les personnages colorés sont aussi nombreux dans son univers. Ses membres forment une famille de résistance et cette notion de clan à l'italienne - on pense au cinéma d'Ettore Scola - se retrouve au coeur même de sa démarche artistique, qui réunit souvent les mêmes acteurs (Gaston Lepage, Mylène Mackay) tout en faisant découvrir de nouveaux talents (Rémi Brideau, qui défend le rôle principal, est promu à un bel avenir). Deux décennies après avoir enflammé l'écran dans le mal-aimé Les États-Unis d'Albert, Éric Bruneau nage comme un poisson dans l'eau en vicaire libidineux. Une scène de pédicure avec Rémy Girard (qui reprend son personnage de Je me souviens) ne manquera pas de faire hurler de rire.
On retrouve surtout dans ce nouveau long métrage l'amour de son créateur pour la poésie. Chez lui, il faut défendre coûte que coûte la langue française avant qu'il ne soit trop tard. Ses dialogues souvent truculents sont pimentés de perles de type « la révolution, comme le baseball, est un sport populaire ». Cette révolution tant attendue et pas si tranquille prête à secouer le Québec prend la forme de mots et, plus particulièrement, d'un ouvrage qui porte le nom d'Ababouiné. Le rêve est beau et Martin Dubreuil en professeur le vend formidablement bien.
Mais là où Coteau rouge et Embrasse-moi comme tu m'aimes séduisaient par leur charme volontairement kitsch, Ababouiné finit par sentir un peu le déjà-vu. Les touches de réalisme magique semblent forcées (les mains velues du matou ne servent à rien), les allusions sexuelles tombent à l'eau (pauvre coeur du frère André!) et le récit calcule plus ou moins bien ses ruptures de ton. L'ensemble désordonné manque parfois de cohésion et les numéros humoristiques s'avèrent souvent inégaux. La mise en scène de métier et la solide reconstitution historique élèvent les enjeux, bien qu'il n'y ait rien d'aussi éblouissant techniquement que sur le précédent Les fleurs oubliées.
Peu importe qu'il soit gauche, ce plus récent film d'André Forcier demeure plus intéressant que la moyenne des sorties hebdomadaires au cinéma. Notre Fellini national insuffle tellement de coeur, de style et d'audace à ses oeuvres que même un titre imparfait comme Ababouiné finit par enchanter.