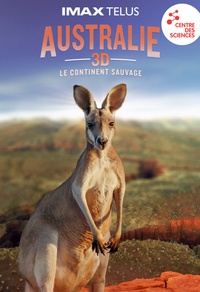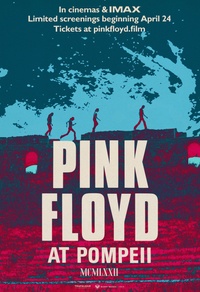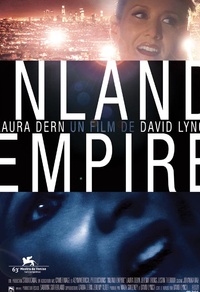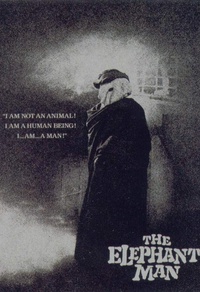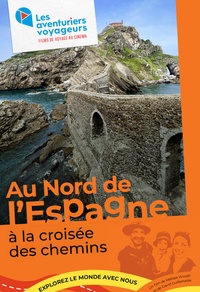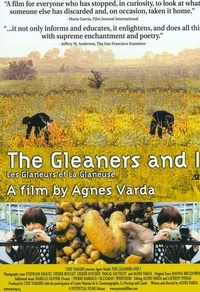Lorsque Robert Morin s'est rendu au Rwanda, en 2005, pour le tournage du film Un dimanche à Kigali, il a vu un pays ravagé par la guerre.« J'accompagnais ma compagne de vie qui faisait les décors du film. J'ai vu des camions d'aide internationale, l'ONU, et je me suis dit qu'il y avait moyen d'aider vraiment les gens, et j'avais le goût de prendre une année sabbatique de cinéma. Comme je suis bon menuisier, j'ai pensé que je pourrais aller bâtir des cabanes, alors je me suis mis à faire des recherches pour savoir à qui prêter mon marteau, et je suis tombé sur plein de statistiques. J'ai fait, en fait, ce que mon personnage n'a pas fait avant de partir. En m'informant, j'ai déchanté... il y a tellement de fuites possibles à l'argent. »
« J'ai trouvé aussi qu'il y avait une métaphore à faire entre l'aide internationale et l'amour des enfants. » De quelle façon? « Dans les deux cas, ça part avec une intention qui est sincère, et ça finit toujours par une manifestation de pouvoir sur des gens qui sont très fragiles, très fragilisés. Quand t'arrives avec ton gros truck, à Kigali ou n'importe où, c'est quand même une manifestation de ton pouvoir. C'est du néo-colonialisme. »
Est-ce que le scénario se développe autour d'impératifs narratifs, ou d'impératifs idéologiques? « Toujours narratifs. Je ne suis pas un cinéaste engagé et je ne veux pas en être un non plus. Pour moi, ce qui est important, c'est le glissement progressif d'un personnage qui perd toute confiance en lui, en ses idéaux; on suit une dépression nerveuse finalement. Comme dans Papa à la chasse aux lagopèdes et dans Petit Pow! Pow! Noël, ce sont des personnes qui se confient à la caméra, qui témoignent de leur chute à la caméra. »
« Avant d'être un statement politico-social, c'est une exploration d'une forme dramatique. »
À la différence de ces deux films, où vous aviez le contrôle sur tout, il y a pas mal d'éléments extérieurs. « Oui, ce n'est pas un huis clos. C'est un personnage sur une dent-de-scie, les chocs s'accumulent pour lui. » Il y a peu d'acteurs connus, et l'impression de réel est très forte. « C'est une fiction. Ce sont tous des acteurs, je les ai auditionnés, choisis et payés. Tout est joué dans le film. Il n'y a rien de documentaire là-dedans, sauf le dépotoir. Tout le reste est joué, répété. »
« À mon sens, une bonne fiction, c'est quelque chose dans lequel t'embarques, et tu finis par y croire. Quand c'est bien fait. Ce qui s'ajoute à mon truc, c'est la forme de la caméra, et le fait que les acteurs ne sont pas connus. C'est sûr que ça crée un effet documentaire qui ajoute à la « crédibilité » du projet. J'aurais pu prendre des acteurs connus, je me serais peut-être simplifié la vie sur le plateau, mais je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. »
Cette impression de documentaire convainc davantage? « Dans ce contexte-là, oui. Tu veux donner l'impression que le gars a filmé ça dans son quotidien. » Le but, c'est que les gens y croient? « Oui! Si les gens croient au film, c'est eux qui partent avec le problème : est-ce que j'y crois à la coopération? C'est de créer des questions dans la tête des gens. Tu en créés plus si tu imites un documentaire que pour une fiction. »
Pourrait-on dire que le film ne serait pas « fini » s'il n'était pas diffusé? « Même s'il n'est pas diffusé longtemps, il faut qu'il se retrouve sur les écrans quelque part. Sinon, ça devient kafkaïen. C'est essentiel qu'un film soit vu. C'est un film à controverse, aussi, donc si ça part, ça peut partir et emmener de nouveaux publics. »
« C'est un film que j'ai fait volontairement pour déranger, je suis content qu'il dérange et que les gens qui vont le voir vont recevoir un coup de bâton dans la face. »
Journal d'un coopérant prend l'affiche aujourd'hui à Montréal.