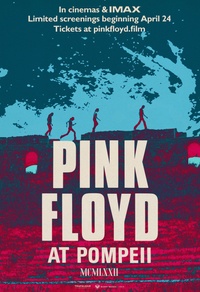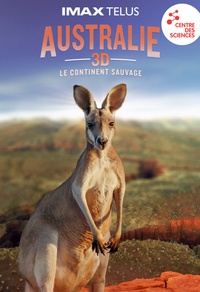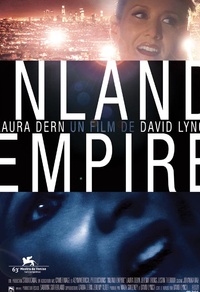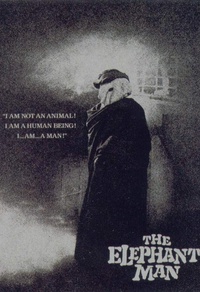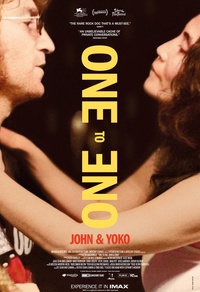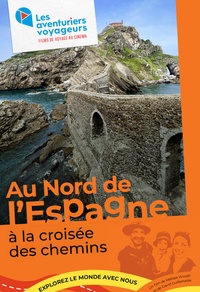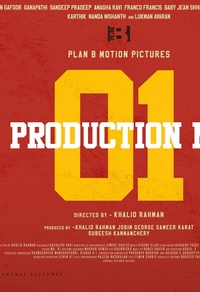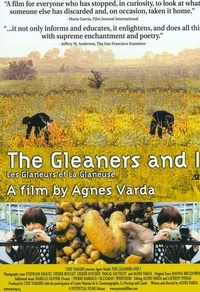L'Antiquité a bien souvent fait les choux gras du cinéma hollywoodien puisque la richesse des événements qui s'y sont déroulés permet aux cinéastes de faire des recoupements avec notre époque, tout en s'en détachant. Or, cette utilisation analogique du péplum comme reflet de l'époque moderne n'a pas changé depuis l'invention du genre, mais son traitement a, quant a lui, grandement évolué.L'un des premiers réalisateurs à exploiter le genre du drame épique antique est Cecil B. DeMille (celui-là même dont le Golden Globe hommage porte le nom et qui a été décerné cette année à Robert De Niro). En 1923, il réalise une première version de The Ten Commandments, un film muet, mais incroyablement coûteux (il en fera un remake parlant en 1956). Dans les années folles, l'argent coulait à flots aux États-Unis et les films reflétaient cette effervescence. Pourtant, pendant la Crise, en 1934, DeMille récidive avec Cleopatra. Loin de diminuer le luxe de sa production, il cherche plutôt à faire rêver les masses et présente un spectacle grandiose, pompeux, magnifique.
Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays européens s'intéressent au genre. En mettant en scène des conflits du passé et en divinisant presque des héros humains, les cinéastes cherchent à remettre dans un contexte historique la guerre qui vient de ravager le continent. Dans les années 50 et 60, les studios italiens de Cinecittà, à l'origine fondés par Mussolini pour sa propagande fasciste, accueillent des centaines de tournages, tant européens qu'étrangers. Le premier américain à y tourner est Mervyn Leroy qui initie un remake de Quo Vadis, Le film raconte les persécutions religieuses au temps de l'Empire romain. Produit par la société MGM (fondée par Goldwyn et Mayer, deux hommes d'affaires juifs), le film fait évidemment écho à l'holocauste. Sur une période de quinze ans (1951-1966), en plein coeur de la Guerre froide, ce sont 150 péplums qui seront tournés en Italie.Durant cette période, les films sur Hercule, Hélène de Troie, Alexandre le Grand, Jules César, Marc Antoine, Cléopâtre, Spartacus et même Jésus, sont « légion » et se succèdent à un rythme effarant. À cette époque, la Toute-puissance américaine se manifeste dans ces drames historiques traités avec tout le luxe et le glamour possible. Les vies des grands hommes et des grandes femmes sont dépeintes par des monstres sacrés du star system (Elizabeth Taylor, Richard Burton, Charlton Heston, Marlon Brando, Anthony Quinn, Kirk Douglas...) qui, tout en bénéficiant de l'aura mystique des personnages qu'ils interprètent, leur apportent également un peu du lustre de leur popularité moderne. Enfin, le genre finit par s'essouffler. Entre le Jules César de Stuart Burge, dernier péplum d'envergure (avec Charlton Heston - 1970) et l'échec lamentable que fut le violent et éprouvant Caligula de Tinto Brass (1979 - budget estimé à 17,5 M$ pour 80 000 $ de revenus aux Etats-Unis), près de dix années s'écoulent. Durant cet intervalle, une seule production se démarque. Les Italiens ayant appris comment gérer de gargantuesques fresques historiques au contact des Américains produisent Jesus of Nazareth (1977), une méga production de six heures et demie, conçue par Franco Zeffirelli pour la télévision. Ce film, grandiose et chronologiquement fidèle, est l'un des premiers péplums à véritablement faire entrer l'Histoire dans l'histoire.
À la fin des années 90, le genre connaît une renaissance. Deux films paraissent à l'orée du changement de millénaire, soient Titus (avec Anthony Hopkins et basé sur l'oeuvre de Shakespeare) et le très populaire Gladiator (réalisé par Ridley Scott, avec Russell Crowe) qui, en 2000, remporte cinq Oscars (dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur). L'arrivée des technologies numériques permet dorénavant de montrer l'époque et ce, à moindre coût que par le passé. Ce péplum, à l'histoire typiquement américaine (un héros à la droiture exemplaire, déchu suite à la trahison d'un être méprisable, retrouve la gloire et satisfait sa vengeance avant de mourir pour la cause de la démocratie), interpelle un nouveau public. Une fois encore, la précision historique est délaissée au profit de la tangente idéologique. Tout de même, sans avoir véritablement retrouvé la popularité de son Âge d'or, il n'en demeure pas moins que depuis 1999, plusieurs péplums ont été produits (Alexander – Oliver Stone (2004), Troy - Wolfgang Petersen (2004), The Last Legion – Doug Lefler (2007), Centurion – Neil Marshall (2010)) et certains autres sont en développement (Xerxes - Zack Snyder (2011), Cleopatra - Paul Greengrass (2013), Julius Caesar - Burr Steers (sortie à déterminer)).
Ironiquement, ce sont les films fantaisistes, ceux qui ont revampé le genre sans tenir compte de la justesse chronologique, qui se sont sauvé avec la cagnotte (300, Clash of the Titans) dans les dernières années. Revenant aux principes du cinéma spectacle en vogue dans les années 60, ce sont ces titres, et non des films plus sombres, qui ont eu la faveur du public. Car au contraire des tragédies lumineuses et colorées des années 60, les réalisateurs portent davantage, depuis les années 90, un regard sombre sur le passé - et par ricochet, sur notre propre époque.
Ce vendredi paraissait The Eagle, un autre péplum se déroulant en Bretagne, à l'apogée de l'Empire romain. Il s'agit d'une histoire d'honneur où le barbare n'est pas celui que l'on croit et où la décadence d'un peuple se mesure à l'ampleur de ses illusions... Existe-t-il un meilleur propagateur d'illusions que le cinéma à grand déploiement, made in Hollywood?