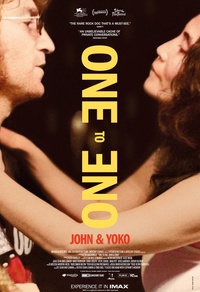Plus une société est restrictive et réactionnaire, plus l'utilisation de la fiction s'avère populaire auprès de l'élite artistique. Que ce soit dans un monde où la censure est exercée par le pouvoir politique ou dans une réalité qui, comme de nos jours, est saturée d'images, de sons, de stimulations de toutes sortes - à tel point que l'on ne sait plus où donner de la tête - et où le sens critique est noyé par une surabondance d'information, la fiction demeure peut-être l'arme la plus efficace afin de faire passer un message.
Les sorties cette semaine de Tout ce que j'aime et de Notre jour viendra, films grinçants qui ne sauraient plaire à tous, s'inscrivent parfaitement dans l'atmosphère viciée de ce début de siècle où la déshumanisation rapide, par la surutilisation de la technologie et l'écart grandissant entre riches et pauvres, entraîne lentement mais sûrement nos sociétés vers leur propre autodestruction. Pas surprenant que Romain Gavras (le fils du grand Costa-Gavras), réalisateur de Notre jour viendra, ait quelque chose à dire et s'intéresse de près, comme l'a fait son père avant lui, à la critique sociale et au militantisme citoyen dont le porte-étendard par excellence demeure l'expression artistique.
On dit que l'Histoire se répète, qu'elle vient par cycle et le cinéma est tributaire de son époque. Dans Tout ce que j'aime, une jeunesse désoeuvrée découvre à ses frais que chaque geste, chaque choix, est politique. L'histoire de ce film polonais, datant de 2009 se situe au début des années 80, alors que la musique punk revendique une liberté d'expression très peu valorisée derrière le rideau de fer. Or, l'époque qui a vu arriver Notre jour viendra, la nôtre, ressemble un peu à celle qui aura donné naissance à Z, un thriller politique réalisé par Costa-Gavras: une jeunesse revendicatrice, un fort désir de changement, le constat d'échec de la démocratie de capital. Ces enjeux de la fin des années 60 font un retour en force aujourd'hui, préoccupations auxquelles on ajoute désormais la surconsommation, la pollution et l'épuisement progressif de nos ressources. De telles époques voient également la radicalisation des idéologies, car la peur, l'incertitude et le désespoir sont des terreaux fertiles pour l'arrivée de « messies » qui prétendent posséder les réponses. Or, dans une société comme la nôtre qui déresponsabilise les individus et où les gouvernements que nous élisons ne sont plus imputables, le danger croît exponentiellement.
Le cauchemar de 1984 pourrait bien se réaliser un jour. Avec la mise en place, après le 11 septembre, d'un Patriot Act remis au goût du jour par le sénat américain, les libertés individuelles ont connu une période sombre et malheureusement, peu de gens se sont insurgés contre la mise en place d'une telle mesure. Peut-être que si Hollywood n'avait pas pesé de tout son poids pour empêcher la diffusion de Punishment Park (Peter Watkins, 1971), les Américains auraient compris ce qu'on leur imposait. Malheureusement, ce film puissant, trop méconnu pour avoir eu un impact réel, est toujours non officiellement interdit aux États-Unis; personne ne veut se risquer à le présenter en salles ou à la télévision. Watkins y montre avec force les effets pervers d'une mesure visant à tuer dans l'oeuf toute possibilité de contestation citoyenne. Réalisé dans la foulée de la mise en oeuvre par Nixon d'un état d'urgence national inspiré du très controversé McCarran Act, Punishment Park n'a jamais pris l'affiche au pays de l'Oncle Sam. À l'époque comme aujourd'hui, les États-Unis étaient en guerre contre une puissance étrangère. Afin de limiter la contestation à l'interne, le gouvernement américain s'est doté d'une législation lui octroyant le droit, sans en référer au Congrès, d'arrêter sans preuves des citoyens qui pourraient présenter un risque pour la sécurité nationale (autrement dit, tous ceux qui s'opposent à la politique officielle), d'espionner les citoyens à leur insu, de faire pression sur certains groupes. Michael Moore a d'ailleurs tourné en dérision le Patriot Act dans son Fahrenheit 9/11.
Or, si aujourd'hui, toutes ces mesures semblent naturelles à nos voisins du sud, sachez qu'il n'y a pas si longtemps, les habitants du pays de la liberté voyaient d'un mauvais oeil qu'on observe leurs moindre faits et gestes. On n'a qu’à penser à Enemy of the State, inspiré de plusieurs classiques d'espionnage (The Conversation de Francis Ford Coppola, The Man Who Knew Too Much d'Alfred Hitchcock et Three Days of the Condor de Sydney Pollack) dans lequel Will Smith et Gene Hackman font équipe pour mettre au jour une conspiration visant précisément à faire passer en douce une loi qui permettrait d'espionner les citoyens. Ironique vous dites? Le film date de 1998, trois ans seulement avant que l'Amérique ne bascule dans la paranoïa. Quant aux préoccupations technologiques, sachez que ce qui paraissait fantaisiste, voire farfelu, dans le film Enemy of the State est très plausible aujourd'hui et ce qui est triste, c'est que plus personne aux États-Unis ne trouverait à s'insurger contre de telles mesures. Elles font désormais partie du paysage.
Avec la plupart des oeuvres de fictions les plus habiles, celles qui ont le plus à offrir au niveau de la réflexion sociale, le problème est qu'elles sont bien souvent des oeuvres plus hermétiques, moins divertissantes pour un plus large auditoire. Bien qu'Enemy of the State était, quant à lui, un film d'action à grand déploiement, il n'a pas su marquer suffisamment son public pour avoir un réel impact lorsqu'est venu le temps pour le peuple américain de défendre ses droits. Peut-être qu'Hollywood, étant partie intégrante de cette machine capitaliste, ne pourra jamais engendrer de films vecteurs de changement social. Quant au cinéma militant, est-ce un combat perdu d'avance pour ses auteurs? Est-ce une utopie de croire que leurs films pourraient faire changer les choses? Le cinéma fait-il changer la société ou n'est-il que le reflet d'une société en constant changement?