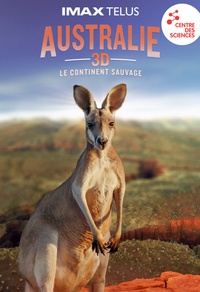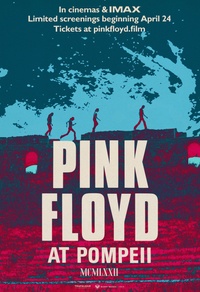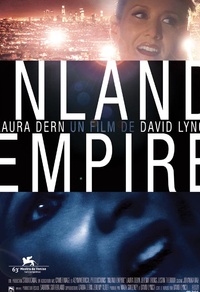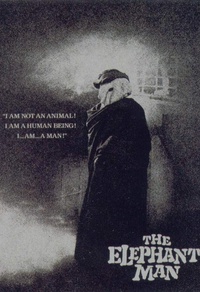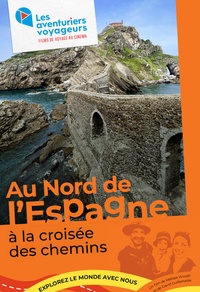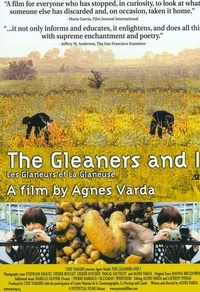À l'origine de tout ce qui est cinématographique au Québec, en animation comme pour le reste, se trouve l'ONF. Son secteur d'animation connaît un développement foisonnant dans les années 60 et 70 avec des artistes de talent, reconnus partout mondialement. Norman McLaren et Ryan Larkin, de très grands animateurs, ont été les précurseurs du secteur d'animation d'ici. On oublie souvent que plusieurs des films de l'ONF, produits en studio à Montréal par des gens passionnés et novateurs, nous ont représentés aux Oscars des décennies avant Incendies, Monsieur Lazhar, Rebelle ou Henry. Le secteur animation de l'ONF a, à lui seul, récolté plus d'une trentaine de nominations en soixante ans, et remporté la statuette de nombreuses fois. Et on oublie trop souvent que le Québécois Frédéric Back a obtenu à lui seul deux Oscars en quatre nominations, chose rare et remarquable, qui témoigne de l'ampleur de son talent.
L'héritage est donc là, le talent et la créativité également, mais depuis la chute scandaleuse de Cinar, le secteur de l'animation connaît des difficultés. Or, avec l'arrivée des technologies numériques, les films d'animation ont connu des changements majeurs. Avec Toy Story (1995), Pixar, devenu le joueur le plus important de l'industrie, a laissé une trace indélébile dans l'histoire et a établi des standards de qualité que la concurrence s'efforce d'égaler. Doté de budgets blindés, d'équipes de scénaristes aguerris et pourvu des meilleurs animateurs du monde, Pixar rafle succès après succès. Et jamais les films d'animation n'ont connu une telle popularité en salles.
Avec la sortie de La légende de Sarila, c'est donc tout un pan de notre cinématographie qui renaît et qui se positionne. Si le résultat parle de lui-même, le parcours entre l'idée et sa concrétisation a été parsemé d'embûches. Munie d'un budget dérisoire pour l'ampleur de la tâche à accomplir, la production de ce film est un petit miracle d'ingéniosité, d'adaptabilité, de travail acharné et de volonté. Mais les ventes internationales en témoignent : le défi a été relevé avec brio... Chaque public à qui le film a été présenté a eu un choc lorsque le budget a été dévoilé : jamais un tel film n'aurait pu voir le jour ailleurs qu'ici. C'est un véritable hommage à la ténacité de Nancy Florence Savard, réalisatrice et coproductrice du film, et à la passion inépuisable de son équipe chez 10e avenue Productions. Et avec cinq films en développement, la compagnie de St-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec risque de se tailler une place de choix sur les marchés internationaux.
Car au contraire des films de fiction traditionnels, le médium permet de faire des versions originales anglaises et françaises pour de moindres coûts, ce qui ouvre la porte à un bassin beaucoup plus large de spectateurs... et à des revenus proportionnels. Sauf qu'à la différence du cinéma en action réelle, le développement d'un film d'animation par ordinateur requiert davantage de temps, une planification rigoureuse et le processus est long et laborieux. La production d'un tel long métrage nécessite l'intervention de plusieurs départements, du scénario au design en passant par le casting et la programmation. C'est un véritable casse-tête et seule l'expérience permet, à terme, d'éviter les écueils. Or, cette expertise n'existait pas au Québec jusqu'à tout récemment et la production de Sarila, étalée sur une décennie, aura eu pour conséquence de consolider les bases pour les projets futurs.
Après tout, il semble que les prochaines années seront propices au redémarrage d'un secteur d'animation florissant au Québec. Le remake en animation tridimensionnelle de La guerre des tuques par Carpe Diem, le coproducteur de Sarila, n'est que la pointe de l'iceberg; le Québec semble prendre conscience de sa maturité en matière d'animation. Car il ne faut pas se leurrer, la main d'oeuvre québécoise, en effets spéciaux et en effets visuels, est reconnue mondialement et courue par les plus grands. Son développement, parallèle au développement de l'industrie du jeu vidéo, connaît une croissance rapide depuis les années 90, notamment avec l'arrivée d'Ubisoft à Montréal en 1997 et les liens entre l'industrie du film et celle du jeu vidéo ne cessent d'ailleurs de se resserrer depuis cinq ans. Et pas qu'ici... la tendance est observable partout dans le monde. Le Québec a donc un avantage concurrentiel sans précédent que certains ont su observer.
Le problème se pose donc : comment la cinématographie québécoise peut-elle avoir accès à l'immense bassin de talents d'ici et optimiser ses ressources pour que le miracle de Sarila soit reproductible à l'échelle industrielle? Les modèles d'affaires sont peut-être à revoir et Sarila arrive à point nommé pour nous rappeler que l'innovation est la seule véritable arme pour assurer la survie d'une industrie dans un marché comme le nôtre. Serait-il souhaitable de faciliter un dialogue entre l'industrie du jeu et celle du film? Après tout, les possibilités narratives inouïes de l'animation par ordinateur, son coût relativement modique par rapport à des productions à grand déploiement, sa relative neutralité linguistique et culturelle sont des avantages colossaux que l'on a négligés dernièrement. Dans un monde où la propriété intellectuelle est le nerf de la guerre, le Québec connaît une percée qui lui permettrait, le cas échéant, de rivaliser avec les géants et de récolter sa part du gâteau.